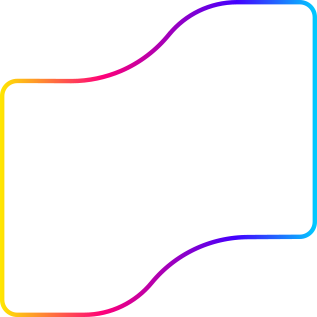Le 25 septembre 2017, 3,5 millions d’électeurs étaient appelés à se prononcer sur l’indépendance du Kurdistan irakien. Un référendum promis de longue date, et dont l’issue ne faisait aucun doute. En effet, en 2005, alors que les Kurdes d’Irak obtenaient leur autonomie, ils étaient déjà 98 % à se déclarer en faveur de l’indépendance. Entre-temps, le pouvoir central s’était effondré à Bagdad et le territoire des Kurdes s’était agrandi au rythme des défaites de Daech. Leur leader, Massoud Barzani, se rêvait en père du premier État kurde. De même, en Syrie, les milices kurdes, nimbées de la gloire chèrement payée de la bataille de Kobané, pouvaient se rêver en acteurs incontournables des négociations pour la paix. Mais maintenant que Daech ne hante plus autant les nuits de la coalition internationale, les rêves des Kurdes de Syrie et d’Irak semblent virer aux cauchemars.
Une région clé
Le 17 janvier dernier, le secrétaire d’État américain Rex Tillerson a annoncé que les États-Unis ne comptaient pas abandonner la Syrie à Bachar el-Assad, aux Russes et aux Iraniens après la défaite des islamistes. Mais bien au contraire créer une « force de sécurité frontalière » constituée de 30 000 hommes et gérée par les Forces démocratiques syriennes (FDS) en coordination avec les Unités de protection du peuple kurde (YPG). Il n’en fallait pas davantage au président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui considère les YPG comme des émanations du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation responsable de nombreux attentats dans son pays, pour déclarer la guerre au Kurdistan syrien. Trois jours plus tard, il lançait une offensive contre le canton d’Afrin, entraînant avec lui l’Armée syrienne libre (ASL).

Crédits : The Kurdish Project
Afrin, c’est le maillon faible du territoire bâti par les FDS et les YPG dans le nord de la Syrie à la faveur de leur combat contre Daech. En effet, coincé comme il l’est entre la Turquie, des zones rebelles placées sous l’influence d’Ankara et des zones reprises par le régime de Damas, ce canton est coupé du reste du territoire dominé par les Kurdes dans le nord du pays. Mais il occupe malgré son isolement une place centrale d’un point de vue politique et symbolique. C’est une enclave qui permet de prendre la prestigieuse ville d’Alep en tenailles, et la première région à avoir été directement administrée par une milice kurde depuis le début de la guerre en Syrie. C’est en outre une région qui fut le théâtre de la chute de l’Empire ottoman en 1918.
« La déclaration de Tillerson a fourni un prétexte à Erdogan, mais il est probable que ce dernier songeait à attaquer cette région depuis un bon moment », analyse Cyril Roussel, géographe spécialiste du Moyen-Orient. « C’est seulement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », renchérit Jordi Tejel, historien spécialiste des Kurdes. « La Turquie a de toute façon intérêt à contrôler sa frontière avec la Syrie : pour assurer sa sécurité, c’est évident, mais aussi pour imposer sa force militaire dans le pays en cas de partition après la guerre, ou encore pour gérer les flux de populations. » Et face à sa détermination, les Occidentaux paraissent bien timides : Paris comme Washington ont appelé Ankara à faire preuve « de retenue » tout en disant comprendre son « souci » et ses « préoccupations légitimes en matière de sécurité ».
« La Turquie est membre de l’OTAN », rappelle le représentant du Kurdistan syrien en France, Khaled Issa. « C’est la seule explication. Résultat, les puissances occidentales ne prennent aucune décision à la hauteur de la situation. C’est pourtant la France qui agit. Elle seule a demandé une réunion exceptionnelle du conseil de sécurité. Mais il faut évidemment aller plus loin : sanctionner Ankara, envoyer des observateurs sur place, interdire l’espace aérien à l’aviation turque. Jusqu’à quand soutiendra-t-on la Turquie ? Hier, les avions turcs ont bombardé une ferme et tué les huit membres d’une même famille parmi lesquels un bébé âgé d’un an. »

Crédits : Kurdishstruggle/Flickr
La Jérusalem kurde
En Irak, les Kurdes se sont vu reprendre par Bagdad l’essentiel des territoires qu’ils avaient conquis en luttant contre Daech. Et ce, moins d’un mois après leur « oui » massif à l’indépendance, qui n’a été soutenue ni par Téhéran, ni par Moscou, ni par Washington, ni par Paris. Bagdad a notamment repris le contrôle de la ville de Kirkouk, qui est surnommée la « Jérusalem kurde », et de la totalité de sa province, qui représentait près la moitié des revenus du Kurdistan irakien avec sa production de plus de 400 000 barils de pétrole par jour. « La reprise par le gouvernement et le ministère du pétrole de l’ensemble des installations et des champs pétrolifères, ainsi que des stations de pompage et des oléoducs de la province de Kirkouk et dans des zones dites disputées va permettre un retour à l’ordre », se réjouissait alors le ministre du Pétrole irakien, Jabbar Al-Louaïbi.
De son côté, le président irakien Fouad Massoum, lui-même d’origine kurde, a déclaré que « la tenue du référendum d’indépendance du Kurdistan a créé des différends dangereux entre le gouvernement central et le gouvernement du Kurdistan, et a eu pour résultat la restauration du contrôle des forces de sécurité fédérales à Kirkouk ». Quant à Massoud Barzani, il a fini par démissionner de ses fonctions, le 29 octobre 2017, non sans rejeter la responsabilité de la déroute du Kurdistan irakien sur ses adversaires politiques, qu’il a accusés de « haute trahison ». Une déroute prévisible pour Cyril Roussel, qui estime que Massoud Barzani a manqué de « patience », de « prudence » et de « lucidité ».
« Les diplomaties étrangères l’avaient pourtant prévenu que si elles le soutenaient militairement contre Daech, elles ne le soutiendraient pas dans sa marche vers l’indépendance », rappelle le géographe. « Alors que lui est-il passé par la tête ? » Certains affirment que Barzani est un homme cynique qui, pour s’accrocher au pouvoir, n’a pas hésité à promettre à son peuple une indépendance qu’il savait pertinemment ne pas pouvoir lui offrir. D’autres le voient comme un opportuniste qui « a joué, et perdu ». D’après Jordi Tejel, il est « avant tout victime de la realpolitik des puissances mondiales, qui a fait son grand retour au Moyen-Orient ces dernières années ». Le principal intéressé, lui, préfère se voir comme « un peshmerga », c’est-à-dire comme un combattant.
« Je continuerai d’aider mon peuple dans sa lutte pour l’indépendance », a-t-il promis. Reste que les Kurdes d’Irak n’ont plus les moyens de s’affranchir. Leur région, qui a bénéficié de l’engouement des investisseurs après la chute de Saddam Hussein en 2003, a souffert dès 2014 de la chute des prix du pétrole et de l’arrivée de plus d’un million de déplacés syriens. Cette année-là, la croissance économique du Kurdistan irakien a connu une baisse de 5 % tandis que le taux de pauvreté est passé de 3,5 % à 8,1 %. Aujourd’hui privé de la manne de Kirkouk, il ne peut plus se passer de l’argent de Bagdad, qui contribuait à son budget à hauteur de 80 % avant leur rupture.
Indépendants
« En Irak comme en Syrie, la disparition progressive de l’ennemi provisoire de tous, Daech, laisse les Kurdes seuls face à leurs ennemis personnels de toujours : Bagdad, Ankara et Damas », souligne Cyril Roussel. « Mais les Kurdes ont l’habitude de ne compter que sur eux-mêmes : tout au long de leur histoire, ils n’ont eu que des alliances de circonstance. Contrairement à Damas, qui peut compter sur le soutien de Moscou, ou encore à Ankara, qui peut compter sur celui de Washington malgré tous leurs différends. Les Kurdes ne tirent pas leur force de leurs alliances, ils tirent leur force de leur mobilisation, de leur organisation, de leur sens de l’opportunité à saisir. » Tout n’est donc pas encore perdu pour eux.
En Irak, « ils pourraient négocier un retour de leur autonomie sur un territoire équivalent à celui qu’ils contrôlaient en 2005. » En Syrie, ils auraient les moyens de résister aux Turcs. « Dans tous les cas, ils se battront jusqu’au bout et la région d’Afrin est une région de collines et de montagnes », prévient Cyril Roussel. C’est une guerre qu’il faudra gagner à pieds, pour laquelle les combattants kurdes sont mieux préparés que ceux de l’armée turque et de l’ASL. « Il est d’ailleurs possible qu’il y ait des défections du côté des Syriens. La Turquie risque de s’enliser dans un conflit sans fin, et sans gains politiques réels. » Au grand dam de Recep Tayyip Erdogan, qui se prépare aux élections générales de 2019.

Le président turc a tenu à souligner le fait qu’il agissait avec l’accord de Moscou. Mais les Kurdes de Syrie devront néanmoins renouer le dialogue avec les Russes s’ils veulent tirer leur épingle du jeu. Pour Jordi Tejel, « ils pourront certainement garder une autonomie de facto, semblable à ce qui existait en Irak avant 2005, difficilement obtenir davantage ». « En Syrie comme en Irak, mais aussi en Iran et en Turquie, un “grand Kurdistan” indépendant n’est pas vraiment un objectif politique », affirme pour sa part Cyril Roussel. « C’est un mythe politique qui permet de fédérer et de mobiliser pour défendre les droits des minorités kurdes. » Espérons que ces droits seront respectés dans la Syrie de l’après-guerre, quel que soit son visage.
Couverture : En route vers Kirkouk. (The Kurdish Project)