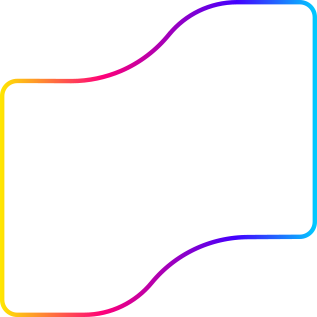Djibouti est souvent qualifiée de « Terre des dieux » dans les catalogues touristiques. Cette expression renvoie au Pays de Pount, un royaume mystérieux aux richesses bien gardées situé au sud de l’Égypte antique. La reine Hatchepsout en parlait comme de son « lieu de plaisir ». La localisation exacte de Pount est incertaine, mais les historiens évoquent la plupart du temps Djibouti, l’Érythrée, la Somalie et le Yémen. Les habitants de Djibouti semblent convaincus qu’il s’agit de leur pays. Quelle que soit sa localisation, cette région était d’une importance capitale. Hatchepsout organisa une expédition à Pount, connue sous le nom de Ta netjeru dans la langue de l’époque. Pount était un endroit sacré pour les Égyptiens de l’époque : ils voyait en lui le lieu de naissance des dieux et des hommes. Le pays avait également une valeur commerciale : la flotte égyptienne traversait régulièrement la mer Rouge pour faire le commerce de l’encens, de l’ivoire, de l’or et des animaux sauvages, entre autres denrées. De nos jours, l’emplacement charnière de Djibouti amène un autre type de visiteurs. « Nous sommes la porte d’entrée vers le Moyen-Orient. C’est la raison pour laquelle les Américains viennent ici », me confiait Zaki alors que j’étais assise à ses côtés dans le centre-ville de Djibouti, en 2010.

Une rue de Djibouti
Crédits
En route pour Djibouti
Nous nous trouvions au Sept Frères, un restaurant du quartier africain réputé pour sa moukbassa, un plat constitué d’un poisson entier pêché dans la mer Rouge, grillé à la Yéménite et servi avec du lahol (un pain plat de Djibouti) ainsi qu’une purée sucrée de bananes et de miel appelée houbla. Zaki était un homme grand, décharné et affichait un air solennel. Il avait une trentaine d’années. Nous avions échangé des emails tandis que je me trouvais encore dans ma ville natale de Nairobi, et je lui avais parlé de mon voyage. J’étais ici pour superviser un projet de recherche sur la démocratie. Naturellement, les fonds venaient des États-Unis. Mes supérieurs m’avaient choisie pour cette mission car je parlais français. Le client était une ONG américaine dont la mission était d’éduquer les citoyens de terres « anti-démocratiques » aux bienfaits de la démocratie. Ils avaient contacté mon patron pour savoir s’il avait une équipe à Djibouti. Celui-ci avait répondu immédiatement qu’il avait des hommes expérimentés partout dans le pays – ce qui était un pur mensonge, ces hommes étaient totalement imaginaires. Encouragés par sa réactivité et son ingéniosité, les Américains lui répondirent qu’ils désiraient réaliser une étude sur l’attitude des Djiboutiens face à la démocratie. Mon patron, voyant là la possibilité d’une longue et fructueuse relation avec l’ONG, accepta tout de go. Il établit le calendrier, le budget et les leur envoya. Puis il me convoqua dans son bureau et me présenta la mission. 
~
Le lendemain matin, je me rendis à l’ambassade et attendis nerveusement l’accélération de ma demande de visa. J’avais décidé de faire preuve d’une certaine prudence et d’entrer dans le pays de façon légale. Un de mes collègues plus âgés, un vétéran chevronné du voyage en terre « anti-démocratique », m’avait donné quelques conseils : « Quoi que vous fassiez, ne parlez jamais de politique. Dites-leur que vous faites une étude comparative sur les habitudes alimentaires dans les régions d’Afrique de l’Est. » Cela marcha comme sur des roulettes. L’agent de l’ambassade, qui s’ennuyait à mourir, n’était pas du tout préparé à mon offensive. Parlant mon plus beau français et armée de mon plus éclatant sourire, je lui déclarai mon intérêt profond et sincère pour la nourriture djiboutienne – son pain plat lahoh, ses desserts halwo, ses pâtes baasto. Je lui confiai même espérer goûter la viande de chameau. Je quittai les lieux non seulement avec un visa tamponné sur mon passeport, mais également avec une liste longue et variée de délices culinaires recommandés par l’agent. Mon projet semblait placé sous de bons augures.

La capitale éthiopienne
Crédits : Sam Effron
À 2 h du matin le jeudi, je me présentai au poste d’embarquement de l’aéroport international de Jomo Kenyatta, à Nairobi. Le vol de deux heures jusqu’à Addis-Abeba se déroula sans encombre. Je le passai à me familiariser avec les champs de recherche très précis de mon client. Je poursuivis mes préparatifs pendant les quatre heures d’attente à l’aéroport de Bole, à Addis-Abeba, ne marquant de pause que pour observer les gens. J’étais particulièrement fascinée par un groupe de femmes portant des robes amples et longues et des châles drapés autour de la tête. Une Éthiopienne d’âge moyen assise derrière moi me murmura que ce groupe se rendait à Riyadh, en Arabie Saoudite, et que ces femmes étaient peut-être victimes de trafic humain. Les trafiquants se font passer pour des agences étrangères pour l’emploi et attirent de nombreuses femmes éthiopiennes, en leur promettant un travail domestique au Moyen-Orient, où bon nombre d’entre elles se retrouvent prisonnières d’employeurs cruels et mènent une vie de servitude et de souffrance. En les regardant plus attentivement, je remarquai que les robes qu’elles portaient étaient pour la plupart neuves, et que leurs châles étaient ajustés d’une manière qui indiquait l’inconfort ou le manque d’habitude. Je me demandais ce que le sort réservait à ce groupe apparemment plein d’optimisme. Pendant le vol de quarante minutes d’Addis-Abeba à l’aéroport d’Ambouli, à Djibouti, mon regard croisa celui d’un soldat américain assis dans le siège 23C. Il m’adressa un clin d’œil, et je me détournai prestement. Djibouti abrite l’unique base militaire américaine de toute l’Afrique. Le Camp Lemonnier, sis dans la banlieue de la ville, est le lieu de regroupement des forces américaines pour la guerre contre le terrorisme dans la Corne de l’Afrique, et sans aucun doute l’une des sources de l’intérêt de mes clients pour ce minuscule pays. Le soldat m’aida à descendre ma valise quand nous atterrîmes enfin. Il avait les bras musclés et portait de nombreux tatouages. Il se tint près de moi dans le bus pour rejoindre le terminal, mais nous n’échangeâmes pas un mot. Je me baissai pour prendre un stylo dans mon sac afin de remplir le formulaire d’immigration. Quand je relevai la tête pour le voir, il était parti. Je soupirai et avançai dans la file.
La porte des Larmes
Quand je sortis dans la chaleur étouffante, un porteur qui commençait à être âgé se saisit de ma valise avec une aisance remarquable et me pressa vers un taxi. Il tendit la main et aboya : « C’est trois dollars ! » J’obtempérai et me glissai dans le véhicule en mauvais état. Un chauffeur de taxi d’un âge avancé me salua et se présenta. Il s’appelait Issa. Il caressa sa barbe rousse et me demanda l’adresse de mon logement. Des touffes de cheveux du même roux émergeaient de sa calotte blanche. J’aurais voulu l’interroger sur sa teinture au henné mais je pressentis que la chose serait inapproprié. « À l’hôtel Ali Sabieh », répondis-je. Il me lança un regard méfiant : « Vous n’avez pas de famille ? – Pas ici. » J’avais cherché un hôtel abordable sur Google, situé à proximité de l’université où je comptais recruter mon équipe de terrain parmi des étudiants intelligents, motivés et à cours d’argent. Avais-je sans le vouloir choisi un hôtel d’amour miteux dans un quartier malfamé de la ville ? Le quartier chaud ne se trouvait sûrement pas en plein centre-ville… « Vous êtes mariée ? – Non. – Vous avez des enfants ? – Non. »
« Ceux qui prétendent que nous nous sommes vendus aux Américains ne comprennent pas notre situation. » — Zaki
Il fronça les sourcils en signe de désapprobation : « Ça ne va pas. Les femmes doivent se marier et avoir des enfants tôt, quand elles sont jeunes. » Il m’observa attentivement dans le rétroviseur, tentant sans doute de déterminer pourquoi j’avais été incapable de prendre un homme au piège, à mon âge avancé de 25 ans. « Ce n’est pas bien pour une femme de voyager seule et de dormir à l’hôtel. Les gens vont parler. Et puis, votre hôtel est trop cher, je vais vous conduire à un autre établissement. » Issa me recommanda l’hôtel Banadir. C’était un endroit propre et utilitaire, et une fois que je me fus assurée de la présence d’un ventilateur dans la pièce, je payai en espèces pour deux nuits. On dit que Djibouti est le pays le plus chaud du monde, et j’avais déjà expérimenté une chaleur de 40°C. Kadra, une femme de ménage corpulente et sympathique, m’apporta une quantité incroyable de café sucré, de jus d’orange frais et de baguette encore chaude et croustillante. Tandis qu’elle nettoyait ma chambre, elle ne tarda pas à déplorer le nombre réduit d’hommes de bien dans la région. « Ils passent leur temps à mâcher du khat », dit-elle avec colère en tapant un coussin. Comme moi, Kadra était célibataire. Elle ressentait beaucoup d’amertume envers ses quatre sœurs aînées (bien moins belles qu’elle, selon ses dires), qui avaient toutes fait un mariage heureux et avaient aujourd’hui des enfants. Elle, au contraire, devait se démener pour vivre une vie honnête. Je pris une douche revigorante et enfilai une robe ample et fluide, que j’avais emportée en prévision de la chaleur. Je me rendis à la réception pour appeler Zaki – mon unique contact dans le pays –, qui m’avait été recommandé par le vétéran que j’avais rencontré au bureau. Il connaissait quelqu’un dans la banlieue d’Eastleigh, un quartier à population majoritairement somalienne des environs de Nairobi, qui connaissait quelqu’un de la capitale somalienne Mogadiscio, qui connaissait quelqu’un à Djibouti… À mon grand plaisir, je découvris que le gérant de l’hôtel était un Arabe d’Oman qui désirait pratiquer son swahili arabisé avec moi. Après une conversation laborieuse et plusieurs tasses de café sucré, je parvins enfin à me sortir de cette situation et m’aventurai dans les rues d’une Djibouti déserte en ce vendredi après-midi chaud et humide, pour retrouver Zaki.

Zone de débarquement américaine à Djibouti
Crédits : US Navy
« Notre pays est le plus petit de la région », me dit-il tandis qu’il décortiquait son poisson à mains nues. « Nous sommes un pays désertique et nos ressources naturelles sont limitées. Ceux qui prétendent que nous nous sommes vendus aux Américains ne comprennent pas notre situation. » Les États-Unis représentent en effet un allié de taille quand on a pour voisins des pays aussi instables et belliqueux que la Somalie et l’Érythrée. Tandis que Djibouti s’engageait dans le combat pour la paix en Somalie, la présence des militaires américains dans le pays nuisit particulièrement au groupe terroriste d’al-Shabaab. L’organisation rappela à Djibouti que la Somalie avait sacrifié son peuple et ses ressources pour leur venir en aide dans leur lutte pour l’indépendance. L’accord signé le 5 mai 2014 avec le Président Obama, qui permettait aux Américains de conserver leur base militaire à Djibouti pendant au moins trente ans, n’était pas la meilleure façon de remercier les Somaliens. La présence de soldats étrangers (américains et français) est prétendument la cause d’un comportement anti-islamique de la part des femmes de la région.
Le 24 mai 2014, al-Shabaab organisa le premier attentat suicide de l’histoire de Djibouti dans le restaurant La Chaumière, un lieu particulièrement prisé des Occidentaux. Dans une vidéo revendiquant l’attaque, al-Shabaab déclara que le président de Djibouti Ismail Omar Guelleh avait signé un « pacte avec le diable » en donnant accès à ses terres et à ses installations à des « Croisés ». En juin, l’Angleterre comme les États-Unis publièrent des recommandations aux voyageurs, leur disant d’éviter Djibouti en raison de menaces crédibles de la part d’al-Shabaab contre les nations occidentales impliquées. Les Américains ne sont pas les seuls à s’intéresser à Djibouti. Tarek ben Laden, le frère d’Oussama ben Laden, voudrait construire un immense pont suspendu qui traverserait la mer Rouge et relierait le Yémen et Djibouti. Il traverserait le détroit de Bab el-Mandeb, long d’environ 30 km, reliant l’Afrique du nord-est à la pointe sud-ouest de la péninsule arabique. Bab el-Mandeb signifie « porte des Larmes » en arabe. Le nom provient d’une légende arabe sur la séparation de l’Asie et de l’Afrique lors d’un grand tremblement de terre, et des larmes de ceux qui furent engloutis par les eaux.

Ismail Omar Guelleh
Entouré de Barack et Michelle Obama
Crédits : Office of the White House
On estime qu’environ 30 % des navires transportant du pétrole transitent par ce détroit chaque jour. Plus de 3,3 millions de barils de pétrole sont transportés depuis les États du Golfe jusqu’à l’Europe et l’Amérique à travers la mer Rouge. C’est la raison pour laquelle la haute mer du Golfe d’Aden est une cible de choix pour les pirates. Zaki me désigna un Arabe âgé qui mangeait seul à une table voisine. « C’est un type très influent. Il a une bande de jeunes voyous sur des bateaux à moteur de grande puissance. Ils volent du pétrole sur les grands navires. Ils nous donnent une mauvaise réputation. Maintenant, le monde nous prend pour des pirates – comme les Somaliens. » Cette animosité envers la Somalie peut sembler étrange, quand on sait que la majorité des Djiboutiens est d’origine somalienne. Djibouti était jadis appelé la Côte française des Somalis. Quand le pays fut sur le point de gagner son indépendance en 1960, il y eut un référendum pour déterminer si la Côte française des Somalis serait rattachée à la Somalie ou non. Les Afars (un groupe minoritaire soutenu par les Français) et la France n’étaient pas d’accord. C’est ainsi que Djibouti demeura une colonie jusqu’en 1977, devenant ainsi la dernière colonie française d’Afrique à obtenir son indépendance.
Mission impossible
La ville de Djibouti était jadis surnommée le Petit Paris, et on y trouve de nombreux vestiges de la présence française : un Boulevard du Général de Gaulle, un centre culturel Arthur Rimbaud, d’après le nom du poète célèbre pour avoir abandonné la vie bourgeoise de Paris et être devenu marchand de café et d’armes dans la Corne de l’Afrique. Dans le quartier européen, sur la Place Menelik, on peut boire un café et manger des croissants sous le regard de légionnaires français en uniforme. Comme de nombreuses villes d’Afrique, Djibouti est un endroit plein de contrastes. Le quartier africain est un déchaînement d’images, de sons et d’odeurs. On y trouve d’agressifs vendeurs de vêtements, de nourriture, d’épices, d’objets électroniques et de toutes sortes de contrefaçons. Tout cela au milieu des gamins des rues, des mendiants, des prostituées, des animaux et des klaxons furieux des taxis. Des arches de style arabe particulièrement pittoresques ornent d’autres bâtiments et, tôt le matin, on est réveillé par l’appel à la prière du muezzin. C’est cela, Djibouti : la rencontre enivrante d’influences africaines, arabes et européennes. Tandis qu’on nous servait notre café postprandial, je présentai le projet à Zaki. J’étais venue ici pour prendre la température politique du pays avant l’élection présidentielle de 2011, et j’avais besoin que Zaki trouve des volontaires pour former un groupe témoin. Il me fallait autant de diversité que possible : des personnes des deux sexes, de différents âges, religions, opinions politiques, niveaux d’éducation, salaires et j’en passe, originaires des principales villes du pays. Était-ce faisable ?

Centre-ville de Djibouti
Crédits : Charles Roffrey
« Quel genre de questions voulez-vous leur poser ? me demanda-t-il d’un air soupçonneux. – Ce qu’ils pensent du gouvernement, s’ils pensent que les prochaines élections seront libres et justes… ce genre de choses. – C’est très risqué. Ils ne vous laisseront pas poser ce genre de questions. Soyez très prudente. Vous risquez d’être mise en prison, et moi aussi. Si je décide de vous aider, bien sûr. » Il m’expliqua que la liberté d’expression, de réunion et d’association étaient particulièrement restreintes ici. En plus de cela, j’étais contrainte par la loi d’obtenir un permis avant d’entamer toute recherche dans le pays. Il était certain que le gouvernement verrait ce projet comme un complot américain visant à semer des graines subversives au sein du peuple djiboutien. Cela m’inquiétait, mais il me rassura en m’affirmant que nous pourrions réussir malgré tout si nous restions vigilants et que nous employions quelques ruses. Le premier défi était d’obtenir un permis de recherche. Notre plan était d’expliquer que nous souhaitions visiter les différentes régions du pays pour documenter les habitudes alimentaires des habitants.
Le deuxième défi était de trouver des volontaires. Zaki affirmait qu’il serait difficile de trouver des personnes disposées à parler ouvertement et en toute honnêteté de la politique du pays. Mais il pensait qu’un encouragement financier et la garantie de l’anonymat pourraient délier quelques langues. Il me suggéra de louer un bus pour transporter les participants de leur ville à la capitale, pour ensuite les ramener chez eux le lendemain matin. Il faudrait également trouver un endroit discret où tenir les discussions, une tâche particulièrement ardue dans une ville de mèche avec le gouvernement et la police secrète. Nous ébauchâmes un plan d’action et il sortit son téléphone pour rassembler ses troupes. Je me dirigeai vers un cybercafé pour envoyer un compte-rendu détaillé de l’opération à mon patron. Nous rencontrâmes les clients américains le lendemain. Ils se sentaient parfaitement à l’aise dans l’opulence et le luxe du Kempinski, un hôtel qui répondait aux attentes des voyageurs en quête d’un service cinq étoiles dans un pays du tiers-monde. Le grand hall fourmillait de militaires occidentaux en uniforme, d’hommes d’affaires arabes dans leur dishdashas d’un blanc immaculé, de diplomates africains bedonnants et de touristes européens brûlés par le soleil. Je présentai Zaki comme le responsable local et à ma grande satisfaction, ils furent impressionnés par sa connaissance de la situation politique du pays. Nous les informâmes qu’un essai était prévu le jour suivant.

Vestiges français à Djibouti
Crédits : Abass Chirdon
Zaki pensait qu’il vaudrait mieux que les Américains n’assistassent pas aux discussions. Les volontaires ne voudraient sans doute pas parler en présence d’étrangers. Je lui répondis de ne pas s’inquiéter : nous placerions les Américains dans une pièce adjacente en compagnie d’un traducteur. « Le client est roi », dis-je, répétant ainsi l’un des refrains favoris de mon patron. « Et ils ne sont là que pour deux jours. » Zaki hocha la tête à contrecœur : « C’est vrai. Nous devons les satisfaire. Et puis, je ne pense pas qu’ils aient très envie de quitter l’hôtel de toute façon. – Pourquoi donc ? – Vous pensez que les étrangers viennent ici pour voir le vrai visage de Djibouti ? Non. Ils arrivent et demandent tout de suite l’air conditionné et le Wifi. Ils en ont besoin en permanence. À côté de ça, la plupart des Djiboutiens se démènent pour nourrir leur famille. » Il laissait déborder un flot impressionnant d’indignation. Je saisis cette opportunité : « N’est-ce pas en partie la faute du gouvernement ? – Le Président est un dictateur », asséna Zaki à propos du Président Guelleh, le second président de toute l’histoire de Djibouti, arrivé au pouvoir en 1999. « Il se dit favorable à des mesures progressistes mais dirige le pays comme bon lui semble, c’est-à-dire en utilisant la répression et l’intimidation. Il promet des élections justes et libres, mais cela n’arrive jamais. Il parle sans cesse de libertés démocratiques, mais ce ne sont que des mots. Au lieu d’essayer de développer le pays, il le vend à des étrangers. Le gouffre qui sépare les riches des pauvres ne fait que se creuser davantage. Voilà le pays dans lequel nous vivons. » Après tant d’indignation, il semblait que Zaki avait besoin d’une dose de khat – comme le Président, Zaki était un masticateur appliqué de ce stimulant narcotique arrivant chaque jour d’Éthiopie. Nous nous approchâmes d’un vendeur de rue à qui il acheta un grand sac rempli de feuilles vertes. Nous nous rendîmes ensuite chez son beau-frère Abdkader, qui habitait à quelques minutes en voiture. Nous passâmes devant des troupeaux de chameaux alanguis et traversâmes la banlieue sud de Balbala. À ma grande satisfaction, le beau-frère de Zaki avait rassemblé des membres de sa grande famille pour prendre part au groupe. Zaki était originaire de la tribu Issa majoritaire, tandis qu’Abdkader était d’une tribu plus petite, la tribu d’Afar.
Les Américains hochèrent la tête avec enthousiasme et griffonnèrent ces révélations dans leurs carnets.
« Ils sont plutôt somaliens, et nous sommes plutôt éthiopiens », m’expliqua Abdkader. Dans un pays où les animosités entre tribus sont monnaie courante, il s’enorgueillissait de son mariage avec une femme d’une autre tribu. C’était un homme petit et furtif, qui contrastait fortement avec son épouse Fatiah, grande, aux formes généreuses. Les hommes avaient ôté leurs pantalons de style occidental pour revêtir des macawii, un morceau de coton à motifs colorés noué autour de la taille et drapé autour des genoux comme une jupe. Après avoir récité leurs prières, ils s’assirent sur le tapis du salon et mâchèrent du khat en discutant en somalien. Fatiah apporta des bouteilles de Coca-Cola bien frais. Les seules femmes présentes étaient Fatiah, la mère d’Abdkader et moi-même. Zaki me présenta aux membres du groupe, dont les joues étaient remplies de khat. Je les remerciai pour leur intérêt pour mon projet. Je soulignai que le but des discussions était simplement de comprendre les conditions de vie d’un citoyen lambda du pays, et que je voulais rassembler autant de points de vue que possible. Ils échangèrent quelques mots entre eux à voix basse, leurs mâchoires mastiquant vigoureusement les feuilles de khat. Zaki traduisit. Ils voulaient s’assurer que leur identité demeurerait secrète et demandaient une petite compensation financière. Nous acceptâmes. J’accompagnai Fatiah dans la cuisine, où les femmes étaient en train de préparer le repas du soir, un plat de riz et une soupe épicée au bœuf appelée fahfahk. Puis, tandis que la soirée se faisait plus fraîche, on étendit des matelas et des couvertures sur le toit pour les membres de la famille éloignée. Je regagnai la ville.
Départ précipité
Le temps d’essai fut un succès. Plusieurs des hommes et des femmes présents à la discussion le soir précédent participèrent. Abdkader mena l’échange tandis et Zaki prit place dans la pièce voisine avec les Américains et moi-même, traduisant du somalien vers l’anglais. Le groupe était hésitant au départ, mais gagna en enthousiasme par la suite. Plusieurs hommes exprimèrent leur mécontentement vis-à-vis du gouvernement, faisant écho aux réflexions de Zaki de la veille. Les Américains hochèrent la tête avec enthousiasme et griffonnèrent ces révélations dans leurs carnets. Une fois que le groupe fût parti, ils me félicitèrent pour le travail que j’avais accompli. Ils allaient regagner les États-Unis le lendemain mais désiraient que je leur envoie des rapports réguliers sur mes découvertes dans les autres villes. Tandis que Zaki était particulièrement excité à l’idée d’attiser la flamme d’une révolte nationale, je ne pensais qu’à rentrer à l’hôtel pour dormir.
~
Je venais juste de trouver le sommeil quand je fus réveillée en sursaut par de grands coups frappés à la porte. Je ne bougeai pas, espérant que le visiteur indésirable perdrait patience et s’en irait. Mais les coups ne s’arrêtèrent pas. Tout à coup, la peur s’empara de moi. Pendant que nous étions chez Abdkader, Zaki m’avait conté l’histoire de deux Kényans qui avaient été arrêtés et déportés sans procès, pour avoir mené des recherches dans le pays de façon illégale. Leurs photos avaient été divulguées dans les journaux du pays, accompagnés d’articles très critiques. Cédant à la paranoïa, je pris mon téléphone et me faufilai dans la salle de bains, dont je fermai délicatement la porte avant de composer le numéro de Zaki. « Ils sont venus me chercher », murmurai-je.

Barbara Wanjala au moment des faits
Il me dit de ne pas ouvrir, de faire mes bagages et d’être prête à partir quand il arriverait. Les coups à la porte cessèrent après quelques minutes. Je suivis les ordres de Zaki puis m’assis en imaginant le pire. Ma visualisation des prisons djiboutiennes fut interrompue par un petit coup frappé à la porte et par la voix de Zaki. Je le fis entrer et l’informai des événements de la dernière heure. Il craignait le pire et me dit que je devais me rendre immédiatement chez Abdkader. Il se méfiait du propriétaire omanais trop curieux qu’il avait croisé dans le hall. Il se fit la réflexion que celui-ci était probablement déjà en train d’appeler la police. J’arrivai chez Abdkader et découvris que la nouvelle de mon arrestation supposée m’avait précédée, provoquant l’anxiété des participants au projet. Ils ne voulaient plus y prendre part. Je tentai désespérément de sauver la situation, déclarant qu’il était tout à fait possible que la police n’eût rien à voir avec tout cela. Mais l’épisode avait rouvert des blessures datant de la guerre civile, vingt ans plus tôt : les exécutions sommaires, la prison sans procès, les mystérieuses disparitions – tout cela était arrivé à des personnes de leur entourage. J’étais bouleversée. J’appelai mon patron et lui demandai des conseils sur la marche à suivre. Il dit que quelqu’un de plus compétent viendrait me remplacer. Quand cette personne arriva, son premier réflexe fut d’offrir davantage d’argent aux volontaires. Une attitude typiquement kenyane. Les Djiboutiens refusèrent : on avait porté atteinte à leur dignité. « Cela ne vaut pas de courir tant de risques », trancha Abdkader, qui se sentait profondément insulté. Le remplaçant demanda ensuite où il pourrait trouver une nouvelle équipe de volontaires. Zaki lui répondit que personne ne voudrait coopérer avec lui. Incapable d’accepter la défaite, le remplaçant entreprit le recrutement lui-même. Au lieu d’user de tact comme Zaki le lui avait conseillé, il se rendit dans les endroits publics de la ville. Il attira l’attention de la police, qui remarqua tout de suite qu’il était étranger. On lui demanda de fournir un permis. Il n’en avait pas. La police lui conseilla donc de quitter le pays dès que possible et de ne jamais y revenir. Le projet de recherche sur la démocratie connut ainsi une fin abrupte. Dans l’avion que je pris pour rentrer au pays, j’étais assise à côté d’une Djiboutienne élégante, qui approchait de la cinquantaine. Elle s’appelait Amina et se rendait à Paris pour rendre visite à des membres de sa famille. Elle me demanda si j’avais apprécié mon séjour dans le pays. Je répondis que je n’avais malheureusement pas eu l’occasion de voir grand chose. « Vous n’êtes pas sortie en boîte ? Une jeune femme comme vous ? Et vous avez fait de la plongée ? Le Lac Assal ? »

Djibouti, terre des dieux ?
Crédits
Rien de tout cela. Elle semblait encore plus déçue que moi : « Vous allez rentrer chez vous et raconter à tout le monde qu’il n’y a rien à voir à Djibouti, mais c’est faux… » À dire vrai, il est difficile de tomber amoureux de Djibouti. Pour de nombreuses personnes, c’est un endroit trop chaud, trop pauvre, trop dangereux ou trop déroutant. Malgré tout, je n’étais pas d’accord avec Amina : je n’aurais rien de négatif à raconter au sujet du pays. Et malgré le fiasco du projet de recherche américain, rien ne m’empêche d’y retourner à ce jour. « Alors, vous reviendrez ? me demanda Amina. — Oui, je reviendrai. » Certains noms ont été modifiés pour protéger l’identité des personnes mentionnées.
Traduit de l’anglais par Sophie Ginolin d’après l’article « A Survey in Djibouti », paru dans Roads and Kingdoms. Couverture : Une plage de Djibouti, par le sergent Chris Stonec. Création graphique par Ulyces.