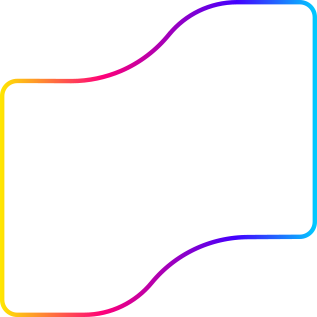La transmission ne serait pas bonne, a-t-il prévenu et peut-être serions-nous coupés. Impossible de reporter l’échange : entre le terrain, la veille et la rédaction, McDermott est un journaliste bien occupé. Depuis qu’il a fondé ce média d’investigation avec Steven Dudley, le site est devenu la référence sur la géopolitique des cartels en Amérique latine.
La Paz, Bolivie
Vous vous trouvez aujourd’hui à La Paz, en Bolivie. Si ce n’est pas une enquête confidentielle, pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez ?
Oh, bien sûr. Vous savez, il y a un changement de dynamique dans le marché de la cocaïne en Amérique latine. L’une des forces les plus importantes derrière ces changements de dynamique est le fait que l’Amérique latine est en train de développer son propre marché de la cocaïne. Principalement, au Brésil, qui consomme 100 tonnes de cocaïne par an et ensuite l’Argentine, même si nous ne savons pas quels sont les chiffres pour ce marché-là.

Gauchito Gil et la San la Muerte, deux figures populaires en Amérique Latine
Crédits : Sergio Serrano
Pourquoi la Bolivie est-elle un lieu central pour enquêter sur le crime organisé en Amérique latine ?
La Bolivie est pile au milieu de l’Amérique du sud ! Elle partage ses frontières avec l’Argentine et le Brésil, mais aussi avec le Péru qui est maintenant le premier producteur de cocaïne au monde, ayant dépassé la Colombie. La Bolivie est aussi un pays voisin du Chili, qui est un hub plutôt important et qui développe aussi son marché interne. Dernier facteur et pas des moindres : le pays borde le Paraguay, qui est le premier producteur de marijuana en Amérique du sud. De fait, la Bolivie est véritablement le centre de tout. Depuis la fermeture de la Drug Enforcement Administration en 2009, la Bolivie a perdu la majeure partie de son service de renseignement. Je pense que c’est un pays qui est désormais vulnérable, une proie pour le crime organisé à l’échelle transnationale.
Est-ce que la drogue est toujours à la source des organisations de crime organisé ?
La drogue a presque toujours été la première activité criminelle, et peut-être la plus rentable, en Amérique Latine. La Colombie, le Péru et la Bolivie sont des producteurs de cocaïne et cela ne pousse pas vraiment bien ailleurs dans le monde… alors ils ont une sorte de monopole, si on peut le dire ainsi, sur la coca. Cela dit, l’expansion du crime organisé lié à la drogue a donné naissance a d’autres activités criminelles. La meilleure illustration de cette dynamique est peut-être la Colombie. La première génération de cartels de la drogue colombiens, ceux qui se sont constitués autour de Cali, étaient exclusivement des exportateurs de cocaïne.
« Aujourd’hui, la troisième génération de cartels et de syndicats de la drogue, ceux que le gouvernement appelle les BACRIM pour Bandes criminales. »
La deuxième génération, le cartel Norte del Valle et le groupe paramilitaire United Self-Defense Forces of Colombia, a engendré 70 à 80 % de ses revenus grâce à la cocaïne, mais a entamé une diversification de ses activités, comme l’extorsion. Aujourd’hui, la troisième génération de cartels et de syndicats de la drogue, ceux que le gouvernement appelle les BACRIM pour Bandes criminales, groupes criminels, ne gagnent que la moitié de leur argent grâce à l’exportation de la cocaïne. Ils sont impliqués dans des tas d’activités criminelles, très diversifiées. Forage d’or illégal, prostitution, extorsion, paris, trafic humain… ils se sont mis en fait à ressembler de plus en plus aux mafias traditionnelles, qui pratiquaient toutes sortes d’activités criminelles, dès qu’elles pouvaient être lucratives, dans l’ère géographique qu’elles dominaient.
Pensez-vous que les leaders de ces nouveaux groupes s’appuient sur des antihéros, idéalisés par la culture populaire ?
Cela n’a pas été très médiatisé en-dehors de la Colombie, donc je doute que cela ait fait son chemin jusqu’à la France, mais il y a eu en Colombie une suite de séries télévisées, Pablo Escobar : El Patron del Mal, El Cartel de Los Sapos. On a alors accusé ces programmes télévisés sur la mafia d’avoir donné au crime un côté glamour et d’avoir incité des jeunes à s’engager auprès des nouvelles générations de mafiosi. À vrai dire, je ne saurais quoi penser de tout cela. Cela a sûrement mis l’histoire des mafias sous les projecteurs, mais toutes les trames narratives de ces séries avaient un dénouement négatif. Cela se terminait mal. Une fusillade sur un toit, le personnage meurt, tous les autres finissent en prison… Je ne peux pas croire que de telles séries puissent engendrer des files d’attentes de jeunes qui voudraient se lancer dans le crime organisé. Ce que cela a créé en revanche, sans aucun doute, c’est une forme de narco-culture. Cela se voit très bien au Mexique, avec ce que l’on appelle les narcorridos, les ballades de la drogue, des chansons dans lesquelles sont chantées les louanges des parrains. Il y a aussi le culte grandissant de Santa Muerte, la Sainte Mort, qui est associée au trafic de drogue. Donc oui, il y a une culture de la drogue, et oui, le crime a peut-être été rendu attirant par le cinéma, la télévision et la musique – mais c’est peut-être aussi une conséquence de la présence massive du crime organisé en Amérique latine.
Quelle est la journée typique, s’il y en a une, d’un reporter sur le terrain en Amérique du sud ?

La Santa Muerte
Crédits : Itzeloka
Vous sentez-vous souvent en danger ?
Nous avons des protocoles de sécurité très stricts. Par exemple, avant même que nous pensions à aller sur le terrain, nous faisons une analyse qui ressemble à celle que n’importe quel journaliste d’investigation doit faire avant de partir sur une enquête : qui allez- vous rencontrer ? À qui allez-vous parler ? Où allez-vous aller ? Quels sont les aspects de l’histoire que vous voulez traiter ? Cela dit, pendant ce processus, nous nous posons également une question supplémentaire : quels sont les risques ? Nous mesurons le niveau de risque que nous pourrions rencontrer dans tel ou tel scénario. Nous éditons un rapport de sécurité qui doit être remis à l’un des co-directeurs. Si je suis sur le terrain, c’est Steve qui regardera mon rapport de sécurité, et vice-versa. Nous voulons nous assurer que nous ne prenons aucun risque et nous nous creusons les méninges pour savoir à quel point nous pouvons réduire le risque. Nous avons pour cela quatre catégories de risque. La catégorie 3 est « Risque élevé » et la catégorie 4 est « Risque imminent ». Nous ne nous aventurons qu’en de très rares occasions dans des scénarios de catégorie 4. Parfois, nous sommes amenés à enquêter en catégorie 3, alors nous essayons de diluer le risque en utilisant des fixeurs sur le terrain ou en voyageant à deux. Nous sommes très vigilants quand il s’agit de la sécurité et nous essayons de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les risques.
En tant que journaliste, vous n’êtes pas considéré comme un touriste par les membres des cartels… agissez-vous sous couverture pour éviter d’être une cible ?
« Nous savons pertinemment que c’est un champ d’expertise dans lequel il est difficile de travailler et où il est encore plus difficile de faire parler quelqu’un. »
Nous nous identifions toujours très clairement. Nous ne faisons pas de travail sous couverture. La première raison est assez simple : malheureusement, même si j’essayais de toutes mes forces, je ne pourrai pas ressembler à un latino ! (rires). L’une de nos meilleures défenses est donc de dire clairement qui nous sommes et ce que nous faisons. Cela réduit le risque immédiatement, parce que les gens savent qui nous sommes et s’ils ne veulent pas nous parler, il ne nous parlent pas.
Est-ce que vos informateurs jouent un grand rôle dans vos enquêtes ?
Ce sont nos meilleurs éléments pour écrire une histoire oui, car la plupart de nos sources sont, elles, dans le monde de la criminalité. Par exemple, je reviens à peine de Santa Cruz où j’ai rencontré l’une de mes sources, un trafiquant de drogue bolivien : son témoignage est absolument extraordinaire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger son identité et pas seulement des forces de police, mais aussi de ses collègues. Nous savons pertinemment que c’est un champ d’expertise dans lequel il est difficile de travailler et où il est encore plus difficile de faire parler quelqu’un. Et quand vous avez développé une relation de confiance avec une source, vous devez faire tout ce que vous pouvez pour protéger cette source.
Investigation
Quelles sont vos relations avec les habitants des villes que vous parcourez ? Vous voient-ils comme un allié ou comme une source potentielle de problèmes ?
Cela dépend. Si je prends ce dernier voyage à Santa Cruz comme exemple, quelques hommes politiques locaux me voyaient comme un ami, particulièrement dans l’opposition, comme on s’en doute. Ils sont vraiment heureux que les problèmes de sécurités et les arcanes du crime organisé soient mis en lumière, parce qu’ils pensent que le gouvernement couvre tout cela. Compte tenu de cela, ils ne pouvaient pas être plus heureux à l’idée de me parler. Cela dit, la police, ou les forces de sécurité ne sont pas aussi éloquentes. Elles ne parlent pas de leurs problèmes. J’ai parlé à huit gradés de la police et seulement deux ont accepté d’être enregistrés. Ils ne me voient donc peut-être pas comme un ami…
Et avec les ambassades ? On imagine une sorte de relation amour-haine, vu qu’elles sont peut-être parfois votre dernier recours si la situation dégénère…
Pas tellement ! Nous avons une relation complexe avec les ambassades, à vrai dire. D’une part, elles sont une source de financement pour nous. Par exemple, l’ambassade de Suède au Guatemala nous a recruté pour mener une investigation sur l’élection du nouveau procureur général, déterminer s’il y avait des forces obscures qui entraient dans l’équation. L’ambassade anglaise a payé pour quelques investigations également, l’une d’entre elle devait montrer ce qu’il se passe à la suite d’un conflit, l’autre était une étude sur les nouveaux visages de la mafia colombienne.

La Catrina, l’une des figures les plus populaires de la fête des morts au Mexique
Crédits : Tomas Castelazo
Peut-on faire confiance aux niveaux de menace que les autorités donnent à propos de tel ou tel pays ?
Vous savez, la corruption est l’une des clefs du crime organisé. Les syndicats du crime cherchent à soudoyer la police, les agents des douanes. Ce sont les gens qui peuvent aider ou cacher leurs opérations. L’un des pays où il est difficile d’enquêter et où nous ne sommes pas très à l’aise, c’est l’Honduras, précisément parce que le niveau de corruption est très élevé. Vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance. Des fois, ce n’est pas à la police et peut-être même que les policiers sont les dernières personnes à aller voir. Crime organisé et corruption sont donc deux notions particulièrement intimes : l’une conduit à l’autre et un haut niveau de corruption rend notre travail encore plus difficile et risqué.
Vous avez un parcours atypique : avant d’être journaliste, vous étiez un officier dans l’armée anglaise. Qu’est-ce qui vous a conduit à l’investigation ?
Oui, j’étais un officier dans l’armée anglaise. L’un de mes derniers déploiements, c’était au cours de la guerre en Bosnie-Herzégovine. Ma mission, c’était de développer des liens avec les communautés locales de Bosniaques et les Croates dans la zone d’opération anglaise. On m’avait aussi demandé de faire des rapports à la presse internationale, comme un objectif secondaire, parce que j’étais sur le terrain et que je parcourais tous les jours pas mal de kilomètres, on avait décidé que j’étais le mieux placé pour donner des informations à la presse sur le conflit. Pendant cette période, j’ai rencontré beaucoup de journalistes. Dans le même temps, c’était une période très frustrante, en tant que soldat. Les règles d’engagement étaient très strictes… je voyais des gens criblés de balles ou abattus par des snipers à longue distance et je n’avais pas le droit de lever le petit doigt pour aider. Nous étions la force de protection des Nations Unies et nous ne protégions à peu près rien ni personne… Cela a été la raison principale pour laquelle j’ai quitté l’armée anglaise, et je me suis dit que, peut-être, en tant que journaliste, je pourrais avoir plus d’impact sur le réel que si j’étais un officier de l’armée.
Est-ce qu’il y a des choses que vous avez apprises lors de votre passage dans l’armée qui vous servent encore aujourd’hui ?
« J’ai appris là-bas à faire confiance à mon sixième sens, à savoir quand quelque chose ne paraît pas être comme d’habitude. Ce sont souvent des jugements basés sur la perception directe. »
Absolument ! Connaître la différence entre un tir de fusil, une explosion et un tir de couverture est particulièrement utile. Savoir quoi faire, quand vous êtes en danger, aussi bien du point de vue du correspondant de guerre que de celui de la défense personnelle. J’ai été en Irlande du Nord quand j’étais encore dans l’armée : c’est une expérience différente de la guerre. Cela vous apprend à être attentif à votre environnement. J’ai appris là-bas à faire confiance à mon sixième sens, à savoir quand quelque chose ne paraît pas être comme d’habitude. Ce sont souvent des jugements basés sur la perception directe. Pourquoi n’y a-t-il aucun enfant qui joue dans cette rue ? Pourquoi les fenêtres sont toutes fermées ? Toutes ces choses étranges que vous ne remarqueriez peut-être pas si elles ne vous étaient pas particulièrement familières. La compréhension de la hiérarchie militaire est aussi une bonne clef pour comprendre les groupes colombiens, les guérillas, les groupes paramilitaires et aussi, dans un sens, les trafiquants de drogue. Beaucoup d’oganisations de trafiquants de drogue recrutent d’anciens militaires ou d’anciens policiers. Leur manière d’opérer déteint sur l’organisation des trafiquants ou des groupes paramilitaires. L’exemple le plus extrême de cette tendance, c’est Los Zetas à Mexico. Un groupe qui a été formé par d’anciens militaires des forces spéciales mexicaines. Leur structure, leur formation et même l’organisation de leurs opérations ont pour source leur entraînement militaire.
Cela fait quinze ans que vous travaillez en Amérique latine. Avez-vous un lien particulier avec cette partie du globe ?
C’était un pur hasard ! J’ai commencé à travailler en tant que journaliste dans les Balkans, dès que j’ai eu mon premier contrat. Ensuite, je suis allé à Beyrouth, puis dans le Golfe, précisément dans les Émirats Arabes Unis. Et puis j’ai été expulsé de la région, on m’a dit de partir, parce que j’avais publié un article dont ils n’étaient pas très heureux. Je suis retourné à Londres et j’ai un peu travaillé au Daily Telegraph. Un jour, on m’a dit : « Ton expérience comme journaliste de guerre pourrait t’être très utile en Amérique latine. Est-ce que tu serais intéressé ? » Je n’y avais pas réfléchi avant. J’en ai un peu discuté avec d’anciens collègues de l’armée et d’autres des forces spéciales britanniques qui avaient été en Amérique latine et ils m’ont dit que j’étais fou. Mais j’y suis allé, en 1997… pour ne jamais partir !
Vous avez été aussi correspondant de guerre… quelle est la principale différence entre la couverture d’une guerre et l’enquête sur des cartels du crime organisé ?
Dans une guerre, la ligne de front est souvent claire. Quand vous êtes dans un contexte de crime organisé, il n’y a pas de ligne de front. C’est la différence la plus claire.
InSight Crime
InSight Crime a été lancé en 2010. N’avez-vous pas eu l’opportunité de créer ce média avant ? Qu’est-ce qui vous y a conduit ?
InSight Crime est né sur la terrasse de ma maison, à Medellín. En 2009, Steve était venu en Colombie pour interviewer des chefs de groupes paramilitaires en prison. Moi, j’étais en train de chercher des informations sur les FARC et nous pensions préparer deux articles très intéressants. Cela dit, en 2010, les journaux s’étaient effondrés et les bureaux à l’étranger fermaient petit à petit. Il n’y avait plus d’argent pour l’investigation et l’appétit pour l’actualité étrangère était devenu de plus en plus faible. Nous n’avons pas trouvé de média qui auraient pu mettre en valeur ces histoires. C’était assez déprimant pour un correspondant étranger, surtout que le Daily Telegraph, avec qui je travaillais, faisait des coupes nettes dans mes textes et payait de moins en moins, tout en me laissant toujours moins de temps pour rendre mes articles. Alors imaginez deux journalistes qui se rencontrent à cette époque et qui se demandent ce qu’ils aimeraient bien faire s’ils en avaient l’occasion…

Santa Muerte
Crédits : Dierk Schaefer
Connaissez-vous votre lectorat ?
Oui ! Nous regardons Google Analytics et à peine plus de la moitié de nos visites viennent des recherches Google. Par exemple, si vous tapez FARC ou cartels colombiens sur Google, nous avons tendance à apparaître dans le top 10 des résultats. L’autre moitié de notre trafic vient de nos clients et de nos visiteurs, qui ont différent profils : des employés du gouvernement, des chercheurs, des étudiants… et puis bien entendu, il y a une grosse masse de lecteurs qui est simplement fascinée par ce qui se passe en Amérique latine. Tous les profils sont concernés et même si le site anglais est notre principale source de revenu, la version espagnole commence à agréger des visiteurs. Nous espérons que cela continue dans cette voie !
Quelles sont vos relations avec le Center for Latin American and Latino Studies ?
Steven habite à Washington et son bureau est à l’université. Eric Hushberg, qui est le directeur du centre d’étude sur l’Amérique latine a été l’un de nos plus précieux alliés, depuis le début. Quand nous nous sommes installés, il est venu nous voir et nous a dit que le projet était fascinant et nous avons fait plusieurs investigations en collaboration avec son université. Il nous voit comme des partenaires.
InSight Crime a récemment publié un dossier colossal sur les FARC. Comment expliquez-vous la résilience de ce groupe et le fait que les médias continuent de s’y intéresser ?
« La croissance des FARC a été intimement liée au trafic de drogue en Colombie, et c’est comme cela qu’ils ont commencé à gagner de l’argent. »
Comment les FARC ont-ils survécu pendant 50 ans ? C’est une bonne question… dans notre dossier, l’un des articles s’intitule « Les FARC et la drogue sont des frères siamois ». Vous ne pouvez pas expliquer la durabilité du mouvement sans expliquer avant cela le commerce de la drogue. Leur croissance la plus fulgurante a eu lieu dans les années 1980 quand le trafic de la cocaïne s’est enraciné en Colombie. Ils ont menacé l’État dans les années 1990 quand la Colombie est devenu le plus grand producteur de cocaïne. La croissance des FARC a été intimement liée au trafic de drogue en Colombie, et c’est comme cela qu’ils ont commencé à gagner de l’argent. C’est cela qui leur a permis d’acheter 10 000 AK-47 et de les faire parachuter dans la jungle, de recruter et d’entretenir une armée qui a pu compter 20 000 soldats. L’intérêt pour les FARC a depuis beaucoup baissé : peu de médias en réalité s’intéressent aux FARC : cela nous laisse le champ libre.
Pensez-vous qu’il y a des zones dans le monde qui restent très mal couvertes par le journalisme d’investigation ?
Quelque chose que l’on a compris aujourd’hui, c’est que le journalisme d’investigation ne paie pas… il a besoin d’être subventionné. Les journaux n’ont plus l’argent pour financer du journalisme d’investigation à grande échelle. Les institutions comme InSight Crime, qui s’appuient sur des subventions et des contrats sont peut-être le premier pas vers le futur de la profession. Je l’espère en tout cas. Je pense que si le journalisme d’investigation disparaît, la balance des pouvoirs en démocratie disparaît également. Et pour répondre à la deuxième partie de votre question… je pense que l’Amérique latine n’est pas bien suivie par les médias. Quand avez-vous lu un article sur la Bolivie pour la dernière fois ?
Couverture : Copacabana, par Anthony Letmon.