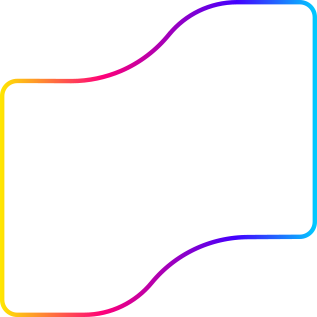Un grand frère
Une file interminable campe chaque saison entre les grandes façades en briques qui bordent la rue Lafayette, à New York. Après avoir attendu des heures voire des jours sur le trottoir de cette artère commerciale de Manhattan, plusieurs centaines de jeunes avancent, centimètre par centimètre, vers l’oriflamme rouge qui flotte au-dessus du numéro 274. Leur pénible procession se termine devant une baie vitrée aux dormants noirs d’à peine cinq mètres de largeur. Du moins, quand tout se passe bien. À chaque nouvelle collection Supreme, l’attroupement menace de déborder sur la chaussée ou de dégénérer en pugilat comme pendant un Black Friday. La police anti-émeute s’est même déployée aux abord de la boutique le 3 avril 2014, lors de la sortie d’un modèle de baskets élaboré avec Nike. En février 2016, un adolescent avait à peine passé la porte qu’il se faisait frapper et voler ses achats. Mais tout le monde ne fait pas le déplacement à perte. Quelques revendeurs se mêlent patiemment aux acheteurs dans le but à peine dissimulé de spéculer sur la rareté des produits. « Je les paye environ 100 dollars pour une journée de queue, peu importe le temps qu’il fait », confie Peter, le responsable de Unique Hype Collection, un magasin de Chinatown. Dès que de nouveaux produits sont lancés, c’est-à-dire presque chaque jeudi, le trentenaire engage entre 10 à 30 adolescents. Il est sûr de pouvoir écouler ce stock au Japon, la demande excédant généralement l’offre.
« Si je sais que je peux vendre 600 pièces, je vais en fabriquer 400 », admettait le fondateur, James Jebbia en 2009. D’ordinaire mutique, ce quinquagénaire né en Angleterre avait accordé un rare entretien à un ami, le journaliste culturel et voisin de la boutique, Glenn O’Brien, décédé le 7 avril 2017. Installé avec sa femme et ses deux enfants dans un loft de Greenwich Village, Jebbia est aussi riche qu’avare de mots.
En 2012, sa fortune était estimée à 40 millions de dollars. « Le moins on en sait, mieux c’est », estime-t-il. Ses employés ont ainsi un mot d’ordre : on ne sort de l’ambiguïté qu’à ses dépens. Le gérant de l’enseigne parisienne « ne communique jamais à la presse », fait savoir un vendeur. Skateur réputé sur les rampes parisiennes et créateur de la marque de planches Minutia, Samir Krim dirige discrètement l’équipe du 20, rue Barbette, dans le Marais, depuis qu’elle a été mise en place le 10 mars 2016. Jebbia compte sur lui : « Si on ne connaissait pas quelqu’un comme Samir, on n’aurait pas ouvert un magasin à Paris », avait-il lancé lors de l’ouverture, en omettant de préciser que la capitale française est la ville où ses produits se vendent le mieux sur Internet après Londres. Le jour de l’inauguration, les adeptes s’étaient munis de fauteuils pliants et de patience pour renouveler leur garde-robe aux côtés de personnalités aussi diverses que les créateurs de mode Rick Owens et Kris Van Assche, les actrices Chloë Sevigny et Axelle Laffont, et les producteurs de musique Pedro Winter et Gildas Loaëc. L’animation était assurée, plus tard, par Cam’ron et PNL dans la boîte Le Balajo. Pour l’ancien brand manager, Angelo Baque, « Ralph Lauren a Ralph Lauren, Tommy Hilfigher a Tommy Hilfigher », tant mieux pour eux. « Nous voulons que Supreme soit sur le devant de la scène quand vous pensez à Supreme. C’est la clé pour que la marque traverse les époques. »
Par chance, elle n’est pas toute seule à faire le voyage. Il y a bien longtemps que ses vêtements de skate s’affichent sur les podiums et dans les clips de musique. Kate Moss, Kanye West, Frank Ocean, Lou Reed, Lady Gaga, Mike Tyson, Morrissey, Neil Young, Justin Bieber et même Kermit la Grenouille portent fièrement le rectangle rouge. Avec de tels ambassadeurs, James Jebbia et Samir Krim n’ont pas besoin de se mettre en avant. Comment un concept venu de la rue est-il parvenu à rallier à lui les stars de la pop ? Si Jebbia vante la qualité intrinsèque du textile, son succès repose surtout sur un phénomène de « frustration positive », dixit Pascal Monfort, responsable du marketing de marque à REC. C’est-à-dire que le désir est aiguisé par des articles aussi rares que ceux du monde du luxe, vendus à des prix abordables. Des gants de boxe à la batte de base-ball en passant par la boîte en forme de Bible, le cendrier ou le marteau, on ne compte plus les éditions limitées. « Cela joue sur un fétichisme de collection », estime un fan parmi les fans, David Shapiro. Afin de mieux expliquer ce qui l’a rendu accro, l’avocat américain prend une autre métaphore : « C’est comme un grand frère qui vous guide dans un univers qu’il considère important, pas simplement pour vous vendre quelque chose mais parce qu’il pense que ça vaut le coup. »
L’an dernier, Shapiro a publié un roman pour expier sa passion, Supremacist. Cette introspection sur son amour contrarié pour le cadre rouge passe par tous les points de vente officiels : New York, Los Angeles, Londres, Paris et six villes japonaises. Sauf accord ponctuel, personne d’autre n’est habilité à le mettre en rayon. « Quand j’étais étudiant », écrit-il, « j’avais peur de rentrer dans la boutique de New York. S’ils pensaient que vous n’étiez pas le genre de personne qui devait porter du Supreme, les vendeurs vous regardaient comme si vous étiez une merde de chien. J’ai adoré. Ils se mettaient derrière les clients et tapaient sur leur épaule pour chuchoter : “Pas touche avant d’acheter.” Je ne pense pas qu’ils continuent de faire ça, mais leur regard porte le même message : “Tu veux que je t’aide, putain ?” » Le début du culte.
Kids
James Jebbia n’a pas toujours été aussi discret. Installé au milieu des magasins de meubles et des bâtiments condamnés de la rue Lafayette en 1994, le jeune patron envoie du Slayer, Wu-Tang Clan, Black Sabbath ou Public Enemy à la tête de ses premiers clients. « À l’époque,, le Pop Shop de Keith Haring est le seul détaillant de la rue », rappelle le skater et écrivain Ross Wilson. Tout ce que le quartier compte comme amateurs de boards se retrouve là pour écouter du rock et regarder les meilleurs enchaîner des tricks à la télé. « Ce n’était pas encore cool », précise Alex Corporan, manager de 1995 à 2003. Un public moyennement intéressé par les accessoires Zoo York ou Spitfire proposés. « Au départ, on n’a pas vraiment gagné d’argent », indique Jebbia. Corporan se souvient d’une ambiance familiale entre skaters. Le fondateur n’a lui-même jamais pratiqué assidûment. Fils d’un pilote de l’US Air Force et d’une institutrice britannique, il grandit dans le Sussex, au sud de l’Angleterre. Son intérêt pour la mode se forge à la lecture de magazines comme The Face et i-D et redouble devant les vitrines londoniennes. Mais celles de New-York ont quelque chose en plus. Au retour d’une visite à son père, installé en Virginie-Occidentale après avoir divorcé, Jebbia décide de louer un petit appartement à Staten Island pour 500 dollars par mois. D’abord vendeur de vêtements pour Parachute, il atterrit ensuite au marché aux puces de Sprint Street pour finir par créer son enseigne, Union. On y trouve les accessoires de glisse de Shaw Stussy, dont la mise en retrait pousse Jebbia à imaginer sa propre griffe. L’affaire est lancée pour 12 000 dollars d’investissement.
Attribué à la chanson de John Coltrane « A Love Supreme » (1964), le nom « n’était pas censé devenir une marque », avoue son créateur. « Nous nous sommes simplement dit que c’était cool pour un magasin. » Ce dernier devient l’épicentre de la tornade skateboard à venir. « Nous faisions partie d’une scène incomprise composée d’un tas gosses aux origines multiples », se souvient Corporan. « Nous partagions tout dans une espèce de cercle de confiance, c’est tout ce que nous avions. Personne ne nous aimait vraiment ni ne faisait attention à nous. » Personne sauf Larry Clark. Muni de son appareil photo, le jeune réalisateur suit les planches de Mark Gonzalez et fréquente les mêmes spots que Justin Pierce, Harold Hunter, Hamilton Harris, Gio Estevez. En 1995, il sort Kids, film légendaire sur le milieu et la jeunesse new-yorkaise des années 1990. Sexe, alcool, drogue et glisse nourrissent cette ode à son hédonisme fraternel et destroy. Alex Corporan participe au casting. « J’ai associé la marque à l’ambiance du film », se souvient le peintre français Lucas Beaufort, auteur d’un documentaire sur les magazines de skate, Devoted. Leo Fitzpatrick, l’acteur emblématique de Kids, collabore de longue date avec Supreme. « Si j’ai une fringue Supreme, je la porte. Je la porte jusqu’à la mort », avoue-t-il. Imitant ces adolescents qui s’approprient la rue, James Jebbia amorce une guérilla marketing à coup d’autocollants sur les murs de la ville. Le logo, inspiré du propaganda art de Barbara Kruger, est placardé un peu partout.
Dès 1994, il se retrouve sur les pubs Calvin Klein à l’effigie de Kate Moss, ce qui vaudra un procès médiatisé à Supreme. « Nous portions tous un t-shirt ou un pull siglé du rectangle rouge », raconte Corporan. « Les gens se demandaient qui nous étions. » Attiré par ce bout de hype, les touristes nippons le ramènent dans leurs bagages. Jebbia sent le bon coup. « Je me suis rendu compte qu’au Japon, si quelqu’un de réputé aime telle ou telle chose, elle devient très populaire », dit-il. « Certaines personnes influencent vraiment la société. » Il ouvre trois boutiques sur l’archipel, à Tokyo, Osaka et Fukuoka. Mais l’enseigne touche le grand public américain en 2002, à la faveur d’une collaboration avec Nike. « Toute la culture des sneakers a vraiment changé la typologie des gens qui venaient à la boutique », explique Alex Corporan. Pour maîtriser la foule qui commence à s’amasser sur le trottoir de la rue Lafayette, les quatre vendeurs gardent une batte de baseball derrière le comptoir. « Nous ne nous en sommes jamais servi, mais elle a été sortie quelques fois », se marre Corporan. Victime de son succès, l’équipe doit engager un service de sécurité et composer avec des revendeurs sans scrupules. Certains modèles sont gardés dans l’arrière-boutique pour éviter aux initiés de les acheter à un prix exorbitant, la nuit, sur eBay. Au milieu des années 2000, ils ne sont plus seulement dessinés par les graffeurs Rammellzee et Martha Cooper, mais aussi par des artistes plus iconiques à l’instar de Peter Saville, auteur des pochettes de New Order et Joy Division, et Roy Lichtenstein, star du pop art. Des célébrités de plus en plus énormes s’associent à la marque à l’occasion de ses campagnes de pub. Après les rappeurs Raekwon et Ghostface, en 2005, et The Diplomats, l’année suivante, apparaissent Mike Tyson (2007), Lou Reed (2009) et Lady Gaga (2011). Supreme délaisse les rampes pour les feux de la rampe.
Obsession
Le virage emprunté par Jebbia dans les années 2000 est somme toute assez conforme à la trajectoire imprimée dès les débuts. En faisant de sa marque un acteur de la rue, il l’a mâtinée de culture populaire. L’un des premiers t-shirts vendus rue Lafayette porte une photo de Travis Bickle, le protagoniste à la crête du film de Martin Scorsese Taxi Driver (1976) ; et en 1998, le célèbre dessinateur Keith Haring apporte également sa patte. Affublée du cadre rouge en 1994, Kate Moss apparaît sur la collection dix ans plus tard, avant de finir, passée une autre décennie, par travailler officiellement pour la marque. La même audace s’avère payante avec Louis Vuitton.
En 2000, une planche de skate vendue par Supreme reprend le fameux monogramme de la maison du luxe française. Laquelle la sanctionne immédiatement par une lettre menaçante réclamant que tout soit brûlé. En tant qu’enseigne « relativement jeune et indépendante », Supreme a retiré le produit, se remémore son avocat, Jeff Gluck. Mais les deux entités se retrouveront pour finir associées en janvier 2017, au cours d’un défilé au Grand Palais de Paris. Admirateur de la planche réalisée par Larry Clark en 1995, le fameux plasticien Jeff Koons en donne sa version en 2006. Suivront Damien Hirst, Takashi Murakami, Marylin Minter, Robert Longo et George Baldessari. « C’est important pour nous de travailler avec de grands artistes mais autant que de le faire avec des gens que personne ne connaît », relativise James Jebbia. « Nous devons conserver un équilibre pour ne pas que les gens se disent : “Oh, ils font juste des trucs haut-de-gamme.” » Certains designers sont étonnés en voyant le prix relativement peu élevé de leurs œuvres par rapport à ce qu’ils ont l’habitude de vendre. « Nous savons que nous pourrions en augmenter le coût mais nous voulons que les jeunes puissent les acheter », vante le quinquagénaire.
Pour un adolescent modeste comme Lucas Beaufort, elles restent toutefois trop chères. « Je préférais mettre mon argent dans les planches classiques et les voyages », dit-il. Quand il passait par la rue Lafayette, David Shapiro ne pouvait quant à lui pas se contrôler : « J’ai d’abord été attiré par l’atmosphère un peu spéciale et j’ai commencé à accumuler les produits. C’est devenu une obsession. Je me disais souvent : c’est vraiment stupide, pourquoi est-ce que je fais ça ? » Comme beaucoup, l’avocat a du mal à expliquer sa passion. Tout ce qu’il sait, c’est que les campagnes emblématiques de Terry Richardson sont soigneusement réalisée. Passé par Vogue et Gucci, le photographe donne une touche plus lascive au cadre rouge.
En 2012, il expose pour la première fois seul à la galerie OHWOW, un an après le passage de Supreme. Le magazine pour lequel il travaille par ailleurs, GQ, parle de la marque de James Jebbia comme de « la plus cool dans le monde du streetwear ». Lors des MTV Music Awards, le rappeur Tyler The Creator évoque « un petit club, une société secrète ». Au contraire de « la plupart des sociétés qui essayent de grandir le plus possible, Supreme n’essaye pas d’être présente dans chaque magasin au monde », observe Gleen O’Brien. « C’est une entreprise qui ne se vend pas. » En revanche, elle aime échanger. Après avoir collaboré avec The North Face, Playboy, Dr Martens, Levi’s, Van’s ou encore Timberland, Supreme a sorti une collection avec Duralex en mars 2017. Semblables en tout point aux verres classiques, ceux qui portent son logo sont vendus près de dix fois plus cher. Pour expliquer cette curieuse association, le directeur marketing et commercial de l’entreprise française, Frédéric Morin-Payé, avance qu’ « aux États-Unis, nous vendons dans des enseignes plutôt haut-de-gamme ». Sollicité par les équipes de James Jebbia, le groupe y a vu l’opportunité de rajeunir son image. « Notre belle marque s’est un peu endormie sur ses lauriers, ajoute-t-il. « Nous comptons bénéficier du positionnement plutôt jeune et urbain de Supreme et élargir notre base de consommateurs. Cela nous permet aussi d’être présents dans un canal de distribution sélectif. » Le même mois, Supreme a lancé des produits en lien avec Lacoste, Comme des garçons et aujourd’hui sur le thème de Michael Jackson.
Parti en 2003 pour devenir le responsable du marketing de la marque de skate Ethnies, Alex Corporan juge l’évolution de Supreme « assez extraordinaire ». Il mesure le chemin parcouru : « Nous sommes partis de zéro. Ce n’était qu’un groupe de gosses et c’est maintenant réclamé partout dans le monde. » Depuis Greenwhich Village ou les podiums de mode, ledit groupe de gosses peut contempler la nouvelle génération se bousculer aux abords des magasins pour s’offrir la dernière collection ou en faire commerce sur Internet. Supreme ne se vend pas mais d’autres s’en chargent.
Couverture : Kermit X Supreme. (Terry Richardson)