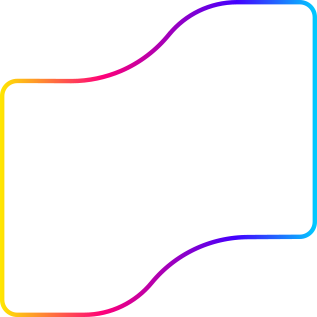Origines
Comment est née l’idée du SeaOrbiter et comment s’est-elle concrétisée ?
Le SeaOrbiter est une démarche de projet, de réalisation et de vécu que nous avons eue il y a plus de trente ans. Il se trouve que l’exploration du monde sous-marin à travers Vingt mille lieues sous les mers a fait rêver depuis cent ans un certain nombre de générations ; cinquante ans après, Cousteau a réalisé le rêve de Jules Verne de vivre sous la mer, en réalisant la première maison sous-marine. Puis la deuxième, puis la troisième. Moi, je me suis trouvé au bon endroit, à ce moment-là. Cela m’a porté, cela m’a fait rêver et cela m’a amené à vivre ma passion en même temps que ma vie professionnelle, la mer et l’architecture. Pendant trente ans, j’ai moi-même eu la chance de pouvoir réaliser des maisons sous-marines : Galathée ou Hippocampe Un et Deux qui se trouvent au Mexique. J’ai pu aussi faire la Seascope, un trimaran avec la coque centrale transparente avec lequel j’ai traversé l’Atlantique sous la mer, pour suivre la migration des baleines et des tortues. J’ai été accompagné par de belles personnes, Jacques Piccard, Cousteau… C’est comme cela que progressivement, il y a dix ans, avec Jacques Piccard, nous nous sommes dits qu’après la traversée de l’Atlantique, il fallait aller plus loin. Il fallait imaginer un engin de nouvelle génération avec toutes les technologies que l’on connaissait et que l’on avait expérimentées nous-mêmes – j’ai fait le plus long séjour sous la mer, soixante-et-onze jours dans une maison sous-marine. Il fallait entrer dans des paradigmes différents d’imagination d’engins du futur.
C’est comme cela que l’on a eu l’audace de dire : « Il faut faire un bateau à la verticale. » Et c’est ainsi que sont nés les premiers dessins du SeaOrbiter. Le programme que je voulais, c’était maintenir un équipage d’hommes et de femmes sous la mer vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur des longues durées. Il s’agit de regarder dans cette première couche d’eau où la lumière pénètre et de pouvoir sortir de cet engin d’une façon extra-véhiculaire, soit en scaphandre autonome, soit avec un sous-marin. Ou envoyer des abeilles butiner : des sondes qui viendraient chercher des informations pour les ramener au cœur du dispositif. Après cela, il a fallu lancer le projet, convaincre des gens. Beaucoup sont sceptiques, beaucoup d’autres sont généreux. Cela s’est mis en place progressivement. Il fallait trouver de l’argent pour terminer les études et les essais en bassin des carènes, créer un consortium industriel autour du SeaOrbiter, fonder un conseil scientifique avec des chercheurs américains, etc.Les tests au quinzième ont d’ailleurs été réussis. Quelle est l’importance de cette étape dans la réalisation d’un projet comme celui-là ?
C’est capital : entre la théorie et la pratique, il y a un monde, même si grâce aux logiciels actuels, on arrive à approcher le plus possible de la réalité par des calculs fins de stabilité. Rien ne remplace pourtant le vécu en mer. On a beau faire des tests, puis des calculs : la réalité va souvent au-delà. Nous avons eu la chance que le Marintek, le plus grand centre de simulation marine d’Europe situé en Norvège, ait été notre partenaire et qu’ils fassent une maquette au quinzième, que nous avons expérimentée sous toutes conditions de mer. Cela a donné une crédibilité au projet : quand le Marintek dit qu’un engin est crédible, personne ne peut aller contre cet avis.
Avez-vous dû modifier votre idée initiale ?
Nous l’avons affinée. Ils n’ont pas modifié le SeaOrbiter, mais ont par exemple augmenté le disque de surface pour des questions de stabilité. La quille existait, mais ils en ont proposé une avec un bulbe ; ils ont ajouté deux systèmes de flaps latéraux pour stabiliser l’engin. De même, ils ont proposé des capteurs de houle à l’intérieur du disque. Ils ont amené une expertise pour le rendre encore plus performant. Les grandes lignes y étaient, cela dit, et il n’y a pas eu de modification majeure.
Habitat océanique
On a l’impression que la mobilité est très importante lorsque l’on parle d’habitat sous-marin. Est-ce qu’une fois que l’on est sous l’eau, il n’est plus possible d’être sédentaire ?
Il y a deux choses qu’il ne faut pas confondre. Les maisons sous-marines sont indispensables, mais nous sommes sédentaires. La maison sous-marine permet l’observation dans un territoire donné relativement limité et de vivre en osmose avec le monde sous-marin. Elles sont utiles à la recherche. Une maison mobile sous-marine n’a strictement rien à voir. D’abord, nous sommes dans la grande masse océanique : nous perdons le point de référence du sol sous-marin. Nous sommes au-dessus des abysses et nous naviguons dans les grands courants océaniques. C’est une autre aventure. Nous sommes dans deux mondes différents, deux dimensions d’exploration différentes. C’est comme être autour de la Terre dans une station orbitale ou aller dire : « Je pars dans le cosmos voir ce qu’il s’y passe ! » Ce ne sont pas les mêmes enjeux, les mêmes risques, la même organisation… Avec le SeaOrbiter, nous partons sur une aventure beaucoup plus complexe qu’une maison sous-marine.
Comme vous partez pour une période plutôt longue, est-ce que l’intérieur de l’engin est prévu pour structurer la vie sociale, collective ?
Oui, je l’espère ! L’équipage sera sélectionné en fonction de différentes qualités, et savoir vivre en groupe sur de longues durées dans des conditions extrêmes et complexes en est une. Mais c’est aussi une expédition de plaisir. D’audace, mais de plaisir ! Il faut que les gens savent pourquoi ils y vont, nous ne sommes pas des kamikazes. Les moments seront inoubliables, mais cela sera difficile. Pour vivre sur la mer pendant de longues durées, il faut des moments de tendresse, des moments de poésie, des moments de musique, des moments artistiques.
« Quand vous prenez la Terre, son océan planétaire représente 71 % de la surface. Ce que les gens ne savent pas, c’est que 3,5 kilomètres, c’est l’épaisseur moyenne de l’eau sur la planète. »
Il y aura par exemple un orgue sous-marin, des artistes qui accompagneront le projet, pour exprimer leur art de différentes façons. Tout cela est prévu : ce n’est pas qu’une expédition scientifique. C’est un peu l’esprit La Pérouse des temps modernes : on fait une expédition et nous amenons naturellement des artistes qui observent des phénomènes jamais observés. Un musicien va créer une musique spécifique à cette aventure. Il ne faut pas qu’il n’y ait que les scientifiques qui traduisent ces phénomènes : il faut qu’une personne, dans un autre domaine de transcription et de codes puisse traduire des émotions et montrer que la mer est un univers qui s’ouvre à l’humanité. Elle est un bien commun, mais sa découverte n’en est qu’à ses balbutiements. Ce n’est pas avec la technologie pure et dure que nous pouvons intéresser les générations futures. C’est avec une haute technologie très complexe, des scientifiques de très haut niveau et en même temps, un accompagnement artistique et poétique que nous pouvons le faire. SeaOrbiter, dans sa forme architecturale, découle d’une réalité programmatique, technologique, mais il y a un petit plus que j’ai voulu : cette symbolique de ce que représente SeaOrbiter, dans son allure de sentinelle, son allure bionique. Il y aura donc le scientifique et le musicien, c’est un tout. Si vous voulez que les jeunes se passionnent, il faut qu’ils se sentent concernés : il est donc nécessaire de créer une émotion. Certains vont se prendre au jeu, créer de nouvelles technologies qui vont apporter du bien aux hommes et à la nature. La technologie n’est pas incompatible avec l’environnement, contrairement à ce que l’on a pu croire à un moment. Cela a failli être le cas, mais elle prouve aujourd’hui qu’elle peut-être au contraire au service de l’environnement. (Il montre les smartphones utilisés pour enregistrer l’entretien.) Je crois beaucoup en ces engins venus de l’espace ! Nous avons oublié cela, mais s’il n’y avait pas eu la conquête spatiale et un président qui souhaitait aller sur la Lune, nous n’aurions pas ces appareils. La mer va offrir cela, elle aussi.
Pensez-vous que la mer est le nouvel horizon de l’exploration aujourd’hui ?
C’est même le dernier espace qui reste et il est d’une dimension colossale. C’est cela qui est génial : quand on parle de la mer, ce n’est rien comparé au monde océanique, sous-marin. Le terme « mer » est souvent synonyme de « surface », alors que la réalité, c’est que la mer est une masse aquatique. Quand vous prenez la Terre, son océan planétaire représente 71 % de la surface. Ce que les gens ne savent pas, c’est que 3,5 kilomètres, c’est l’épaisseur moyenne de l’eau sur la planète. Quand vous voyez un volume d’eau de 3,5 kilomètres de hauteur moyenne sur 71 % de la planète, vous commencez à vous poser des questions. C’est gigantesque. Dans cette masse d’eau, qu’est-ce que l’homme a pu observer ? Presque rien. Le génie humain a permis de faire des engins pour aller voir sous l’eau, mais cela date d’il y a à peine un siècle ! Nous n’avons encore rien fait ! Cela signifie qu’il y a tout à découvrir.
Quand vous parlez d’une expérience qui mêle art et technologie, on trouve les deux mots qui forment le terme de « science-fiction ». Est-ce qu’elle est d’une grande influence pour vous ?
Cela ne peut pas être autrement, l’homme ne peut pas avancer sans la fiction. Prenons la conquête spatiale : il est clair qu’au début, on a demandé à des surhommes comme Gagarine de faire le voyage. Ce n’étaient pas des kamikazes, mais appelons un chat un chat, c’étaient des individus qui considéraient qu’ils étaient honorés d’être les premiers dans l’espace et que cet honneur valait la peine de risquer leur vie et de mourir éventuellement pour cette cause. Il y a des gens comme cela. Après le premier, les autres sont toujours un peu différents. Ce sont des explorateurs. Maintenant, la conquête spatiale est autre. Il y a des gens qui viennent du monde de la science, mais les Russes ont compris par exemple que pour aller sur Mars, il fallait aussi envoyer des cosmonautes artistes. Quand vous vivez un an dans l’espace, si vous voulez maintenir des femmes et des hommes, il faut se rendre compte que l’on n’a pas que des superwomen et supermen. Ce sont des gens qui ont des besoins, qui sont sensibles à tout ce qui est artistique. Il ne faut pas le sous-estimer. Envoyer Jean-Loup Chrétien dans l’espace, ce n’est pas parce qu’il est musicien, mais c’est tout de même un petit plus. Il a joué de l’orgue dans la station Mir. Alexeï Leonov, le premier piéton de l’espace, a fait de la peinture dans l’espace parce que c’était important d’accompagner ces découvertes par l’art. L’art accompagne toujours l’évolution de l’humanité. Tous les livres de science-fiction le montrent, toutes les prospectives le montrent. Par moment, le côté conquérant pur et dur ne s’embarrasse pas de la sensibilité artistique, mais très vite, si vous voulez une permanence de l’homme quelque part, il faut un accompagnement artistique. C’est dans nos gênes : une tribu humaine ne survit pas sans cela. Ce n’est pas ma théorie, c’est une réalité historique ancestrale, anthropologique.

Seaspace, maison sous-marine
Crédits : Jacques Rougerie
Quand on pense à ce genre d’exploration, on pense beaucoup à la solitude que les humains pourraient ressentir. Avez-vous pensé à une multiplication des SeaOrbiters et à une éventuelle rencontre autour de votre vaisseau amiral, La Cité des Mériens ?
Oui, il faut une flotte de SeaOrbiters, parce qu’il faut ausculter l’ensemble de l’océan planétaire – donc des océans, si l’on suit la nomenclature traditionnelle qui les divise. Il faut différents SeaOrbiters dans chaque partie des océans, pour qu’ils entrent en réseau. Les masses d’eau, c’est comme les masses d’air : elles se déplacent. Pour bien connaître tous ces paramètres, il nous faut un réseau planétaire. Le but des sentinelles de la mer, c’est de créer un réseau planétaire. Mais commençons par déjà réaliser la première !
Et avez-vous pensé, dans leur architecture même, à permettre une interaction entre les sentinelles ?
Non, car ce n’est pas utile. Jamais ces habitations mobiles ne se rencontreront autrement que par un système de réseau de communication internet. Elles ne seront pas en contact. Le but n’est pas d’avoir deux SeaOrbiters qui se rencontrent physiquement, visuellement. Ils seront en revanche en liaison les uns et les autres, en temps réel. Si jamais pour une raison ou une autre, les deux SeaOrbiters de l’océan Atlantique décident de se retrouver à l’équateur pour un événement, comme une Exposition universelle dédiée aux océans ou les Jeux olympiques, nous le permettrons, oui. C’est possible mais ce n’est pas dans leur ADN.
Sur terre, vos bâtiments sont souvent le prolongement ou l’accentuation d’un fait géographique. Reproduisez-vous cette sensibilité sur mer ?
Tout à fait. Il suffit d’observer les différentes sociétés et cultures et de comprendre comment elles traduisent le phénomène social de l’habitat et de l’urbanisme : ce qui a fait la beauté dans beaucoup de cas, c’est la diversité architecturale qui était adaptée à un lieu précis et une population précise. C’est vrai que depuis un siècle, paradoxalement, il y a eu un courant qui a souhaité faire une architecture identique à Tokyo, à Moscou ou à Paris, peu importe, quels que soient les lieux ou les climats. Heureusement, cela cesse un peu aujourd’hui. Il y a encore un reliquat, mais grâce au développement durable, à la technologie, aux génies des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui sont attachés au côté culturel tout en ayant une vision planétaire, suivant le lieu géographique et par nécessité vitale d’économie, l’architecture sera de plus en plus adaptée de façon cohérente par rapport à un lieu géographique, climatique et sociétal. L’informatique va permettre d’accompagner énormément les architectes pour mettre au point cette diversité architecturale, pour l’intégrer dans un tissu international. C’est cela qu’on est en train de mettre en place, même si on en est encore un peu loin. C’est cela qui naît sur la planète et que j’ai la chance de pouvoir ressentir quand je parcours le monde : cette diversité architecturale adaptée à son environnement est en train d’apparaître.
Architecture subaquatique
En tant qu’architecte, dans votre travail, à quel moment faites-vous intervenir les contraintes inhérentes au lieu dans lequel vous souhaitez penser une structure ?

Le SeaOrbiter
Crédits : Jacques Rougerie
Vous avez aussi modifié des structures déjà existantes, comme la plateforme off-shore qui a servi de base à votre projet Aquapolis. Pensez-vous que le matériau que l’homme laisse derrière lui est toujours réutilisable ?
C’est encore une autre démarche, celle de dire : « Attention au gâchis ! » Des tas d’étudiants et de jeunes adoptent cette démarche, je ne suis pas le seul. Il y a des équipements off-shore qui pour telle ou telle raison ont été créés par nécessité, puiser du pétrole ou faire des usines flottantes, comme la structure d’Aquapolis au Japon qui était une usine construite pour la transformation de la pâte à papier. Cette usine a été mise à l’abandon : il s’agissait alors de profiter du fait que c’était idiot de la démanteler, notamment parce que cela coûtait très cher. Pourquoi ne pas la transformer, vu ce qu’elle représente ? C’est 100 mètres par 100 mètres, 45 mètres de haut sur un plateau : c’est considérable ! C’est un hectare. On doit se demander si l’on peut faire un hôtel sous-marin, un centre de recherche océanographique… On peut trouver plein d’idées. Nous étions partis avec les Japonais sur un concept de ce genre.
Vous pensez que le Japon est un pays qui a de l’avance sur ces considérations ?
Ils ont une volonté. Kikutake, Tange et d’autres que j’ai côtoyés quand j’y ai vécu ont œuvré dans ce sens-là. Ils ont une culture très proche de la mer. Les Japonais ne vivent pas en montagne. Leur culture et leur religion les ont amenés vers le bord de mer. Ils ont appris à s’adapter avec les conséquences des tsunamis, des tremblements de terre. Leur rapport à l’environnement est très fort depuis toujours. Le paradoxe est pourtant là : s’ils savent protéger, ils savent aussi beaucoup détruire. C’est complexe. Ils font de grosses erreurs, dues à des nécessités économiques et donc à des nécessités vitales de survie.
« Nous sommes faits pour aller dans l’espace et sous la mer. C’est le devenir de notre civilisation. »
La chasse à la baleine, on ne peut pas dire qu’ils ont beaucoup aidé à arrêter ce genre d’exploitation. La surdensificaiton de l’aménagement du littoral est aussi effrayante : c’est effrayant de voir depuis Tokyo et en descendant sur Osaka, cette surpopulation littorale. C’est dû aussi à leur système religieux, sociétal, ancestral même : ils ne vont pas dans les collines, dans les montagnes et préfèrent les plaines et les vallons. On a du mal à comprendre cela, mais la montagne, ce sont les démons et une mythologie qui fait de la hauteur quelque chose de sacré. On doit le respecter, si ce sont leurs valeurs culturelles, nous ne pouvons pas juger. Il y a un mélange de tout cela… Et en même temps, ils sont très bien capables de protéger la nature. Ils ont conscience que le littoral est en danger, terriblement conscience. Il ne faut pas les sous-estimer. Ils ont su coloniser la mer dans l’aquaculture : ce sont des fermiers de la mer, ils savent gérer et exploiter cela. Ils connaissent la mer.
Et si l’on évoque maintenant vos projets spatiaux… Vous en êtes-vous détourné ?
Pas du tout, non ! C’est simplement qu’il n’y a pas beaucoup de temps dans une journée. (Rires.) J’aime bien vivre physiquement ce que je crée et ce que j’ai envie de créer. L’espace ne m’en donne pas l’occasion. Je vis l’architecture que je crée, ce qui me permet d’aller encore plus loin. J’imagine, j’utilise mon imaginaire, je participe à des équipes de recherche, je crée moi-même des voiles solaires pour aller faire la course de la Terre à la Lune par des vents solaires, bref, je fais ce genre de projet qui me fascine… Mais voilà, j’ai fait un vol parabolique, c’est merveilleux et j’ai une chance extraordinaire, mais c’est peu de chose. J’ai été complètement subjugué par ce vol qui a duré trois heures et demie et qui, pour moi, est une chose inoubliable, une des plus grandes que j’ai faite dans ma vie. Mais encore une fois, c’est peu de choses. Je n’ai pas l’occasion de développer plus ces projets : j’en ai fait quatre, en plus de trente ans, ce n’est pas beaucoup, je vous l’accorde. En revanche, j’ai créé une Fondation Jacques Rougerie Génération Espace Mer à l’Institut de France où j’ai développé un prix pour l’architecture de l’espace, pour que des jeunes apportent des idées nouvelles et se réalisent dans ce domaine qui s’ouvre à l’humanité. Je préfère passer la main : ce qui est important, c’est qu’il y ait un mouvement. Il faut que les jeunes participent à cette conquête de l’humanité qui est essentielle. On ne peut pas aller dans l’espace sans les architectes.
Ne sentiez-vous pas plus d’optimisme vis-à-vis de l’exploration spatiale il y a une trentaine d’années ?
C’est vrai que dans les années 1970, l’homme venait d’aller sur la Lune. Les Russes n’avaient pas réussi à devancer les Américains et pensaient aller sur Mars avant tout le monde. C’est vrai que l’espace s’ouvrait à l’humanité. On se passionnait… Je ne loupais jamais à la radio ou dans les journaux un départ d’Apollo ! L’humanité a toujours été faite de hauts et de bas, ce n’est jamais une ligne mathématique. L’enthousiasme pour l’espace a été extraordinaire mais il y avait des problèmes économiques, la guerre, le Sida… On ne peut pas s’étonner que les hommes aient eu envie d’exploration. Puis il y a les hommes politiques, un président d’une nation qui a porté cette recherche spatiale : elle n’a plus aujourd’hui les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes intérêts et du coup, un basculement se fait. Le monde est porté par des secousses et non par une linéarité. Des secousses propulsent une civilisation vers les pyramides, puis c’est le monde mexicain, les Aztèques, puis la Grèce, puis Rome… En France, nous sommes un peu mal barrés si nous ne nous réveillons pas alors que le monde bouge. C’est le propre du destin des hommes : l’espace a eu son explosion.
Pensons maintenant aux deux tendances : nous sommes allés dans l’espace et nous allons aller sous la mer. On s’aperçoit que ces deux mouvements vont apporter tellement de développements, avec des hauts et des bas. Le président Bush, par exemple, avait décidé qu’il fallait mieux guerroyer que d’explorer l’espace — et encore moins le monde sous-marin : du coup, il freine la NASA. Mais alors instantanément, les Chinois, qui ont compris que l’espace était un futur de l’humanité, aussi bien du côté du business que de la géopolitique, se sont dits que si les autres ne s’y intéressaient plus, ils allaient rattraper leur retard. C’est cela le destin des hommes. Mais la réalité, c’est qu’avec des hauts et des bas, des arrêts et des secousses, nous sommes faits pour aller dans l’espace et sous la mer. C’est le devenir de notre civilisation. Ce ne sont pas des modes, mais des séquences. Et il fallait que l’homme soit bien entouré de technologies pour aller dans l’espace ou sous la mer. C’est un génie humain incroyable, qui a créé cette technologie destructrice d’un côté mais qui apporte aussi beaucoup de bien. Cessons le catastrophisme, point trop n’en faut, les jeunes n’en peuvent plus : il faut leur montrer ce qui est positif ! C’est dans les gênes de l’homme de se surpasser et de partir dans de nouveaux mondes. Il a besoin de cela. C’est inéluctable.Couverture : le SeaOrbiter, de Jacques Rougerie