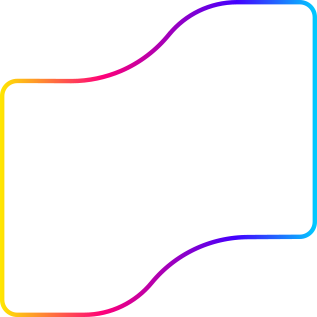Première entrevue
Vous écrivez pour des publications prestigieuses, comme le New York Times, McSweeney’s ou Wired. Pourquoi avez-vous créé Epic Magazine ?
J’ai eu l’idée d’Epic Magazine quand j’ai commencé à comprendre qu’il y avait un renouveau de l’intérêt pour le journalisme narratif, sur internet. Cela ne concerne pas tous les magazines, bien entendu, mais il y a une sorte de nouveau lectorat sur internet, de nouveaux terrains d’expression : sur les réseaux sociaux par exemple, on voit que les gens veulent lire ce genre d’histoires. Cela a créé une demande pour des articles de non-fiction exclusif, pensés pour le web. Du coup, plusieurs éditeurs ont commencé à en sortir, The Atavist par exemple.
J’ai travaillé avec eux et je connais bien le fondateur ; ils ont créé un modèle économique assez simple : si vous voulez lire l’un des articles, il faut l’acheter. Mais de notre côté, nous avons pensé qu’il serait possible de payer les journalistes une somme fixe, et que les articles seraient gratuits : nous avons donc essayé de fédérer une audience autour de notre média et nous avons cherché d’autres moyens de rémunération. Par exemple, nous avons un partenariat avec Medium. Avec Josh Davis, le co-fondateur d’Epic… Une jeune femme apparaît à l’écran, nous salue tous les deux d’un sourire et laisse un café sur le bureau de Joshuah avant de quitter les lieux. Je vous ai dit que j’étais dans une cabane, en plein milieu de la forêt ? C’est là que nous nous retirons pour écrire, regardez ! Il déplace alors la webcam autour de la pièce éclairée seulement par la lumière du jour, le grenier d’un châlet fait de rondins et de planches, miraculeusement connecté à internet. En face de lui, derrière une large fenêtre, la nature luxuriante d’une forêt de Californie et les rayons du soleil qui viennent saturer jusqu’au blanc le flux vidéo.Joli !
Nous sommes au calme. Bref, nous avons commencé à négocier avec l’industrie du divertissement : des producteurs peuvent mettre des options sur nos histoires et les transformer en série télé ou en film. Cela arrivait parfois avant quand nous publiions dans des médias traditionnels, mais avec Epic, nous voulions faire cela à une autre échelle, avec les histoires d’autres personnes que nous pourrions familiariser avec ce système. Quand vous écrivez pour un magazine, ce n’est pas quelque chose qui apparaît comme une évidence et ce n’est pas non plus aisé de naviguer dans le monde du divertissement. On nous avait déjà demandé comment il fallait procéder et nous avons décidé de rassembler des gens et de créer une plateforme qui serait visible pour les producteurs, les studios de cinémas, les télévisions… Nous essayons de faire collaborer autour du magazine des gens issus des deux milieux, celui de l’écriture et celui du divertissement.
Qu’y a-t-il de nouveau, d’après vous, dans votre manière de raconter des faits ?
Hmm. Je ne pense pas qu’il y a quelque chose de spécialement nouveau dans ce qu’on fait. Nous pratiquons un journalisme qui a sa racine aux États-Unis, disons… dans les années 1950. Vous savez, quand sont apparus les prémices d’une tendance à apprécier les histoires vraies. Peut-être que si l’on remonte aux premiers textes américains dans ce style, on peut remonter jusqu’aux années 1920. Cela n’a pas émergé de rien ! Et il y avait d’autres magazines qui faisaient déjà ça, même si je n’en connaissais pas la plupart : ce que je savais, c’est qu’il y avait un courant attaché à l’écriture d’œuvres narratives non fictives.
« Nous ne faisons donc pas quelque chose de nouveau : nous nous spécialisons simplement dans le journalisme narratif. »
Nous ne faisons donc pas quelque chose de nouveau : nous nous spécialisons simplement dans le journalisme narratif. Nous ne faisons pas, par exemple de biographies, même quand un grand explorateur meurt. S’il n’a pas fait quelque chose qui n’a pas été raconté et mérite de l’être, nous ne raconterons pas son histoire. Mais ce n’est pas simple de faire ce genre d’histoire. Pendant longtemps, cela n’a pas été instinctif pour moi… maintenant, c’est trop instinctif ! (Rires.) La plupart des articles dans les magazines ne sont pas narratifs : ce sont des critiques de livres, des biographies, des couvertures d’événements politiques, des sujets scientifiques… une sorte de version hebdomadaire des news. Mais quoi que ce soit, ce ne sont pas des articles pour lesquels on va passer six mois à essayer de tout savoir sur des prisonniers ou des lieux où quelque chose se passe, puis rester trois semaines enfermé dans une cabane dans les bois pour transformer toute cette matière en une narration. Cela, c’est presque l’antithèse des médias actuels… même s’il y a une attente pour des histoires de ce genre. Quand elles sortent, les gens les dévorent ! Pour répondre à votre question, je dirais que nous essayons de perfectionner la confection.
Comment avez-vous rencontré Joshua Davis, le co-fondateur d’Epic ?
Oh, cela fait huit ou neuf ans que nous nous connaissons. Nous avions des amis en commun, notamment un autre auteur, Steve Elliott. Il a créé un très bon magazine littéraire, The Rumpus. Nous avions donc des amis en commun à San Francisco. Davis était à San Francisco, Steve était à San Francisco et nous avons tout de suite accroché, puisqu’on avait beaucoup d’affinités, comme vous vous en doutez. En fait, je l’ai invité à Los Angeles, où je dirigeais et produisais ces espèces de shows comiques non fictifs ? (Rires.) Cela racontait des événements qui s’étaient réellement produits, je faisais cela pour McSweeney’s. Nous recevions un invité, il y avait un groupe de musique et les gens venaient raconter des histoires. Josh Davis avait raconté une histoire personnelle très drôle : il avait tenté d’être sumo en participant à l’US Sumo Open. Il en a fait une histoire pour GQ d’ailleurs, c’est comme cela que je l’ai découvert. Il y avait une photo de lui dans cet article, complètement écrasé par un type de 200 kilos. Lui, il devait en faire 60 ! (Rires.)
Il écrit également dans sa biographie qu’il a passé du temps en prison sur trois continents…
Davis a fait de la prison sur trois continents ? (Rires.) Je ne sais pas à quoi il fait référence ! Il a interviewé des gens en prison sur au moins deux continents oui, mais je ne pense pas qu’il ait été un jour prisonnier lui-même. Je pense qu’il joue sur le sens des mots.
Vous n’écrivez que des articles longs. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu que le journalisme web s’orientait vers une course à la quantité plus qu’à la qualité ?
Je m’en souviens oui. C’était l’époque où les fermes de contenu commençaient à émerger, la mode des articles mis à jour ou je ne sais quoi… Je me demandais ce que j’allais faire, quand je les voyais proposer cinquante dollars pour écrire vingt news à propos de tout et n’importe quoi. L’une d’elles s’appelait Churnalism, je ne sais pas si on peut saisir la portée du jeu de mot en français [« to churn » peut signifier mélanger avec violence ou produire en série, NDLR]. La plus grande s’appelait Demand Media. Ils affirmaient qu’ils publieraient un million d’articles par mois. Évidemment, c’était beaucoup de non-sens et des articles payés trois dollars. Autant ne pas travailler du tout ! Mais c’était ce qui se profilait autour de l’année 2009, quand Demand Media était vraiment au sommet. Cela dit, cela ne s’est pas passé comme ils l’espéraient et j’ai l’impression que le contenu est de nouveau roi : il y a tellement de plateformes et de médias maintenant qu’ils devaient bien se différencier par quelque chose. Il leur fallait quelque chose de bon, qui les mettait en avant. Et aujourd’hui, ce qui est bon est partagé et nos articles ont un large écho.
Pour quelle raison avez-vous choisi d’écrire sur internet désormais ?
Je fais encore les deux, papier et web. Mais malgré son âge, internet est encore un monde à explorer, alors c’est ce que je fais. On peut faire des choses vraiment superbes sur le web qui sont impossibles sur le papier. Tout l’aspect visuel, notamment, le design, les interactions avec le contenu. Le partage aussi, comme je l’ai dit. Après, la plupart des articles que j’écris pour des magazines papiers sont publiés sur internet d’une manière ou d’une autre. Je n’en reste pas moins très attaché au papier : j’aime lire des magazines, même le journal !
Le bon sujet
Vous écrivez sur des sujets a priori très divers, des jeux vidéo à la politique internationale : est-ce que vous pensez que quelque chose les rassemble ?
Si l’on reste du côté des thématiques, il n’y a pas d’unité, non. Cela va du grand banditisme à d’impressionnantes missions de sauvetage, aux joueurs de Pac-Man. (Il fait une longue pause, pensif.) Je pense que si je regarde dans le rétroviseur, je pourrais voir une espèce d’unité, oui, des similitudes entre les différents sujets. Il y a toujours, au cœur de mes écrits, des personnages marginaux. Je pense que je suis captivé par les gens à la marge de la société. Qu’importe ce qu’ils font, prenez par exemple le voleur de diamants : c’est un personnage exceptionnel, marginal et c’est peut-être pour cela aussi qu’il est devenu un hors-la-loi. Jusqu’à un certain degré, j’aime prendre l’individualité de ces personnages et tenter de trouver en eux ce qui relève de l’universel, ce que ces gens aux marges de la société disent de la société.
« Heaven’s Gate est un bon exemple d’histoire dans laquelle quelqu’un a priori marginal nous donne quelque chose pour penser un événement tragique. »
C’est comme l’article que j’ai fait pour cette émission de radio, « The American Life ». Quatre ou cinq de mes articles ont été faits pour la radio. Et dans ces articles, il y en a un que j’ai fait à propos d’une querelle entre différents groupes de pères Noël professionnels, ceux qu’on voit dans la rue autour des fêtes. C’est une histoire de putsch à l’union des pères Noël professionnels… bref, c’est la Révolution française chez Santa Claus. (Rires.) Ils devaient élire un dirigeant, des pères Noël se sont battus… ils sont devenus agressifs et se sont attaqués. J’en parle de manière légère, mais au fond je suis très sérieux, ce sont des choses qui se sont réellement déroulées. Ce sont des gens qui prennent très au sérieux le fait de se déguiser en père Noël. Cela paraît ridicule si l’on ne regarde que la surface des choses. Tout comme ce gars qui jouait à Donkey Kong. Cela peut paraître peu important de l’extérieur, mais si vous voyez leur activité comme ils la voient, cela devient la chose la plus importante du monde. Ce n’est pas l’histoire de quelqu’un qui joue à des jeux vidéo, c’est l’histoire de quelqu’un qui mûrit et qui comprend ce pour quoi il est fait, sans avoir de regret ou être déçu. C’est une quête universelle, commune à tous les hommes. J’ai tendance à être attiré par ces sujets, je ne sais pas trop pourquoi, et j’aime ces personnages hors du commun, étranges. J’ai écrit une histoire sur le seul survivant du suicide collectif de la secte Heaven’s Gate, en 1997. Cet homme était un peu fou, mais j’ai beaucoup sympathisé avec lui et il croyait encore à ces théories étranges comme quoi ses amis qui s’étaient tués étaient en train de flotter dans l’espace. J’ai essayé de comprendre pourquoi c’était important pour lui. C’est un bon exemple d’histoire dans laquelle quelqu’un a priori marginal nous donne quelque chose pour penser un événement tragique. Voilà ce que je fais, je pense.
Et comment composez-vous ces histoires ? Passez-vous plus de temps dans des bibliothèques et des archives ou sur le terrain ?
Ce que je fais le plus, c’est parler aux gens. En personne, ou au téléphone, cela dépend de la nature de l’histoire. Si c’est une histoire du passé, qui s’est déroulée il y a longtemps, je n’ai pas besoin d’aller voir sur place : rien ne peut s’y passer. Dans ce cas, je vais avoir besoin de rencontrer beaucoup de monde et de compiler des tas de conversations. Mon article « Coronado High » se déroule en grande partie en Californie, du coup j’ai pu rencontrer beaucoup de monde. Pour « Argo », j’ai fait la plus grande partie simplement au téléphone !
Vos interlocuteurs parlent-ils facilement de tout cela ?
Parfois j’ai quelques difficultés, des gens qui ne veulent pas du tout parler de quoi que ce soit. La plupart des gens, en revanche, aiment raconter leur histoire. Ce n’est pas habituel pour eux, du coup ils ont vraiment envie de parler. Souvent, ils ne savent pas trop à quoi s’attendre, alors je leur envoie des exemples de mes précédents articles pour leur montrer ce que cela signifie de figurer dans une histoire comme celle-ci. Mais en y réfléchissant, j’ai bien rencontré des gens qui ne voulaient pas parler du tout : un des otages que l’on voit dans « Argo » ne voulait pas parler du tout.
Et pour votre article sur Gérald Blanchard…
Oh oui, là tout le monde a parlé ! Les policiers et Blanchard, le voleur. Il était très fier de ses exploits et les policiers étaient fiers de l’avoir attrapé. Joshuah doit prendre un autre coup de fil – il dédie ses matinées à sa correspondance. Notre première entrevue s’achève.
11 heures, Los Angeles ; 20 heures, Paris : seconde entrevue. Après trois jours de tentatives infructueuses et un décalage horaire qui creuse la distance entre la côte ouest des États-Unis et la France, j’arrive à joindre de nouveau Joshuah Bearman. Notre seconde conversation, sans vidéo cette fois, sera ponctuée de bruits d’eau – bain matinal ou piscine ensoleillée.
Vous m’avez parlé d’articles pour la radio. Est-ce que vous les concevez comme des article pour un magazine ?
Le temps de l’enquête n’est pas différent, non. Le processus l’est en revanche, parce qu’il y a un producteur à la radio. À la différence d’un rédacteur en chef, le producteur d’une émission de radio est présent tout au long de l’enregistrement et du coup, on travaille plus souvent ensemble. Le show en lui-même est quelque chose de très très différent, c’est une sorte de procédé d’optimisation du temps. Il faut que tout fonctionne, avec le producteur, le producteur adjoint, l’hôte de l’émission et les créatifs qui travaillent sur le programme. Dans un magazine, vous n’allez pas souvent vous asseoir avec votre rédacteur en chef et faire l’édition à ses côtés : c’est ce qu’on fait pourtant à la radio.
Radio et cinéma
Quand on raconte une histoire de journalisme narratif à la radio, faut-il tout autant divertir et informer ?
Je suis habitué à faire les deux, donc je continue à la radio. Ce n’est pas tellement différent, au fond, qu’une histoire sur du papier. Cela aide, évidemment, de savoir raconter spontanément une histoire à l’oral, parce que l’audio que vous allez enregistrer sera exaltant pour l’auditeur, mais cela ne change pas fondamentalement votre travail de journaliste.
Quel sorte d’arrangement avez-vous avec les studios américains ? Pouvez-vous nous raconter comment les choses se sont passées pour « Argo » ?
Si l’on parle d’« Argo » en particulier, c’était assez simple. J’ai publié cette histoire et elle a été réservée par Warner Bros. et la société de production de George Clooney. C’était une procédure assez standard, en fin de compte. Le contrat de production n’est peut-être pas familier à un journaliste, mais c’était le même qu’avec un scénariste par exemple, ou n’importe qui qui aurait à établir un contrat avec un studio. Et puis il y a ce qu’on appelle aussi un droit de premier regard : certains studios qui ont acheté ce droit peuvent lire ce que l’on fait avant les autres.
« La fiction au cinéma a une tendance à habituer les gens à certains clichés et parfois, ce qui en sort paraît ridicule. Imaginez qu’Argo ait été une histoire inventée, personne n’y aurait cru : c’est trop gros. »
Quand un producteur veut l’un de vos articles, quels droits gardez-vous dessus ? Avez-vous tous les droits de publication ?
Oui, bien sûr. Les droits de publication continuent de m’appartenir. Quand un studio ou un producteur réserve votre article, il ne prend que les droits d’adaptation. Pour faire simple, en fait, ils dépensent de l’argent pour avoir l’exclusivité sur le sujet. L’article doit de toute façon être publié pour qu’ils puissent le lire et le réserver pour en faire une narration cinématographique. Parfois, on leur envoie les articles un tout petit peu avant la publication, oui, mais on parle de jours : tout est déjà prévu avec l’organisme de presse. C’est l’éditeur d’ailleurs qui peut donner le droit au producteur d’avoir un aperçu avant publication, mais cela n’a pas d’incidence du tout sur la publication de l’article.
Pourquoi n’avez-vous pas écrit le scénario d’Argo ?
Parce que je n’étais pas scénariste ! Pour des projets comme celui-là, ils préfèrent embaucher des scénaristes professionnels : ils cherchent quelqu’un qui peut leur produire un bon script. Ce n’est pas simple et c’est assez encadré à Hollywood. Alors oui, des fois ils peuvent laisser l’auteur original écrire le scénario du film et je serai peut-être amené à le faire si cela se reproduit, vu que j’ai plus d’expérience maintenant. Mais à l’époque d’« Argo », c’était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Je n’étais même pas sûr de vouloir tenter, en fait. Quand ils ont acheté l’article, ils avaient déjà une liste de scénaristes qu’ils connaissaient et dont ils avaient eu des exemples de script.
Pensez-vous que l’adaptation d’histoires vraies est une tendance actuelle de l’industrie du cinéma ?
Je ne sais pas trop. Hollywood a adapté des articles quelques fois dans le passé. Cela arrive, ce n’est pas si inhabituel que cela. Moi, en tant qu’auteur d’histoires vraies, je pense qu’elles font les meilleurs films ! Les personnages, les lieux… tout est mieux. La fiction au cinéma a une tendance à habituer les gens à certains clichés et parfois, ce qui en sort paraît ridicule. Imaginez qu’Argo ait été une histoire inventée, personne n’y aurait cru : c’est trop gros. Et pourtant, c’est une histoire vraie et elle parvient donc à captiver l’audience d’une manière complètement différente. Si vous regardez les gros films de ces dernières années, ils sont presque tous basés sur des faits réels. Dallas Buyers Club était une histoire vraie, American Hustle également, Rush, 12 Years a Slave… ce sont des gros films, faits par de grands réalisateurs. Je pense qu’il y a une tendance, oui, mais nous verrons comment elle va évoluer. On ne peut jamais savoir si c’est une coïncidence ou un mouvement qui va se développer.
Couverture : Argo, de Ben Affleck, GK Films, 2012.