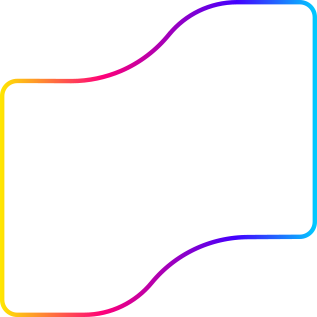Routes & Royaumes
Pouvez-vous nous raconter l’histoire de la création de Roads & Kingdoms ?
Bien sûr. Je travaillais comme correspondant à l’étranger et journaliste au Time Magazine et je devais écrire un article à Cuba. C’était le genre d’histoires très difficiles à produire, épuisantes, et je me suis fais arrêter. J’ai pris un avion jusqu’à Mexico City et j’ai rencontré l’ami d’un ami, Matt Goulding. Il était journaliste spécialisé dans la gastronomie chez Men’s Health et il avait écrit plusieurs livres à ce sujet. Au moment où nous nous sommes rencontrés, il voyageait à travers le Mexique pour manger des tacos. Nous nous sommes retrouvés à l’aéroport et nous avons pris la une voiture pour aller en dehors de Mexico City, dans un endroit qui faisait ces espèces de tacos à la viande de chèvre. C’était un grand restaurant, impressionnant.
« Voilà comme cela a commencé. Des tacos, Mexico City. »
Nous y avons passé un moment fantastique et, parce que j’étais particulièrement affecté par ce qui m’était arrivé à Cuba, je me suis rendu compte qu’il était possible de combiner ce que je faisais et ce que faisait Matt : garder tout le sérieux et l’importance du journalisme à l’étranger traditionnel, couvrir des conflits ou parler de politique mais ne pas être ennuyeux à lire, ne pas regorger de misère. Vous savez aux États-Unis, le journalisme de politique internationale, on appelle ça « manger ses légumes » : vous devez manger du correspondant étranger ou de la politique parce que c’est nutritif et non pas parce que c’est plaisant. Du coup, nous voulions créer quelque chose qui n’était pas cela, qui transmettrait aux lecteurs des choses importantes mais d’une manière plaisante, qui rendrait les gens enthousiastes. Voilà comme cela a commencé. Des tacos, Mexico City.
Vous avez donc travaillé plusieurs années au Time Magazine. Qu’y faisiez-vous précisément ?
J’y ai passé 10 ans… j’ai commencé en tant qu’informateur local pour les journalistes, reporter de terrain en somme. J’ai couvert la campagne présidentielle en tant que journaliste indépendant puis j’ai rejoint les bureaux de New York, en tant que correspondant titulaire, et je suis devenu chroniqueur pour la rubrique politique pendant un moment. Un très court moment en fait, je n’aimais pas du tout cela. Je suis très vite passé au journalisme international. Ce que j’aimais le plus, c’était écrire et voyager en tant que correspondant étranger dans des pays où j’avais vécu auparavant, en Russie, à Cuba ou au Mexique. Parler de ces pays que je connaissais bien en tant que journaliste, c’était ce que j’ai fait de mieux au Time, un excellent poste.
Il semble que vous ayez couvert plusieurs guerres… avez-vous créé Roads & Kingdoms pour trouver un peu de paix ?
(Il rit.) Pour être honnête, « plusieurs guerres » est une exagération, surtout quand vous avez des gens comme Yuri Kuzyrev qui ne font que du journalisme dans des zones de conflits extrêmes, ou comme tous les reporters qui sont à Kiev en ce moment. C’est difficile pour moi de prétendre être un correspondant de guerre, ou de l’avoir jamais été. J’ai écrit quelques articles sur les guerres liées aux drogues et j’ai été dans le Caucase, mais je n’ai pas couvert de guerres réelles. Je ne veux pas me survendre, parce qu’il y a des gens qui font vraiment le métier de reporter de guerre et qui font un travail admirable.

Moto taxi dans les rues d’Angola
Crédits : Michael Magers
Pensez-vous que la presse traditionnelle américaine a réussi le passage au numérique ?
Cela dépend vraiment des cas, il y a plusieurs très belles réussites, oui. Je pense que The Atlantic a très bien géré le tournant du numérique. Ce que fait le New York Magazine en ligne colle vraiment au support. Je ne pense pas que Time ait déjà trouvé la solution en revanche. C’est un gros site, ils ont beaucoup de trafic, ils produisent de belles choses, mais pour l’instant on ne peut pas dire qu’ils l’utilisent du mieux possible.
« Ce que j’ai appris du Time est la chose la plus importante, au fond : savoir faire la différence entre ce qui est du journalisme et ce qui n’en est pas. »
Je veux dire, aujourd’hui, toute la presse fait face aux mêmes problèmes, du coup ce n’est pas une guerre « vieux médias » contre « nouveaux médias », et le problème est qu’on peut difficilement être un éditeur de presse en ligne rentable et en même temps produire uniquement du contenu de qualité. L’argent ne vient pas des publications en ligne, du coup il faut soit avoir un magazine papier avec des comptes au beau fixe pour soutenir le site web, soit faire comme Vice et ne pas être une entreprise de presse, mais une agence de communication.
Ce sont deux choses très différentes que d’être journaliste et de créer un média. Avez-vous tiré quelque chose de votre passage au Time qui vous a aidé à créer Roads & Kingdoms ?
Ce que j’ai appris du Time est la chose la plus importante, au fond : savoir faire la différence entre ce qui est du journalisme et ce qui n’en est pas. Je leur suis très reconnaissant pour cela parce que maintenant, je ne doute plus de mes choix éthiques ou de mes instincts quand il est question de journalisme : je trouve que c’est très important dans le travail que nous faisons. C’est une chose à protéger. Du coup, je pourrais interpréter mon passage au Time comme une masterclass. J’ai rencontré des gens uniques en leur genre et extrêmement doués, qui écrivent des articles incroyables et trouvent toujours un moyen d’aller jusqu’au bout d’une enquête. Je n’aurais jamais connu cela si j’avais fait une école de commerce. Je n’aurais pas connu ces gens, je n’aurais pas su de quoi ils étaient capables, je n’aurais pas vu à quel point leur travail était exceptionnel.

Ils n’avaient jamais entendu parler de fromage
Crédits : Mark Weston
D’ailleurs le contenu que vous publiez est gratuit et vous n’affichez pas de publicité. Comment faites-vous tourner le média ?
C’est une bonne question ! Ce que nous avons eu pour nous permettre de manger, et rien de plus d’ailleurs, c’est un accord marketing avec TumblR, à l’époque où ils avaient un pôle qui s’occupait de l’éditorial. Ils ont soutenu l’innovation à ce moment-là à un point qui nous a permis de financer ce que nous voulions faire. Puis nous avons aussi de plus petits partenariats avec des magazines papier. Ce n’est pas une solution à long terme, mais cela nous permet de vivre, pour l’instant. Votre interview n’aura pas pour sujet : « Comment être jeune et riche » ! (rires) Après, je suis très optimiste quant au futur de la presse en ligne en général, mais c’est un processus et une éducation qui demandent du temps, aussi bien de notre côté que de celui des partenaires potentiels. Il faut apprendre ce que cela signifie que de faire un vrai bon travail de journalisme en ligne, et quelle est sa valeur.
« Il était clair que nous n’allions pas sacrifier notre design pour quelques centaines ou milliers d’euros de revenus publicitaires ! La publicité enlaidit tellement un site ! »
Après, nous avons eu beaucoup de chance de commencer à une époque où il était déjà clair que la publicité en ligne était un marché qu’il ne fallait plus approcher. Les taux sont très bas et pour nous, dans la mesure où le troisième cofondateur est un designer qui donne de l’importance à l’esthétique du média, il était clair que nous n’allions pas sacrifier notre design pour quelques centaines ou milliers d’euros de revenus publicitaires ! La publicité enlaidit tellement un site ! Et cet état de fait n’était peut-être pas valable il y a trois ou quatre ans : la publicité pouvait sembler être une bonne idée à l’époque.
Business model
Comment se négocient vos partenariats ? Vous considérez-vous comme une plateforme ?
Oui. Mais notre idée d’une « plateforme » diffère de ce qu’on entend par « portail ». Time.com a tenté d’être un portail : un endroit où les gens vont tout le temps, sans savoir pourquoi ils y vont. C’est une position délicate pour un média. Je ne suis pas sûr que Time soit assez gros pour être le portail internet qu’ils souhaiteraient être, d’ailleurs. Nous voulons de notre côté que les gens viennent sur Roads & Kingdoms, mais nous ne souhaitons pas créer un média qui publierait un article toutes les trente minutes. Ce n’est pas ce qui nous intéresse.

Vivre en eau profonde
Crédits : James Morgan
Vous travaillez avec un grand nombre d’auteurs. Quel est le rôle de votre équipe fondatrice ?
Ils doivent mettre en ligne et penser des articles, les produire. Bien sûr, nous écrivons aussi quand nous le pouvons : j’ai publié un gros papier en début de semaine dernière que j’ai écrit moi-même, parce que c’est ce que je ferai jusqu’à ce que mort s’ensuive. Par exemple maintenant, nous cherchons des gens pour parler de ce qu’il se passe au Venezuela et en Ukraine, qui soient capables d’être réactifs et qui pourtant sont à même de respecter notre ligne éditoriale. Nos rédacteurs en chef parcourent leurs réseaux de contacts pour trouver des gens comme ça. Des fois, ils sont assignés à des séries d’articles bien précises : Elliot Ross par exemple, qui est un très grand penseur du football, s’occupe entièrement de notre partenariat avec Sports Illustrated.
Dans votre courte biographie, qu’on peut lire sur Roads & Kingdoms, on ne manque pas de relever que vous mentionnez vos plats préférés à chaque fois que vous parlez d’un pays. Ce que vous mangez lors de vos missions à de l’importance pour vous ?
Parfaitement, oui ! J’ai remarqué ça à force de rencontrer d’autres correspondants étrangers qui parlaient du voyage qu’ils avaient fait ou de l’histoire qu’ils couvraient : c’est systématique, à chaque fois, l’article en lui-même est très peu mentionné et les journalistes parlent bien plus de ce qu’ils ont mangé ou de la ligne d’horizon qu’ils ont survolée. Nous avons presque tous l’expérience du voyage et la nourriture est un élément essentiel. Un bon ami à moi, Matt McAllester, qui travaille au Time a édité récemment un livre qui s’appelle Eating Mud Crabs in Kandahar : pour faire simple, il s’agit de correspondants de guerre qui parlent de leur expérience culinaire favorite. C’est très simple de faire parler ces gens de nourriture, parce que c’est une pierre de touche de notre humanité, c’est fort du côté des émotions et cela devient petit à petit un savoir très expert, quand vous accumulez des tas d’expériences culinaires ésotériques. La nourriture peut parfois être le seul moyen de dire l’indicible. C’est un langage commun à l’humanité toute entière.
« La nourriture peut parfois être le seul moyen de dire l’indicible. C’est un langage commun à l’humanité toute entière. »
Dès lors, cela ne me dérange pas du tout de parler de sujets très sérieux à travers la nourriture. Je suis très content de l’article que nous avons publié au sujet de la meilleure glace au chocolat de Mogadiscio. Je n’y vois aucun problème, parce qu’après avoir lu tout ce qu’on pouvait lire sur la Somalie et avoir compris à quel point c’était terrible… (il fait une pause) Quand je raconte une histoire à propos de gens qui mangent des glaces, ce n’est pas pour dire qu’on a fait une balade au bord de la Méditerranée et que chaque jour qui passe est un jour merveilleux, mais c’est pour donner aux lecteurs la chance de penser d’une autre manière un lieu dont ils ont entendu beaucoup parler mais qu’ils ne comprennent pas. Ou ne veulent pas comprendre.
Pour concevoir votre ligne éditoriale en ce qui concerne la gastronomie, vous cherchez donc à parler de sujets au prisme de la nourriture ?
C’est précisément cela. La gastronomie sans contexte ne m’intéresse pas trop. Bon, d’accord, des fois, certains plats sont simplement délicieux. Quand j’ai couvert un rassemblement de chefs étoilés à Charleston, la nourriture était phénoménale et dépassait tout ce que j’avais pu manger dans ma vie… Parfois, il faut aussi laisser leur place à ces histoires qui se racontent elles-mêmes. Si on fait quelque chose sur Kiev et qu’on écrit en même temps un article sur le Noma de Copenhague, c’est tout à fait compatible : nous voulons que les gens qui viennent sur Roads & Kingdoms sachent qu’ils peuvent y trouver les deux types de sujets. C’est notre tout qui est sur la table.
Pensez-vous que la nourriture est aussi un moyen de parler des gens ? Je pense à l’article « Ils n’avaient jamais entendu parler de fromage », que Mark Weston a écrit.
J’ai pensé qu’il avait écrit une phrase magnifique. Mark est quelqu’un de très intéressant, parce qu’il vit et a vécu dans des endroits plus fous les uns que les autres, même pour un Anglais ! Il décrit très bien ce qu’il voit et s’il n’était qu’un touriste qui écrivait à propos de l’île sur laquelle il a passé ses vacances, ça n’aurait pas été un article intéressant. Son expérience en tant qu’habitant des lieux dont il traite lui donne de la crédibilité.

Rendez-vous des chefs à Charleston
Crédits : Anthony Suau
Reste-t-il une place aujourd’hui pour des publications comme Le Fooding ou Le Guide Michelin ?
Je pense oui. Matt serait sûrement bien plus dur avec ces publications et parlerait des conséquences sur la nourriture qu’elles entraînent. Mais je pense qu’Internet est grand, ils sont les bienvenus. De notre côté, nous chercherons toujours à raconter des histoires. Donner des recommandations ne nous intéresse pas s’il n’y a pas de narration derrière. Si un jour nous écrivions un guide touristique, il serait unique et très précis sur certains points. Je ne me vois pas noter des restaurants sans enthousiasme, juste parce que cela doit être fait.
Et vous pensez que les gens les lisent encore, maintenant qu’il existe des applications comme Yelp ou TripAdvisor ?
Je crois qu’il y aura toujours une place pour de l’éditorial : les gens veulent trouver une voix en laquelle ils ont confiance et suivre cette voix. TripAdvisor est très bien, je l’ai utilisé de nombreuses fois en voyage et j’adore Yelp et tous les moteurs de recommandation, mais je pense que les gens conçoivent aussi que c’est le boulot du journaliste de vérifier si une personne qui fait une recommandation est quelqu’un en qui on peut avoir confiance ou un imposteur. Sur les moteurs de recommandation, nous cherchons des signaux faibles pour savoir si la personne derrière tel ou tel commentaire est de confiance et a les mêmes goûts que nous. Il y aura donc toujours de la place pour une vision journalistique de la cuisine et pour des gens qui diront sur des moteurs de recommandation : « Eh, j’ai mangé ici, c’était bon, venez-y. »
Brooklyn – Barcelone
Roads & Kingdoms a ses bureaux à Brooklyn…
Nous travaillons dans le quartier Dumbo, oui, une partie très intéressante de Brooklyn. C’est une sorte de quartier post-industriel qui est devenu le lieu de résidence de nombreuses entreprises de presse.
C’est à Brooklyn également que s’est ouvert la fameuse Park Slope Food Coop. Utilisez-vous ces coopératives pour acheter votre nourriture ?
Non… Nous nous sommes inscrits à une coopérative l’an passé mais je n’ai jamais pu arriver à 15:45 pour aller chercher mon panier. Je suis la pire des personnes pour ce genre de choses. Je suis très solidaire des coopératives de ce genre, mais je suis bien trop chargé dans mon emploi du temps pour faire ce que j’aurais à faire à tel ou tel moment… et je ne suis pas doué pour trouver du temps pour de la consommation éco-responsable. Pour faire court, je suis un hypocrite ! (Rires.)

Tacos électriques au Mexique
Crédits : Nathan Thornburgh
Que pensez-vous de la qualité de la nourriture aux États-Unis ?
Je pense qu’elle est excellente. Nous avons beaucoup de difficulté à diffuser la bonne nourriture à grande échelle et nous sommes aussi en train de créer un système alimentaire qui est à peu près uniquement industriel : tout cela est vrai, mais le désir d’avoir de la nourriture de qualité croît énormément. Mon oncle a été éleveur de chèvres en France pendant quinze ans et il est venu aux États-Unis ensuite pour faire la même chose. Je suis allé voir ma famille en Auvergne, dans le Cantal, là où mes cousins vivent, et c’était très intéressant de voir que les défis des fermiers français étaient presque les mêmes que ceux des fermiers américains – par exemple se plier à certaines législations qui font qu’ils ne peuvent plus faire le fromage comme ils le faisaient avant.
« Le grand écart entre l’Europe et l’Amérique en termes de culture et de tradition culinaires est en train de se resserrer. »
Le grand écart entre l’Europe et l’Amérique en termes de culture et de tradition culinaires est en train de se resserrer, je pense : nous vivons à une époque où les petits producteurs peuvent enfin faire des choses intéressantes auxquelles ils ne pensaient même pas il y a vingt ans. En France, du moins dans le tout petit coin que je connais, j’ai l’impression que le problème est inverse : la tendance est à la globalisation de la production et il devient plus difficile de faire des produits traditionnels. C’est un vrai défi aux États-Unis en tout cas et je ne sais pas qui gagnera, parce qu’à chaque fois que quelque chose se fait en faveur de la vraie nourriture de qualité, un industriel fait quelque chose de pire dans l’autre direction. Tenez, ils ont par exemple fermé un petit abattoir au nord de la Californie où des amis à moi emmenaient leurs animaux : c’était très important pour les animaux de ne pas avoir cinq heures de route à faire dans un camion pour être abattus. Le gouvernement américain fait énormément pression sur les petits producteurs, et il est très difficile d’être un petit fermier ou un petit boucher. C’est une guerre qui se joue depuis longtemps ici.
Même si ce n’est pas ce qu’est Roads & Kingdoms, quelle est votre vision du journalisme de voyage ?
Je pense qu’il ne devrait pas être différent du journalisme traditionnel. Il a besoin d’être transparent vis-à-vis de son lecteur : le journaliste doit montrer où il est et dire comment il s’y est rendu. Ces questions concernent précisément le journalisme de voyage, parce que la plupart des articles sont achetés et financés par les destinations. Ils font venir des auteurs quelque part et leur font écrire quelque chose. Ce n’est pas vraiment notre truc.
J’allais justement vous demander comment les journalistes de voyage trouvent l’argent pour payer leurs déplacements…
C’est une bonne question et nous n’avons pas encore vraiment de réponse, parce que les journalistes avec qui nous travaillons vivent dans les endroits sur lesquels ils écrivent. Nous ne sommes pas assez gros pour acheter des billets d’avion à nos journalistes, mais si on en arrive là, nous le ferons de la même manière que le Time : d’excellents journalistes et photographes payés par la rédaction pour faire les meilleurs articles possibles. Je pense qu’hélas, dans la plupart des publications dédiées au voyage, les gens oscillent entre le professionnel et l’amateur, et ce sont les destinations qui les paient. Nous recevons pas mal de propositions d’hôtels qui veulent qu’on envoie tel ou tel auteur chez eux… très bien, les gens font ce qu’ils veulent, mais ce n’est pas ce que nous faisons. Ce n’est pas dans notre ADN. Le journalisme de voyage, pour nous, c’est du journalisme. Il se situe dans des lieux où nos lecteurs ne vivent pas, mais nous ne cherchons pas à faire acheter des billets d’avion aux gens, ni à leur dire de manger telle ou telle soupe de mouton. C’est plutôt, pour nous, comme regarder les Jeux Olympiques en étant un snowboarder moyen : il y a quelque chose d’inspirant dans la lecture de textes à propos de lieux dans lesquels nous n’irons probablement jamais.

Football, le beau langage
Crédits : Marcus Brandt
En parlant des Jeux olympiques, beaucoup d’articles que nous pouvons lire sur Roads & Kingdoms parlent de voyages, mais aussi de sport. Trouvez-vous que c’est un élément important pour saisir l’esprit d’un lieu ?
Oui. Nous éditons une série d’articles avec Sports Illustrated, centrée sur le football à l’international. Nous avons parlé de la nourriture pour décrire des gens, des expériences, des cultures ou des conflits… eh bien je pense que c’est valable aussi pour le football. C’est assez stupéfiant de voir à quel point le football est connecté à tout, de l’économie aux rivalités ethniques en passant par le nationalisme ou la politique. C’est un excellent moyen, et plaisant avec ça, de décrire ce qu’il se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Les ultras du Caire étaient les piliers des Printemps arabes, le club Fenerbahçe peut vous raconter ce qu’il se passe à Istanbul. Le sport est une approche du réel qui entre parfaitement dans la ligne éditoriale de Roads & Kingdoms. Je trouve que c’est une année idéale pour la coupe du monde au Brésil : il y a tellement de pays en ce moment même, qui sont à la frontière entre deux choix, deux directions… imaginer que le monde va faire une pause et juste regarder du football pendant un mois cet été est quelque chose de fantastique.
Pensez-vous que le journalisme que vous faites peut être qualifié de positif, en opposition aux actualités traditionnelles qui font leur pain sur les désastres ?
« Imaginer que le monde va faire une pause et juste regarder du football pendant un mois cet été est quelque chose de fantastique. »
Je ne suis pas sûr que « positif » soit le terme que j’emploierais. Nous essayons de ne pas être sensationnalistes. Aux États-Unis, il y a un énorme danger, qui est que les gens arrêtent de se soucier de ce qu’il se passe dans le monde. Mais les médias sont différents des ONG, qui ont besoin de crises pour exister. Je pense que notre mission est de faire en sorte que les gens lisent et s’intéressent au monde. La manière de le faire, ce n’est pas toujours de dire : « Mon dieu, regarde comme ce qui arrive est horrible ! » Ce qui instruit vraiment, par exemple, c’est d’entendre ce que sont vraiment les Syriens, ce qu’ils sont dans leurs meilleurs moments. Les comprendre vous montrera à quel point le conflit actuel n’est pas nécessaire. Les conflits sont très médiatisés aux États-Unis et cela donne à penser que les Syriens sont juste des gens nés pour s’entre-tuer : évidemment, on ne peut pas être plus éloigné de la réalité, ces gens sont comme vous et moi et sont en train de vivre cette chose horrible qu’on appelle la guerre. Je ne sais pas si l’on peut dire qu’on fait du journalisme positif, mais montrer une image aussi complète que possible des gens, même en temps de guerre, est quelque chose d’important pour nous. Et ce n’est pas commun.
Couverture : «The Silence of the Swedes », par Lola Akinmade Åkerström.