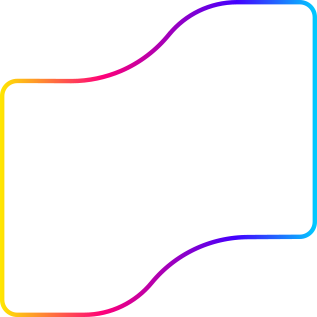Ground control to Major Tom… C’est officiel, Tom Cruise tournera le premier long-métrage dans l’espace en octobre 2021. Accompagné du réalisateur Doug Liman (La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow), l’acteur américain prendra place à bord d’une capsule Crew Dragon de SpaceX pour rejoindre la Station spatiale internationale, où les deux hommes tourneront un film au contenu encore mystérieux.
Au lendemain d’une annonce similaire de la part de la Russie, qui veut elle aussi tourner le premier film dans l’espace à l’automne prochain, la NASA a confirmé l’annonce faite pour la première fois en mai 2020 : un film hollywoodien sera bien tourné à bord de l’ISS l’année prochaine. Le climax d’une longue relation entre l’industrie cinématographique américaine et l’Agence spatiale américaine.
https://twitter.com/JimBridenstine/status/1257752395750289409?ref_src=twsrc%5Etfw
Global Effects
Le ciel est couvert en cette fin de matinée à Los Angeles, donnant un air morne aux entrepôts qui bordent les boulevards de North Hollywood. 7115 Laurel Canyon Blvd, nous y sommes. Un vaste bâtiment de brique rouge aux fenêtres flanquées de barreaux noirs, surmontées d’un panneau indiquant « Global Effects, Inc. ». Un décor pour le moins inhospitalier. Aucun touriste en vue pour le prendre en photos. On est loin de l’aura glamour qui entoure les studios de tournage qui fleurissent aux pieds des collines d’Hollywood. L’endroit n’en renferme pas moins de magie : j’ai rendez-vous avec un des plus grands accessoiristes américains, spécialisé dans la confection de combinaisons pour les grands drames spatiaux, d’Armageddon à Seul sur Mars.
Je remonte l’allée qui mène au parking privé de l’entrepôt. La zone est déserte, les volets sont tirés. Suis-je vraiment au bon endroit ? En promenant mon regard aux alentours, je remarque les pièces détachées d’une navette spatiale, dissimulées sous des bâches grises. On dirait bien. Je frappe à la porte de service métallique sur laquelle un panneau défraîchi souhaite la bienvenue aux visiteurs. Des pas se font entendre, la porte s’ouvre sur un visage sévère aux cheveux frisés en bataille. À la mention de la raison de ma venue, il s’éclaire d’un sourire. Chris Gilman confirme que je suis à bon port et m’invite à entrer. Derrière lui s’étendent les rayonnages de sa caverne d’Ali Baba, remplis de costumes, de casques et d’accessoires en tout genre. Et sur les murs, des affiches de blockbusters au succès desquels lui et son équipe ont contribué. « Bienvenue chez Global Effects », dit-il.
« On sait aussi faire des monstres, mais nous avons levé le pied de ce côté-là », explique Chris Gilman tandis que nous commençons à parcourir les allées du studio. Voilà trente ans que l’accessoiriste est dans le métier, et plus de vingt qu’il a fondé Global Effects. À l’étage sont alignées des armes et armures médiévales, que l’équipe a conçues pour des films comme Le 13e Guerrier et Le Dernier samouraï, sur lesquels il passe rapidement. Car c’est en bas que sont exposées les créations qui ont fait sa renommée dans le milieu. « Mon premier succès », dit-il en s’arrêtant devant une tenue bactériologique jaune familière. Et pour cause, elle est tirée du film Alerte ! avec Dustin Hoffman. « Dans la vraie vie, elle ne vous protégerait contre aucune contagion », dit-il avec un sourire. « J’ai designé cette visière de façon à ce qu’on puisse voir le visage de Dustin quel que soit l’angle de caméra. Mais question sécurité, c’est une vraie passoire. »
Chris Gilman n’a pas toujours été attiré par le monde du cinéma. Sa première passion était pour les étoiles. Son père était patron d’une entreprise de soudure et il a travaillé sur les systèmes de survie des missions Apollo. Gilman avait 12 ans quand il a appris à souder, et il se voyait devenir soudeur jusqu’à ce que l’entreprise familiale ne frôle la ruine après la fin du programme, en 1975. À 19 ans, le jeune Chris Gilman a finalement mis les voiles et tenté sa chance à Hollywood. La première leçon qu’il a apprise sur un tournage a été déterminante pour la suite de sa carrière. « Hollywood est le royaume du faux », dit-il d’un ton catégorique. « Du moment que ça passe bien à l’image, les accessoires peuvent être de mauvaise qualité. Ce n’est pas ma façon de travailler. » C’est avec cette conviction chevillée au cœur qu’il s’est lancé à son compte et qu’il a pu faire son trou durablement, en concevant des combinaisons spatiales ultra-réalistes.
« Une véritable combinaison spatiale, c’est plus complexe qu’une grenouillère en alu surmontée d’un bocal », commente-t-il en ironisant sur celles des films de science-fiction de sa jeunesse. Ses combinaisons à lui sont criantes de réalisme. Elles sont méticuleusement classées par ordre chronologique et niveau de détails. « Celles-ci sont actuellement utilisées par les astronautes de l’ISS », dit-il. Des combinaisons blanches qu’on appelle EMU, pour Extravehicular Mobility Unit. D’autres sont brodées du logo de SpaceX. « Celles-là n’ont pas été conçues pour un film, c’est un prototype qui nous a été commandé par Elon Musk », explique-t-il d’un ton égal. Le PDG de SpaceX et Tesla aurait insisté sur le fait que les costumes devaient avoir l’air « badass ». La plupart des autres combinaisons portent le sigle bleu et rouge de la NASA.
Après que Chris Gilman a consulté les spécialistes de l’agence spatiale pour reproduire avec le plus d’exactitude possible leurs combinaisons, ils sont venus le chercher à leur tour pour en concevoir de nouvelles pour les astronautes. Gilman a alors créé une filiale baptisée Orbital Outfitters pour ses clients issus du monde de l’exploration spatiale. Son design de combinaison pour sortie extravéhiculaire (EVA) est aujourd’hui exposé au Johnson Space Center, la maison-mère des astronautes américains, où sont gérées toutes les opérations de l’ISS et du programme Orion. Cette collaboration à double sens est l’incarnation parfaite de l’histoire d’amour que vivent Hollywood et la NASA.
Une romance qui culminait il y a quelques années avec Seul sur Mars et qui a débuté il y a bien longtemps, avant même que l’homme ne marche pour de vrai sur la Lune.
Zéro G
Le premier pas a été fait par un réalisateur visionnaire. En 1964, à peine sorti de la production de Docteur Folamour, Stanley Kubrick s’attelle à la préparation de son long-métrage suivant, 2001, l’Odyssée de l’espace (1968). Soucieux de représenter sa mission spatiale de la façon la plus réaliste possible, le cinéaste se tourne vers des techniciens de la NASA pour l’aider à mettre au point son odyssée métaphysique. Il s’alloue les services de Harry Lange, ancien chef décorateur allemand à l’époque responsable de la section des futurs projets de la NASA, où il imagine des prototypes d’engins spatiaux.
Après avoir fait la connaissance d’Arthur C. Clarke, l’auteur de 2001, Lange accepte de se joindre à l’équipe. C’est à lui qu’on doit la majeure partie des décors et combinaisons spatiales du film. L’écrivain convainc également Frederick Ordway III de participer à l’aventure. Il officie pour sa part comme conseiller de la NASA au Marshall Space Flight Center. Durant le tournage, il prodigue des conseils scientifiques à Kubrick.
Mais 2001, l’Odyssée de l’espace n’est pas l’unique liaison que le réalisateur de Shining a entretenu avec l’Agence spatiale américaine. La seconde a tissé des liens plus organiques encore entre son cinéma et la NASA, malgré un sujet très éloigné des étoiles. Presque dix ans après s’être attaqué à la conquête spatiale, Kubrick entreprend le récit d’une conquête toute terrestre avec Barry Lyndon (1975). C’est à nouveau un souci de réalisme qui pousse le cinéaste à reprendre contact avec l’agence spatiale en 1972. Il veut filmer son nouveau long-métrage en lumière naturelle, sans ajouter de projecteurs. Mais à l’époque, les objectifs utilisés traditionnellement au cinéma ne sont pas assez sensibles pour que la lumière de chandeliers suffise à impressionner la pellicule.

~
Lorsque Ron Howard entreprend la préparation du tournage d’Apollo 13 (1995), son film catastrophe avec Tom Hanks et Kevin Bacon, il veut lui aussi coller au plus près de la réalité. Et pour cause, le film est adapté de Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13, le livre écrit par le commandant de la mission James Lovell, paru 24 ans après son retour sur la terre ferme. Le cinéaste et son producteur Todd Hallowell tiennent absolument à ce que l’impression d’apesanteur soit réaliste. Mais à l’époque, près de vingt ans avant Gravity, il n’existe pas de moyen de simuler un environnement en gravité zéro de façon réaliste. Le bruit a couru pendant un temps qu’ils avaient utilisé une chambre anti-gravité de la NASA, ce qui fait encore rire Hallowell.
« C’est une légende urbaine. Je me demande toujours comment les gens ont pu croire qu’une telle chambre existait et fonctionnait réellement », raconte-t-il aujourd’hui. En 1995, il n’existait que deux moyens d’échapper à la gravité : ou bien monter à bord d’une fusée, ou bien à bord d’un avion KC-135A de la NASA. L’appareil est entré en service l’année de la préparation du tournage, en 1994, et il a effectué son dernier vol dix ans plus tard, en octobre 2004. Utilisé pour plonger les astronautes en apesanteur durant leur entraînement, il dessinait des paraboles à 45° dans les airs durant lesquelles l’équipage échappait à la gravité pendant environ 25 secondes, avant de soudainement retomber contre ses parois matelassées. « Chaque vol comptait entre 40 et 60 paraboles », disent les archives de la NASA. La presse lui avait à l’époque attribué le surnom de Vomit Comet, pour des raisons évidentes. Les acteurs d’Apollo 13 ont réalisé au total plus de 1 500 paraboles au cours du tournage.
Des trois acteurs principaux du film, Kevin Bacon était le moins partant pour tenter l’expérience. « Je ne sais pas si une recherche de réalisme aussi approfondie est nécessaire », disait-il à Ron Howard, d’après les souvenirs de Todd Hallowell. Mais quand le cinéaste lui a répondu que les deux autres étaient impatients de se lancer dans l’aventure, il n’a pas voulu passer pour le dégonflé de la bande et a cédé. L’équipe s’est ensuite adressée à Bob Williams, qui était alors en charge du programme de vols en gravité réduite de la NASA. Il n’était pas très enthousiaste à l’idée de les rencontrer. « On s’attendait à voir débarquer une bande de divas hollywoodiennes », se rappelle-t-il. Mais la méfiance des scientifiques a rapidement laissé place à la stupéfaction face à la ténacité et la discipline des acteurs, loin des stars capricieuses qu’ils redoutaient d’avoir à supporter.
Néanmoins, l’agence craignait que le fait d’évoquer l’échec d’une mission ne nuise à son image. Pris au piège de leur vaisseau, les trois astronautes avaient dû se réfugier dans le module lunaire de la fusée, qui n’était pas prévu pour accueillir aussi longtemps la vie humaine. Il a fallu un courage immense à l’équipage pour conserver leur calme et faire face à la situation, tandis que les équipes au sol faisaient le nécessaire pour les ramener sur Terre sain et sauf.
Finalement, l’histoire a connu un happy end : Jim Lovell et ses coéquipiers ont été secourus et s’en sont tirés sans dommages. Une histoire rocambolesque mais au final peu reluisante pour la NASA. Malgré cela, Ron Howard est parvenu à les convaincre de l’aider en se proposant de l’aborder sous l’angle du triomphe de la volonté et de l’ingéniosité humaines. L’excellente réception du film a achevé de convaincre la NASA qu’il y avait des bénéfices considérables à tirer de sa participation à des œuvres de divertissement.
Vingt ans plus tard, au moment de collaborer à nouveau avec Ron Howard pour la série docu-fictionnelle Mars (2016), l’Agence spatiale américaine est dotée d’un service sélectionnant les projets de films auxquels elle apporte son concours : rien de tel qu’un héros hollywoodien pour inscrire ses objectifs dans l’imaginaire collectif.
Vers Mars et au-delà
Depuis sa création en 1958, après la promulgation par Eisenhower du premier Space Act, l’Agence spatiale américaine a pour devoir de disséminer autant que possible les informations concernant ses activités et ses objectifs. Mais ce n’est qu’après le succès d’Apollo 13 que l’administration Clinton a eu l’idée de créer un service de liaison multimédia en bonne et due forme à la NASA. « Notre mission est essentiellement de raconter les histoires de l’agence de façon divertissante », résume Bert Ulrich, à la tête du service depuis 2005. « Je n’appellerais pas cela de la propagande, mais on essaie d’inspirer les enfants en les faisant regarder vers les étoiles. »
Les producteurs contactent souvent d’eux-mêmes l’agence pour les besoins du tournage. C’était notamment le cas du premier volet d’Avengers, dont la séquence d’ouverture se déroule au « NASA Space Radiation Facility » – imaginé pour le film. Lorsque Bert Ulrich a reçu le scénario, il a répondu à l’équipe du film que la NASA ne pouvait accepter leur demande car le script ne contenait aucune référence explicite à l’agence. Plutôt que de chercher un autre endroit où tourner les scènes, les scénaristes de la production Marvel ont remanié les premières pages du scénario pour y mettre la NASA en évidence. L’agence leur a alors permis l’accès au centre d’essai de Plum Brook Station.
« De cette façon, tout le monde y gagne », explique Bert Ulrich. « Nous sommes une institution gouvernementale, nous ne pouvons pas autoriser de tournage sans raison valable. » Et la portée culturelle d’un blockbuster tel qu’Avengers est une raison très valable pour l’Agence spatiale américaine.
Pour autant, les bénéfices de la NASA ne se mesurent pas en termes financiers. Lorsqu’une production a recours aux services de la NASA, elle signe un accord de remboursement des coûts occasionnés par le tournage à l’État. L’agence n’investit pas dans la production, elle mise sur la portée culturelle du cinéma pour ancrer son image dans l’imaginaire du public, partout dans le monde. Ce qui explique qu’elle refuse de participer à certains projets, comme Life. D’autres, comme Seul sur Mars de Ridley Scott (2015), sont accueillis à bras ouverts. « Ridley Scott voulait raconter son histoire de la façon la plus réaliste possible », raconte Bert Ulrich. C’est la raison pour laquelle il a sollicité les services de la Planetary Sciences Division, dont les scientifiques étudient les planètes et autres corps célestes du système solaire, et notamment Mars.
L’imagerie du film regorge de références à la NASA, et l’équipe du film a bénéficié de nombreux conseils de la part des scientifiques de l’agence spatiale. « Nous sommes très ouverts », insiste Bert Ulrich, soucieux de ne pas laisser imaginer que l’institution exerce un contrôle sur les films. « Il y a une violente tempête de poussière au début de Seul sur Mars. Comme ce n’est pas très réaliste, nous leur avons conseillé de la changer en orage électrique », raconte-t-il. « Mais Ridley Scott tenait à préserver cet aspect du livre, et nous le comprenons très bien. » Malgré cela, c’est probablement l’envie de garder un contrôle artistique total qui a poussé les réalisateurs de Gravity et Interstellar à refuser le concours de la NASA. Car le processus est à double sens. « Si nous entendons parler d’un film qui touche à des sujets touchant à la NASA, il arrive que nous prenions contact nous-mêmes avec la production », poursuit Bert Ulrich.
C’est ce qui est arrivé dans le cas de Gravity et Interstellar. Mais dans les deux cas, les cinéastes ont décliné la proposition. « Je crois qu’Alfonso Cuarón était soucieux d’avoir entièrement la main sur le film », avance-t-il. « Il se trouve que le film est très réaliste à l’arrivée, mais il redoutait sûrement que nous ne pointions certaines incohérences du doigt. » D’après Chris Gilman, de Global Effects, c’est justement d’un certain manque de réalisme dont souffre le blockbuster de Christopher Nolan. « C’est quand même dommage de mettre autant de soin à écrire un scénario pour partir dans l’espace en pyjamas », dit-il en riant. Dans les deux cas, la NASA a néanmoins permis aux films d’utiliser son imagerie.
L’impact réel de ces collaborations ne peut évidemment pas être précisément mesuré, mais Bert Ulrich affirme que la NASA est actuellement au sommet d’une vague de popularité. Après une traversée du désert au début des années 2000, les missions de la NASA (de Mars à la découverte d’exoplanètes) n’ont jamais provoqué tant d’engouement chez le public. « Nous participons à plus de 100 documentaires chaque année ; nous sommes très heureux du succès des Figures de l’ombre ; et j’attends le scénario du prochain film du réalisateur de La La Land – un biopic sur Neil Armstrong avec Ryan Gosling », dit-il. « Il y a une vraie soif d’exploration spatiale et de découverte scientifique chez la jeune génération. »
Un intérêt que la NASA s’échine à entretenir, notamment par le biais de la télévision et du cinéma. Ils nourrissent ainsi l’espoir d’inspirer la jeunesse américaine et de préserver leurs budgets. Jusqu’ici, la stratégie s’est avérée payante. Le 21 mars 2017, après avoir limité la casse quant aux coupes que l’agence spatiale redoutait, le président Donald Trump a signé le NASA Transition Authorization Act pour 2017, projetant notamment de poser le pied sur Mars d’ici 2030. Il a sûrement adoré Seul sur Mars.
Couverture : Le faux équipage de la NASA dans The Martian, de Ridley Scott.
COMMENT LA NASA A INVENTÉ LE PREMIER ORDINATEUR MODERNE
Un hacker raconte le sauvetage du premier micro-ordinateur envoyé dans l’espace par la NASA. Leur exploit technologique allait donner naissance à l’informatique moderne.
I. Apollo 1
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été passionné d’électronique et de programmation. Je viens de Tshwane, en Afrique du Sud, et mon nom est Francois Rautenbach. Je me décris souvent comme un « hacker perpétuel » : je n’aime rien tant que de percer les mystères du fonctionnement des ordinateurs. Et pour ça, il faut vraiment se plonger dans leurs entrailles et déchiffrer la façon dont leurs éléments fonctionnent ensemble. Il y a environ deux ans, j’ai lu un livre à propos de l’Apollo Guidance Computer, écrit par l’historien de la NASA Frank O’Brien. Il expliquait comment cet ordinateur de navigation révolutionnaire avait été inventé dans les années 1960, et détaillait son fonctionnement. Je me suis pris de passion pour cette machine et je l’ai finalement sauvée de la destruction alors que son possesseur s’apprêtait à le jeter à la casse…