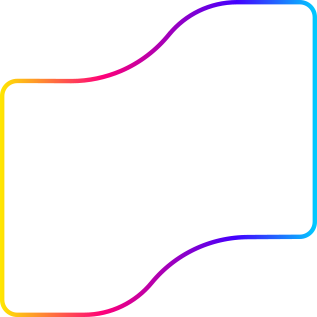D’Oasis Records aux Daft Punk
Hormis sa paire de lunettes polarisées et ses boutons de chemise rouge vif, ses cheveux gris, sa moustache broussailleuse et ses manières évoquent d’avantage un grand-père que, disons, un Skrillex ou un Diplo. Et pourtant le clou du spectacle ce soir, c’est Giorgio Moroder, pionnier de la musique électronique, géant du disco, compositeur et, à cette étape de sa carrière, tête d’affiche avec son DJ set. « La diversité de mon public est incroyable », dit-il. « Je vois des jeunes, des moins jeunes, des gens âgés de la quarantaine, d’autres qui en ont cinquante, voire même soixante ! C’est formidable de voir des gens venus du monde entier danser sur ma musique. » Moroder a aujourd’hui 75 ans et il continue de sillonner la planète en tournée – cette fois-ci armé d’un simple MacBook qui contient tous les tubes de son catalogue. Lorsqu’on le qualifie de « plus vieux DJ en tournée » au monde, il répond : « Je ne sais pas si le fait d’être le plus vieux est une bonne ou une mauvaise chose. (Rires.) Mais c’est un sentiment merveilleux, en tout cas. »
Né dans le sud de l’Italie en 1940, Moroder a grandi au son des tubes américains – principalement ceux de Paul Anka et d’Elvis Presley, mais il préférait les chanteurs afro-américains. Après s’être essayé à la guitare, il a sorti une poignée de titres sous le nom de « Giorgio » quand il avait la vingtaine. À 26 ans, il s’est exilé en Allemagne pour se lancer plus sérieusement dans la musique. « À part ma famille, il n’y avait rien pour moi en Italie », explique-t-il. À Berlin, sa carrière a vraiment démarré avec Oasis Records, un label qu’il a contribué à faire émerger. Une fois le label devenu populaire, Moroder s’est mis à collaborer avec Donna Summer, future reine du disco qui, à cette époque-là, voyageait en Europe où elle était à la fois mannequin et choriste. Ils travaillaient en tandem, et on leur doit notamment les énormes tubes que sont « Love To Love You », « Last Dance » et d’autres hits qui ont enflammé les dancefloors européens plusieurs années de suite. À la même période, Giorgio Moroder a ouvert Musicland, un studio d’enregistrement qui a fini par accueillir d’immenses artistes comme Queen, Led Zeppelin et David Bowie. Il a souvent répété depuis à quel point il était fier que son studio ait eu la réputation d’être La Mecque des plus grands artistes de l’époque. Être le patron de Musicland s’est avéré lucratif pour Moroder, tout comme le fait de se joindre à l’intérêt naissant pour le matériel musical électronique. Et si d’autres de ses contemporains, comme Kraftwerk, expérimentaient volontiers eux aussi, notamment en utilisant des boîtes à rythmes, Moroder a marqué son époque par un grand nombre de sorties révolutionnaires : que ce soit avec From Here To Eternity et ses splendeurs synthétiques, ou avec E=MC², le premier album à être intégralement enregistré numériquement.
Dans les années 1970, son succès a attiré l’attention d’Hollywood, qui a fait appel à lui. Les opportunités se multipliant, Giorgio Moroder a plié bagages pour s’installer aux États-Unis. Là-bas, il a commencé à composer des musiques de films, notamment pour le compte de la Paramount. Et en 1970, il a reçu un Oscar pour la bande-originale du film Midnight Express. Il a également écrit ou collaboré à l’écriture des classiques que sont American Gigolo, Top Gun, Scarface et la version remasterisée de Metropolis, sortie en 1984. Dans les années 1980, Moroder a alterné entre grandes collaborations – avec David Bowie (« Cat People (Putting Out Fire) ») et Blondie (« Call Me ») – et composition de musiques de film. 1984 a également été pour lui l’année de la reconnaissance internationale avec un titre qui, aujourd’hui encore, le définit à merveille : « The Neverending Story ». En dépit du fait que la chanson ait été écrite pour servir de thème principal à L’Histoire sans fin, elle est devenue incontournable dans le monde entier. Des décennies après sa conception, elle reste un monument de nostalgie auquel rend hommage une infinité de remixes.
Entre 1985 et 1992, Giorgio Moroder a fait le choix de lever le pied. Il n’a sorti que quatre albums solo aux collaborations moins nombreuses et plus confidentielles. Il l’explique simplement : « J’avais besoin d’une pause. » Après une vie passée à travailler sur de multiples projets, il a décidé de profiter des royalties qu’il avait accumulées en plus de trente ans d’une carrière triomphale. En 1992, il a sorti le quatorzième album studio enregistré à son nom, judicieusement intitulé Forever Dancing. En dépit du battage médiatique engendré par sa réunion avec Donna Summer et le soutien de ses fans de la première heure, l’album a été un succès plus critique que public. « Et puis, un jour, il y a quelques années, les Daft Punk m’ont appelé », raconte-t-il. « Je savais évidemment qui ils étaient et j’étais un fan de leur musique, mais je n’avais aucune idée de la raison pour laquelle ils m’appelaient. Ça sortait de nulle part. » Daft Punk admet volontiers avoir été inspiré par Moroder et les deux compères voulaient enregistrer un morceau hommage à leur héros. « Ils m’ont demandé si je voulais collaborer à leur nouvel album et j’ai dit : “Bien sûr, si vous avez besoin de quoi que ce soit, rappelez-moi.” » Il poursuit : « J’étais à Paris à l’époque et ils m’ont dit de passer à leur studio quand j’en aurais le temps. Tout ce que j’ai fait là-bas, ça a été de parler de ma vie. »
Random Access Memories, le titan de Daft Punk, en plus d’avoir été l’album de l’année 2013, a également réintroduit Moroder auprès d’une nouvelle génération de fans de musique dance. La chanson intitulée « Giorgio par Moroder » est un titre de 9 minutes retraçant sa vie et son influence, le tout dans un écrin d’arrangements minutieux qui cadrent avec ses différentes périodes. « J’étais très heureux quand je l’ai entendu. C’est phénoménal. » Cette collaboration a marqué un tournant pour lui, une sorte de renouveau qui l’a conduit à partir en tournée comme DJ. L’an dernier, il a sorti Déjà Vu, son quinzième album studio et son premier projet en solo depuis plus de deux décennies. À l’occasion d’une répétition avant le début de sa tournée, je me suis entretenu avec Moroder pour qu’il me raconte les histoires qui se cachent derrière ses plus grands coups artistiques. « Pendant les dix prochains jours, je serai de retour en Europe. Je commence à avoir du mal à encaisser les onze heures de vol. Mais j’adore être sur scène », dit-il.
D’Italie en Allemagne
Quel genre de musique écoutiez-vous pendant votre enfance en Italie ?
Je n’ai jamais vraiment écouté de musique italienne, ou de musique plus traditionnelle et folklorique. J’ai grandi dans le nord de l’Italie, nous avions donc la possibilité d’écouter autre chose. La plupart des stations de radio que j’écoutais diffusaient en anglais, et programmaient beaucoup d’artistes afro-américains. Au final, j’ai surtout écouté de la musique américaine. On entendait aussi beaucoup Elvis, naturellement. Je me souviens aussi de Bill Haley. The Platters, aussi, et des premiers groupes de rock. À cette époque, il y avait des tonnes de films dans lesquels on pouvait voir des chanteurs afro-américains, et j’ai toujours beaucoup aimé la musique noire. Ils diffusaient ces films près de chez moi et j’allais au cinéma de quartier régulièrement pour les voir.

Moroder en studio dans les années 1970
C’est à peu près à ce moment-là que j’ai commencé à jouer de la guitare. Je crois me souvenir que je suis assez vite devenu musicien professionnel, mais en regardant en arrière je trouve que je n’étais pas très professionnel, justement. (Rires.) Mais cela m’a permis de voyager de mes 19 à mes 28 ans environ. Avec mon groupe, nous sommes allés en Allemagne, en Suisse et à d’autres endroits, c’était merveilleux. À l’époque, nous faisions surtout des reprises.
« Looky, Looky » a été votre premier single à sortir sous le nom de Giorgio, n’est-ce pas ? Écoutez-vous parfois ces vieux enregistrements ? Qu’est-ce que cela vous fait de les entendre ?
Oui, c’est le premier titre que j’ai sorti sous mon nom, en tant qu’artiste solo. Mais avant ça, j’avais composé quelques autres morceaux, dont certains avaient plutôt bien marché localement. « Looky Looky » n’était pas mal du tout. C’était un morceau pop bubblegum, et pour faire ce genre de morceaux, on n’a pas besoin d’avoir une belle voix. (Rires.) Pour être honnête, je l’ai réécouté il y a quelques mois et je l’ai trouvé intéressant, même quarante ans plus tard.
Comme beaucoup de singles de l’époque, vos chansons ont été adaptées dans plusieurs langues. Mais il se trouve que vous êtes polyglotte. Du coup, était-ce pour vendre vos disques à un marché plus vaste ou tout simplement parce que cela vous semblait naturel ?
Mick Jagger et Keith Richards étaient extrêmement polis en dépit de leur réputation.
Non, c’est comme ça qu’on faisait en Europe, c’était juste un outil marketing pour vendre son disque partout dans le monde. Mais effectivement, cette démarche n’était pas contre-nature pour moi. Certaines chansons étaient en allemand, d’autres étaient en italien. J’en ai aussi enregistré en espagnol. C’était surtout pour s’ouvrir au marché mondial. Il faut vous rappeler que nous vendions nos titres en Amérique du Sud, aux États-Unis et dans le reste du monde. Je ne sais pas si les artistes américains le faisaient aussi à l’époque, ou même de nos jours, mais ça se faisait beaucoup en Europe. Je parlais italien bien sûr. Mais je parlais aussi allemand et anglais. Et plus tard, j’ai appris à parler espagnol. Même chose avec le français, je suis devenu bilingue sur le tard.
Elton John, T-Rex et les Rolling Stones sont quelques-uns des artistes qui ont enregistré aux studios Musicland. Quels souvenirs gardez-vous de cette époque ?
Disons qu’en tant que propriétaire des lieux, j’ai fait en sorte de ne pas me comporter comme certains autres producteurs avec qui j’avais travaillé par le passé. (Rires.) Les propriétaires de studios que j’avais connus aimaient se pointer à l’improviste et passer du temps avec les stars. Ils restaient dans leurs pattes et je ne voulais pas être comme ça. En tant qu’artiste, je comprends très bien le fait de ne pas tolérer la présence d’inconnus lorsqu’on enregistre. C’est agaçant lorsque quelqu’un débarque et s’attarde, aussi je ne l’ai jamais fait. Mais j’étais jeune lorsque j’ai ouvert le studio, et je me souviens que j’apprenais encore beaucoup à cette époque. Quand il m’arrivait de me retrouver nez à nez avec les artistes, j’essayais de ne pas les gêner. Mick Jagger et Keith Richards sont venus au studio, je les ai rencontrés et nous avons passé du temps ensemble. Malgré leur réputation de rockeurs sauvages, ils se montraient extrêmement polis. Je voyais aussi souvent Freddie Mercury. Mais la grande majorité des artistes qui ont enregistré leurs albums à Musicland, je ne les ai pas croisés. J’étais occupé de mon côté, c’était une période très chargée pour moi. J’avais déménagé aux États-Unis, mais je dirigeais toujours Musicland et beaucoup de gens y venaient encore pour enregistrer. C’était un excellent studio. Elton John y a enregistré certains de ses meilleurs titres et je suis fier d’y avoir un peu contribué. Un grand nombre de disques de Queen ont également été enregistrés au studio. Et j’ai aussi conseillé à David Bowie d’enregistrer son album là-bas lorsque qu’il m’a appelé parce qu’il cherchait un endroit.
Peu de temps après, vous vous êtes intéressé aux synthétiseurs et à des instruments moins conventionnels. Qu’est-ce qui a retenu votre attention chez eux ?
J’ai toujours aimé les synthétiseurs et j’ai toujours admiré Switched on Bach de Walter Carlos, un album qui regroupe des chansons classiques revisitées au synthétiseur. J’ai pensé que c’était un grand instrument et j’ai fait connaissance avec un technicien qui possédait un des premiers grands modèles de MOOG. J’ai commencé à travailler avec lui. Et pendant que nous travaillions, je sentais qu’il était l’un des rares qui pourraient effectivement exploiter au mieux la machine. C’est à cette période que je me suis concentré sur ces sonorités et qu’ensuite, je suis vraiment passé aux instruments électroniques.
Parlez-moi un peu de votre passage à Casablanca Records.
Après avoir vécu environ cinq ans à Berlin, je me suis senti trop loin de chez moi, en Italie. C’est pourquoi je me suis installé à Munich de façon permanente par commodité, et c’est là que j’ai écrit mes premiers tubes. Casablanca est la première maison de disques dans laquelle j’ai atterri et c’est là que j’ai rencontré Donna Summer. Toute l’équipe l’adorait et l’a pris sous son aile, en l’aidant à assurer sa promotion et à devenir l’artiste qu’elle est devenue. C’est grâce à l’investissement colossal de Casablanca, et tout particulièrement de Neil Bogart, qu’elle est devenue une si grande star.
Donna Summer et David Bowie
Comment avez-vous fait la connaissance de Donna Summer ? Quelle a été votre première impression ?
À l’époque, Donna vivait en Allemagne. Elle chantait dans une comédie musicale dont les représentations venaient juste de se terminer. Elle passait donc du temps là-bas avec son mari, à profiter de l’Allemagne. Elle avait quelques plans pour faire des chœurs, et c’est comme ça que je suis tombé sur elle. J’ai su immédiatement que c’était une artiste impressionnante et qu’elle deviendrait une star. Je l’ai donc emmenée en studio, et elle avait à l’époque – comme aujourd’hui et pour toujours – un talent immense. Elle venait d’une longue tradition de musique noire, elle maîtrisait parfaitement cet univers. Elle avait vécu à Boston, où elle avait joué pendant de nombreuses années. Et elle avait aussi participé à beaucoup de musicals, elle avait donc beaucoup d’expérience. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que c’était aussi une pianiste hors pair. Elle est bien plus qu’une chanteuse à la carrière accomplie.
Vous êtes considéré comme un pionnier de la musique dance, et c’est pendant votre période disco avec Donna que tout a commencé.
Oui, tout à fait. Au début, j’adorais vivre à Berlin, même si j’avais un peu le mal du pays. J’y avais connu plusieurs succès. Mais c’est le temps que j’ai passé avec Donna à Munich qui nous a tous les deux rendus célèbres en un rien de temps. Nous avions sorti deux chansons qui avaient bien marché – je ne me rappelle plus lesquelles exactement. Mais le morceau qui a vraiment lancé ma carrière, et celle de Donna par la même occasion, c’était une chanson intitulée « Love To Love You Baby ». C’est ce morceau qui a en quelque sorte façonné l’image disco qu’on a de moi. J’ai toujours fait la musique que j’avais envie de faire, ou que j’aimais sur le moment, mais cet enregistrement fait que les gens m’associent au disco. Ce dont je suis fier, bien sûr.
C’est après cette période disco que vous avez commencé à expérimenter davantage avec du matériel électronique. Pouvez-vous nous parler de cette phase de transition ?
Eh bien, en 1978 ou 1979, j’ai sorti « I Feel Love » avec Donna, et ce morceau reposait beaucoup plus sur l’électronique – c’était plus électro que disco je dirais. Ça n’a fait qu’amplifier ma réputation de « pro de l’électronique », mais nous étions déjà plusieurs à faire ce genre de choses. Grâce à la technologie, nous avons pu innover sans trop de difficultés. Il y avait moi, les gars de Kraftwerk, Tangerine Dream et bien d’autres. Peut-être que mon travail a précédé celui des autres, mais j’ai le sentiment que tout ça s’est passé à la même époque.
Parlez-moi de E=MC². Il est considéré comme le premier album à avoir été enregistré numériquement.

Moroder à l’époque d’E=MC²
C’était totalement expérimental. Cette façon qu’on avait de high-pitcher les voix, tous ces trucs étranges, certaines personnes ont adoré et d’autres ont détesté. Donc en définitive, je ne sais pas si tous les choix que j’ai faits pour cet album étaient de bonnes idées. (Rires.) Ce dont je me souviens le mieux, c’est qu’on a enregistré l’album en trois jours et que c’était extrêmement cher, vous n’avez pas idée. Je crois qu’enregistrer là-bas nous coûtait 10 000 dollars par jour ! (Rires.) Ces technologies étaient nouvelles, nous avions des tonnes d’ordinateurs dans le studio et tout est devenu très compliqué. On ne pouvait pas faire les modifications qu’on avait l’habitude de faire, car on ne savait pas comment y parvenir. Le projet m’a finalement pris quelques semaines de plus que ce que j’avais prévu. Je me souviens avoir dû aller dans l’Utah, à Salt Lake City plus exactement, pour apporter des modifications supplémentaires à l’ensemble et pouvoir boucler le projet. C’était une entreprise dantesque, mais c’est ce qui m’a réellement associé à la musique électronique.
À la même époque, vous vous êtes essayé à la musique de film, et vous avez travaillé sur de nombreuses bandes-originales. Vous avez d’ailleurs reçu votre premier Oscar pour celle de Midnight Express. Vous vous rappelez de cette nuit où vous avez gagné ?
D’un côté, c’était absolument génial ! Mais d’un autre côté, c’était terrifiant. (Rires.) J’étais terriblement nerveux, mais évidemment, c’était un honneur. J’ai été un peu étonné de gagner, mais la surprise n’a pas été totale car j’avais déjà gagné des Golden Globes et d’autres récompenses auparavant, qui avaient pavé la route à cette consécration. Tous les critiques de New York et de Los Angeles avaient aimé la bande-originale du film et se montraient élogieux à son propos, donc ça n’a pas été un choc. Enfin du moins, c’est ce que j’aime me raconter. (Rires.) J’étais assis dans le grand théâtre, et lorsqu’il y a eu l’annonce, je suis devenu très, très nerveux. (Rires.) Tellement que j’ai complètement perdu le fil de ce que je voulais dire et que j’ai oublié de remercier énormément de gens qui avaient contribué à l’enregistrement. J’en suis encore honteux aujourd’hui. Et quand je repense à mon passage sur scène, j’ai encore plus honte. (Rires.)
Vous avez également contribué à la bande-originale de Scarface, qui était et est encore aujourd’hui extrêmement populaire. Il vous arrive d’y repenser ?

Moroder et l’un des Daft Punk en 2014
Crédits : Mark Davis
C’est avant tout un film extraordinaire, je l’adore d’un point de vue purement cinématographique. Mais à sa sortie, il n’a pas tellement marché : c’est plus tard lors de son exploitation en VHS et DVD qu’il est devenu culte. Mais il est intéressant de voir à quel point les gens l’ont aimé. Le film est important aux yeux de la communauté afro-américaine, et il a eu une grande influence dans le rap, ce qui me ravit. À part ça, je n’ai que quelques morceaux dessus et je ne les aime pas particulièrement. (Rires.)
Qu’en est-il de votre travail sur Top Gun ?
J’ai simplement écrit deux chansons pour ce projet, « Take My Breath Away » et « Danger Zone ». Pour « Danger Zone », nous avions en tête plusieurs personnes qui seraient susceptibles d’interpréter le morceau, mais le producteur du film Jerry Bruckheimer a mis le nom de Kenny Loggins sur la table. Je n’avais jamais rencontré Kenny avant ça. Nous nous sommes vus et nous avons tout bouclé en une journée, ça a été très rapide. Kenny est un très grand chanteur. Donc voilà, c’était un travail comme un autre pour moi et ça a été fait très rapidement. Mais les gens continuent à en parler et j’en suis heureux.
J’ai lu que vous teniez « Take My Breath Away » pour être le meilleur morceau que vous ayez jamais écrit.
Je me rappelle que David est entré dans la pièce, beau et grand comme dans mon souvenir.
Oui, je crois que c’est probablement ma meilleure chanson. La mélodie est excellente et Terry Nunn l’interprète à merveille. Je trouve que la ligne de basse aussi est intéressante, et malgré tout ça reste super pop. Quant à la production, elle est parfaite. J’ai reçu un autre Oscar pour ça d’ailleurs, donc oui, c’est certainement l’une de mes chansons favorites.
Qu’en est-il de votre travail pour la réédition de Metropolis ? C’est un projet vraiment à part, qui faisait partie d’un travail de restauration majeur.
Oh, vous pouvez bien en penser ce que vous voulez. (Rires.) J’ai détesté travailler sur ce projet !
Il y a une autre de vos bandes-originales qui est restée célèbre, je veux parler de celle de Cat People, pour laquelle vous avez travaillé avec David Bowie. Pouvez-vous me parler de votre amitié avec lui et du temps que vous avez passé ensemble à l’époque ?
J’ai rencontré David il y a très longtemps, à l’époque de son premier succès, « Space Oddity ». Je l’ai rencontré en Suisse lors d’une émission dans laquelle nous étions tous les deux invités. Quand il est entré dans la pièce, je me suis dit qu’il était beau et vêtu d’une manière extrêmement intéressante ! À ce moment-là, j’avais sorti deux albums un peu rose bonbon, et de son côté il venait de sortir « Space Oddity », qui reste mon morceau préféré de Bowie. Je l’ai toujours trouvé extraordinaire. Nous sommes restés en contact dans les années qui ont suivi, mais rien de notable ne s’est produit. Et puis vers la moitié des années 1970, il m’a appelé pour me demander s’il pouvait utiliser l’un de mes studios pour enregistrer un projet sur lequel il travaillait. Le studio qu’il voulait, Musicland, se trouvait à Berlin et je lui ai répondu que la période était trop chargée pour moi pour que je puisse m’y rendre. Sans compter qu’il était utilisé par toutes sortes de gens – Blondie, Elton John, Led Zeppelin et bien d’autres. Donc je lui ai recommandé d’aller dans un autre studio que j’ai personnellement beaucoup utilisé à la fin des années 1960. C’est ce qu’il a fait, apparemment, et il m’en a dit le plus grand bien des années plus tard lorsque nous nous sommes revus.
Comment s’est passée votre collaboration ?
C’était à Montreux, en Suisse, des années plus tard. Je me rappelle que David est entré dans la pièce, beau et grand comme dans mon souvenir. À l’époque, je travaillais sur un album, plus précisément une bande-originale, pour un film qui s’appelait Cat People. C’était au début des années 1980 et si je me souviens bien, il nous manquait le thème principal. J’ai alors décidé qu’il n’y avait qu’une seule personne capable de le chanter correctement, et cette personne était David. L’atmosphère du film était parfaite pour lui, et j’ai pensé qu’il aimerait beaucoup le morceau – il y avait des arrangements étranges et plein de sons en arrière-plan, le genre d’ajouts sonores dont David raffolait. Nous avons enregistré le morceau très rapidement, ça n’a pris qu’un peu plus d’une heure. La chose amusante dont je me rappelle, c’est que le réalisateur du film Paul Schrader se trouvait à ce moment-là en studio avec nous. Il devait superviser différentes choses ce jour-là et il nous a regardés enregistrer. En deux prises, tout était parfait. Mais le réalisateur a protesté en disant : « Non, non, il faut le refaire ! » Je crois que les cinéastes sont habitués à faire de nombreuses prises sur les tournages, à répéter les choses encore et encore. Mais on était dans un studio d’enregistrement. David s’est montré très poli et lui a répondu : « Si vous souhaitez faire une autre prise, il n’y a pas de problème. Mais Giorgio et moi pensons que c’est déjà absolument parfait. » Après ça, David s’est levé et il est sorti pour fumer une cigarette, quelque chose comme ça. Schrader n’a plus dit un mot. Et vous entendez le résultat. Des années plus tard, on se voyait lorsque David venait à Los Angeles.
L’un de vos autres titres les plus populaires est « Neverending Story ». Ce n’est pas seulement le morceau parfait pour clore vos sets de DJ, mais je trouve qu’il synthétise parfaitement votre carrière.
Lorsque je le joue sur scène aujourd’hui, tout le monde connaît les paroles et les reprend en chœur. C’est un vrai bonheur pour moi. En tant qu’artiste, je ne pourrais pas être plus comblé.
Traduit de l’anglais par Maha Ahmed, Nicolas Prouillac et Arthur Scheuer d’après l’article « From Disco to Daft Punk: Giorgio Moroder’s Neverending Story », paru dans Cuepoint. Couverture : Giorgio Moroder par Terry Richardson.
LE PLUS GRAND CRÉATEUR D’INSTRUMENTS CONTEMPORAINS SE RACONTE
Roger Linn est l’inventeur de la boîte à rythmes moderne, la fameuse LM-1. De la MPC au LinnStrument, il raconte 35 ans d’une carrière incroyable.
Les propos ayant servi à réaliser cette histoire ont été recueillis par Nicolas Prouillac et Arthur Scheuer au cours d’un entretien avec Roger Linn. Les mots qui suivent sont les siens.
I. Inventer la boîte à rythmes
En 1979, j’ai créé la LM-1, la première boîte à rythmes programmable. À l’époque, j’étais guitariste et auteur-compositeur. J’étais également ingénieur du son et je travaillais dans la production musicale. Je n’ai pas reçu d’enseignement académique en matière de technologie, mais j’étais extrêmement intéressé par ce champ de connaissance. J’ai lu un nombre incalculable de livres sur le sujet et j’avais les mains dans l’électronique depuis tout jeune. Plus tard, j’ai naturellement fait coïncider ces deux passions en créant des instruments de musique électroniques.

Roger Linn et sa LM-1
Mon père a joué un rôle considérable dans ma passion pour la musique. Il était professeur de théorie musicale et de composition à l’université de Californie du Sud, et il m’encourageait à approfondir mon intérêt pour la technologie. Beaucoup moins à poursuivre mes travaux de composition, car je jouais de la musique pop, un style relativement éloigné de ses préoccupations universitaires. Mais ne lui en déplaise, j’étais guitariste. Et pour les guitaristes, l’électronique jouait un rôle majeur depuis les années 1950, et tout particulièrement dans les années 1960 où l’on a commencé à vendre massivement des pédales aux effets variés, de la wah-wah à la pédale fuzz. J’en possédais quelques-unes, et lorsque j’étais adolescent je passais mon temps à les modifier. Aujourd’hui, on appelle cette pratique le circuit-bending. Je l’appliquais donc à mes pédales, mettant à profit le peu de connaissances que j’avais à l’époque en matière d’électronique pour tenter de les faire sonner différemment, voire mieux. La LM-1, pour faire simple, comportait deux innovations majeures : l’utilisation d’échantillons de sons de batterie, ce qui n’existait pas auparavant, ainsi que l’intégration d’un ordinateur à la boîte à rythmes. Ce n’était pas la première fois qu’on faisait une telle chose, mais la plupart des gens tenait le système d’exploitation que j’avais créé pour être novateur et très utile. C’était du jamais vu : ma boîte à rythmes incluait des fonctions telles que la correction du timing (ou quantification) et le swing. Pour la petite histoire, mon premier prototype de boîte à rythmes utilisait un écran d’ordinateur, et j’ai voulu le faire essayer à Stevie Wonder. Évidemment, Stevie est aveugle, mais c’est un homme extrêmement fier et il désirait malgré tout comprendre comment utiliser mon invention. Ne pouvant pas voir l’écran, ils comptait les touches pour jouer, et c’est là que j’ai eu une révélation : il s’agissait d’un instrument à part entière, et il aurait été idiot de contraindre quelqu’un à s’asseoir devant un écran d’ordinateur pour jouer de la musique. Je suis donc rentré chez moi fermement décidé à plancher sur un système de programmation en temps réel. J’ai développé un logiciel à partir de cette idée, mais les erreurs de timing n’en facilitaient pas l’utilisation. J’ai donc créé un autre programme permettant de définir le temps et la quantification. Cela n’avait jamais été fait auparavant.