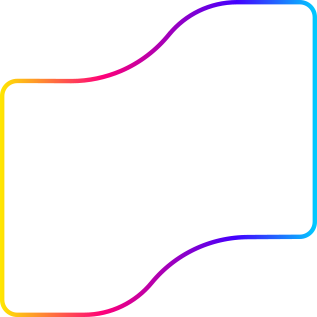D’Est en Ouest
Lorsque je suis sorti de mon immeuble du centre-ville de Berlin, un soir de l’été dernier, je n’en ai pas cru mes yeux : ma rue s’était transformée en une immense fête. Les foules s’étaient déversées partout sur le trottoir, faisant descendre leur prosciutto vegan avec des bières sans gluten et du prosecco bio. Je percevais des bribes de français, d’italien, d’anglais et de russe à travers le brouhaha des rires. Ce n’était pas une fête de quartier mais un mardi soir normal. Quelqu’un avait dû mentionner ma rue sur un blog de voyage, et c’était devenu viral. J’avais le monde entier sous mes fenêtres, et Berlin avait disparu. J’ai le droit de me plaindre : j’étais là bien avant que la vague du cool déferle sur Berlin, quand les stigmates de la guerre froide étaient encore visibles dans les rues de la ville. Berlin-Est était la capitale insalubre et fermée à double tour de la RDA, quand Berlin-Ouest était le terminus sur la ligne du capitalisme occidental.

Berlin en 1988
Crédits : Simon Claessen
Depuis que j’ai déménagé de Charleston, ma ville natale de l’Illinois, j’ai passé plus de temps à Berlin que n’importe où ailleurs – j’en avais fait mon quartier général lorsque j’ai commencé ma carrière de journaliste il y a 20 ans. Si j’ai tout quitté pour Berlin, c’est justement parce que la ville était loin des sentiers battus : elle restait inhospitalière et inaccessible à moins que vous ne fassiez l’effort d’en percer les secrets. Après la chute du mur en 1989, elle est devenue la ville la plus abordable d’Europe. Berlin est victime de son succès. Cet éternel trou paumé se veut aujourd’hui le centre du monde. Si son caractère inhospitalier est ce qui la rendait attrayante à l’époque, son statut actuel menace de la rendre à nouveau répulsive. Les nouveaux arrivants qui souhaitent transformer Berlin en ce qu’elle n’est pas prennent peu à peu le contrôle de la ville. Certains changements sont sans aucun doute positifs, mais un grand nombre d’entre eux ne le sont pas du tout. Le Berlin que j’ai connu n’était pas le genre d’endroit devant lequel on s’extasie. Il n’y avait pas de restaurants gastronomiques, mais presque exclusivement des tavernes où l’alcool coulait à flot. La culture était en compétition constante avec la contre-culture, et la sophistication n’y faisait que de fugaces apparitions, pendant des événements internationaux comme la Berlinale. Il n’a jamais été question d’argent mais d’attitude. Les gens beaux et riches affluaient dans les rues de Londres, de Munich et de Milan. À Berlin, les punks faisaient la loi. L’aspect monstrueux de la ville était directement hérité de la guerre froide et des écosystèmes uniques qui avaient fleuri à l’ombre du mur de Berlin.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Berlin-Ouest – située au cœur de l’Allemagne de l’Est – est rapidement devenue un caillou dans la chaussure des Soviétiques, qui voulaient transformer le pays en une copie carbone de l’URSS. En 1948, le Kremlin essaya d’affamer Berlin-Ouest pour soumettre ses habitants, en coupant les accès routiers et ferroviaires dans toute l’Allemagne de l’Est. Ce qui eut pour conséquence involontaire de rapprocher davantage Berlin-Ouest de l’Allemagne de l’Ouest après un raid aérien des Américains. Pour empêcher l’élite de ses citoyens de partir chercher une vie meilleure à l’Ouest, le gouvernement d’Allemagne de l’Est dressa un mur autour de Berlin-Ouest en 1961. Mais vivre emmuré dans une ville susceptible de devenir le berceau de la Troisième Guerre mondiale n’était pas du goût de tout le monde. C’est pourquoi l’Allemagne de l’Ouest investit des milliards dans Berlin-Ouest, afin de convaincre les entreprises et leurs employés de rester. Les garçons de Berlin-Ouest étaient exemptés de service militaire, et les parias de la société policée d’Allemagne de l’Ouest – les anarchistes et les artistes, les immigrés et les exilés – trouvèrent tous refuge là-bas. Ils investirent les quartiers délabrés, où ils vivaient dans des appartement insalubres. Personne ne souciaient d’eux ni de ce qu’ils faisaient.
1988
Ma première visite de Berlin remonte à 1988. Je venais d’obtenir mon diplôme et je voyageais à travers l’Europe en train, avec mon sac à dos pour seul compagnon. Mon train était parti de Copenhague et avait traversé la mer Baltique sur un ferry, avant de parcourir plus de 240 km à travers l’Allemagne de l’Est jusqu’à la ville divisée. Avant d’entrer dans Berlin-Ouest, les gardes à la frontière de Berlin-Est – pistolet-mitrailleur au poing et accompagnés de chiens – ont passé le train au peigne fin pour dénicher des réfugiés politiques. Ils sont allés jusqu’à se pencher sous les sièges et défoncer les portes des toilettes.
Dans un grincement sinistre, le train a fait halte sur un viaduc qui traversait le mur de Berlin avec ses tranchées, ses miradors et ses kilomètres de fils barbelés. L’enceinte d’une prison qui mesurait en tout plus de 160 km de long. Les gardes postés aux frontières de Berlin-Est avaient reçu l’ordre de tirer à vue si quelqu’un tentait de s’échapper. Il est difficile de décrire l’atmosphère qui régnait à Berlin-Ouest. D’un côté, on était entouré par tous les pièges du capitalisme ouest-allemand : Fanta, Adidas, Mercedes-Benz. De l’autre, on savait que peu importe la direction qu’on prenait, on finirait par marcher droit dans un mur derrière lequel était tapie une armée hostile. Berlin-Ouest était une enclave indéfendable, prise en tenaille dans un territoire ennemi. Si la guerre froide venait à se réchauffer, on grillerait immédiatement. La plupart du temps, on n’y pensait pas, mais au fond de nous, le risque qui planait affectait chacun de nos gestes. En tant que citoyen de l’une des quatre puissances occupantes, je pouvais bénéficier d’un visa d’une journée pour visiter Berlin-Est. Les touristes étrangers étaient une source de revenus pour le régime communiste, et j’ai été contraint de changer 25 Deutsche Mark pour 25 Mark est-allemands alors que le taux de change au noir était de 1 pour 16. J’ai pris un S-Bahn, un genre de train de banlieue, pour franchir à nouveau le mur jusqu’à la Friedrichstrasse Station. C’était une porte ouverte sur un monde parallèle. Les gens portaient des vêtements ternes et tombants. Il n’y avait dans les rues que deux modèles de voitures aux airs de boîtes à chaussures : la Trabant et la Wartburg. Les carrosseries étaient toutes peintes en gris clair, bleu ciel ou vert. Il y avait des panneaux publicitaires affichant des slogans communistes et des publicités pour des marques de tracteurs dont personne n’avait jamais entendu parler. Les vitrines des magasins présentaient des chapelets de saucisses et toujours plus de vêtements ternes et tombants.
J’ai pris le chemin des sites touristiques. La porte de Brandebourg, à l’intérieur de Berlin-Est, était inaccessible à cause de sa proximité avec le mur. Et comme la file d’attente pour visiter la tour de la télévision était trop longue, je me suis contenté du centre d’accueil des visiteurs, situé au rez-de-chaussée. Il y avait là-bas une belle maquette du Berlin-Est du futur, représentant de grands gratte-ciels faits de cubes blancs, abritant des bureaux et des appartements. Le contraste avec la ville grise et décrépie qui m’attendait dehors ne pouvait pas être plus flagrant. J’avais en poche mes 25 Mark est-allemands qui ne vaudraient plus rien une fois de retour à Berlin-Ouest. Mais le problème, c’était qu’il n’y avait rien à acheter. J’ai pris un exemplaire du Manifeste du Parti communiste pour quelques pfennigs. Et lorsque j’ai enfin trouvé un endroit où manger, j’ai donné quelques-uns de ces billets de Monopoly en échange d’une tranche de porc et d’une pinte de bière. Retourner en RDA quelques heures plus tard a été un véritable soulagement. Les habitants d’Allemagne de l’Est ont dû attendre un an de plus pour faire de même. Le chef de l’État soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a tenté de retarder les réformes du système communiste en vain : les mouvements pro-démocrates se répandaient déjà à travers toute l’Europe de l’Est. Le 9 novembre 1989, à mesure que les habitants de l’Allemagne de l’Est demandaient les mêmes libertés que leurs cousins de l’Ouest, les autorités de Berlin-Est ont cédé sous la pression et ont ouvert le mur. La réunification de Berlin avec l’Allemagne allait prendre moins d’un an.
~
La ville était entre deux feux lorsque j’y suis retourné pendant mes études supérieures. Le mur était toujours là, mais les contrôles aux frontières avaient disparu. Les gens pouvaient voyager librement entre les deux côtés de la ville ; un climat d’euphorie régnait sur Berlin. L’été 1990 a été une immense fête. J’ai trouvé un lit dans un vieil immeuble de Berlin-Est squatté par des punks. J’ai payé ma chambre avec mon argent de poche et on attendait de moi que je donne un coup de main pour empêcher les skinheads d’attaquer la maison. Un seau rempli de pavés était posé à côté du balcon, prêt à l’emploi, tandis qu’un grillage de poulailler recouvrait la fenêtre pour barrer la route aux cocktails Molotov. Avec quelques anarchistes venus d’Allemagne de l’Ouest, nous allions de fêtes en fêtes sur nos vélos branlants.
L’isolationnisme de Berlin n’était plus. Nous l’avons ressenti et nous avons célébré l’événement, mais nous n’avions pas saisi toute l’ampleur du phénomène. Tous ceux qui partageaient la philosophie de la ville, « vivre et laisser vivre », étaient maintenant les bienvenus. Les loyers étaient incroyablement bas car il y avait plus d’offre que de demande. Les horreurs de ces cinquante dernières années – deux dictatures, une guerre, l’Holocauste, le mur – avaient réduit la population de la ville d’un million d’âmes entre 1940 et 1990. Je n’ai déménagé à Berlin que six ans plus tard. J’ai abandonné mon école de journalisme en Californie pour accepter la bourse Fulbright attribuée aux jeunes plumes. Je suis arrivé avec deux valises à la main et j’ai trouvé une sous-location à Kreuzberg, un quartier bohémien situé dans l’ancien secteur américain. Je me trouvais à moins de deux kilomètres au sud du Checkpoint Charlie, où les chars américains et soviétiques s’étaient faits face en 1961. Tempelhof Airport, une base aérienne américaine datant de la guerre froide, était si proche qu’au retour d’un voyage, j’ai traversé directement le tarmac pour rentrer chez moi : une marche de 15 minutes. « Appartement », c’est un bien grand mot. Pour un peu plus de 150 dollars par mois, je louais une chambre avec un semblant de cuisine dans une mietskaserne, un grand ensemble construit au début du siècle dernier. Plusieurs de ces immeubles ont les toilettes communes sur le palier, j’avais donc beaucoup de chance d’avoir ma propre salle de bain. Il y avait une cabine de douche juste à côté de l’évier, alimentée par un chauffe-eau qui ne produisait qu’un mince filet d’eau chaude. 
L’eskimo
Passer du bon temps à Berlin se résume souvent à profiter de sa légendaire vie nocturne, mais mes souvenirs les plus mémorables ont pour décor l’appartement en-dessous du mien avec ma voisine, Frau Jones. Elle avait 70 ans et des poussières, des lunettes papillon, elle portait des robes à fleurs et fumait des Pall Malls à longueur de journée. Frau Jones – ou Lisa (elle insistait pour que je l’appelle par son prénom) – avait grandi à deux pas d’ici, dans le quartier de Neukölln. Son premier mari était un nazi et il avait servi dans l’armée de l’air d’Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été abattu en Italie lors d’une mission de reconnaissance. Un climat d’anarchie s’était installé à Berlin après que l’Armée rouge avait marché sur la ville. Lisa s’était cachée dans une cave pour échapper aux pillards soviétiques, et elle avait grimé son visage avec du charbon pour paraître aussi laide que possible. Elle a commencé à troquer des cigarettes et du nylon sur le marché noir pour joindre les deux bouts. Elle a ensuite rencontré un soldat américain du nom de Jones, qu’elle a épousé et suivi jusqu’aux États-Unis. Il est par la suite devenu alcoolique – sans doute à cause du choc post-traumatique – et Lisa a tenté sa chance au Canada, où elle travaillait comme acheteuse pour un grand magasin de Montréal. Elle est ensuite rentrée à Berlin pour vivre ses vieux jours, son statut de veuve d’ancien G.I. lui donnant le droit à une maigre pension versée par le gouvernement américain. Elle n’arrêtait pas de me dire : « Tu sais, je ne suis pas tendre avec les hommes, ils ne me servent à rien. » Comme la plupart des Berlinois de sa génération, Frau Jones était une survivante. Elle était dure et ne faisait pas de sentiment.
J’ai fini par me lasser de Berlin et j’ai déménagé, d’abord à Budapest, puis à Moscou.
J’ai fini par trouver un plus bel appartement avec chauffage central et une salle de bain, le tout pour un loyer deux fois supérieur à l’ancien. Berlin n’était toujours pas dans le radar des nomades du monde entier, et les Berlinois étaient évidemment inconscients de leur chance. Bonn a très vite été remplacé par Berlin en tant que capitale, mais les entrepreneurs ont préféré garder leur commerces dans les métropoles de l’ouest comme Francfort, Munich ou Hambourg. Coupée du monde pendant cinquante ans, Berlin avait des allures de petite ville. Il n’y avait presque pas de bouchons, et personne ne ressentait le besoin de se mettre à droite dans l’escalator du métro. Les seules personnes en costume étaient les hommes politiques et les étrangers. J’ai fini par m’en lasser et j’ai déménagé, d’abord à Budapest, puis à Moscou. Je me rendais à Berlin au moins une fois par an, mais j’avais perdu le goût de la ville. Lorsque je m’y suis réinstallé il y a neuf ans, je l’ai à peine reconnue. Les Berlinois parlaient anglais et mangeaient de la nourriture mexicaine.
Des immeubles tout en verre avaient poussé au milieu des bombenlücken, ces vestiges des raids aériens des Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Les quartiers mornes où vivait la classe moyenne s’embourgeoisaient, et trouver un appartement commençait à devenir mission impossible. La circulation devenait un enfer. Les Berlinois, d’ordinaire grincheux, étaient eux aussi devenus névrosés. Les yogis et autres psychologues faisaient fortune. Berlin est comme une ado rebelle qui a fini par grandir et être prise au sérieux. Elle en a été la première surprise. Durant la courte période de temps durant laquelle elle avait été la capitale de l’Allemagne, Berlin vécut un âge d’or en tant que Weltstadt, « ville-mondiale » – pendant les années 1920 notamment. Puis les nazis prirent le pouvoir, Hitler ravagea l’Europe et Berlin fut condamnée à vivre divisée par le rideau de fer. La réunification allemande ouvrit la voie à l’intégration des anciens pays communistes par l’Union européenne. Mais la réunification allemande ne fut possible qu’après la réunification de Berlin.

La gentrification en marche
Crédits : Michael Mayer
Mettre le marginal au centre de l’attention est un thème récurrent dans l’histoire de Berlin. Après la chute du mur, les quartiers crasseux de la partie est de Berlin-Ouest se retrouvèrent au centre d’une ville réunifiée. De la même façon que Berlin se retrouvait soudainement au centre d’une Europe réunifiée. En termes culturels, la ringardise décomplexée de Berlin-Ouest est le secret de l’attraction internationale qu’exerce la ville aujourd’hui. C’est le paradoxe de Berlin. Et je ne voudrais pas revenir dans le passé, même si c’était possible. Je préfère l’aspect mondialisé du Berlin d’aujourd’hui à son provincialisme d’antan. Après bientôt un siècle, la ville réclame à juste titre sa place en tant que Weltstadt. Mais dans le même temps, un nouveau type de xénophobie s’y enracine. Elle ne vise pas les étrangers en soi, mais plutôt les visiteurs importuns, quelle que soit leur nationalité : de riches Allemands du Sud s’accaparant l’immobilier ; des hipsters de Brooklyn essayant d’imposer leurs bières houblonnées en Allemagne ; et les touristes paumés que les compagnies low-cost déversent quotidiennement dans la ville. Ces intrus engorgent les rues avec leurs moyens de transport barbares : Segway, Trabant tunées, calèches et vélos à bière – des bars sur roues agrémentés de pédales. Visiter Berlin ne représente plus une aventure, à moins de considérer comme risqué le fait d’essayer d’entrer au Berghain. À l’époque du mur, personne ne venait à Berlin par hasard. Les billets d’avion étaient trop chers et on préférait faire du stop ou prendre le train pour franchir des frontières lourdement fortifiées. Tout ce qui nous entourait nous rappelait où nous étions. Et c’est là que nous voulions être, nulle part ailleurs.
L’autre jour, j’ai remarqué une queue immense devant le musée de cire Madame Tussauds, près de la porte de Brandebourg. Pourquoi venir jusqu’à Berlin pour voir une attraction londonienne ? Plus loin, c’est un pub américain qui s’affiche comme « un bar au style new-yorkais », comme si Berlin était à court de style, de bars, ou même de New-Yorkais… Et quelqu’un a ouvert un magasin de sandwichs au pastrami dont personne n’avait entendu parler avant que le New York Times ne lui consacre une critique. Au cours des trois dernières années, mon quartier a vu disparaître plusieurs commerces à cause de la gentrification : des bars, un traiteur turc-chinois et mon supermarché de proximité. Les nuits les plus chaudes, des airs d’accordéon parviennent à mes fenêtres comme si, tout d’un coup, je vivais dans une ruelle de Montmartre. Ce soir-là, l’été dernier, je me suis arrêté pour acheter une glace au magasin en bas de chez moi, tenu par une famille turque. Le gérant m’a expliqué qu’il s’était débarrassé du congélateur et qu’il allait fermer boutique car le loyer avait doublé. Le seul autre glacier de ma rue offre des sorbets bios au kalé, de fabrication artisanale. Voilà le nouveau Berlin. Ce dont j’avais besoin, pourtant, c’était bel et bien de cet esquimau orange fluo, tellement brillant qu’on pourrait s’en servir pour faire atterrir un avion. Car c’est aussi ça, le vrai Berlin : démodé, rarement raffiné, et probablement mauvais pour la santé.
Traduit de l’anglais par Maureen Calaber et Clément Louis Kolopp d’après l’article « Being Cool Has Ruined Berlin », paru dans Roads & Kingdoms. Couverture : Une fête à Berlin.
COMMENT BERLIN INVENTA LES DROITS DES HOMOSEXUELS AU XIXe SIÈCLE
Voyage dans le Berlin de la fin du XIXe siècle, où furent inventés les droits des homosexuels, par une vibrante communauté d’hommes et de femmes.
Le 29 août 1867, un avocat de 42 ans nommé Karl Heinrich Ulrichs se présenta devant le sixième Congrès des juristes allemands, à Munich, pour exhorter à l’abrogation des lois interdisant les relations sexuelles entre hommes. Alors qu’il s’avançait jusqu’au pupitre, faisant face à un auditoire de plus de 500 personnalités distinguées du monde judiciaire, il fut parcouru d’un frisson de peur. « Il est encore temps de se taire », se rappela-t-il s’être dit plus tard. « Cela mettrait un terme aux martèlements de ton cœur. »

Karl Heinrich Ulrichs
Mais Ulrichs, qui avait avoué plus tôt le désir qu’il éprouvait pour les personnes de son sexe dans des lettres adressées à des proches, ne fit pas demi-tour. Il affirma devant l’assemblée que les gens dotés d’une « nature sexuelle contraire à la coutume » étaient persécutés pour des pulsions que « la nature, qui règne et crée selon des lois mystérieuses, a implanté en eux ». Ce fut un tollé, et Ulrichs fut contraint de couper court à ses propos. Mais il avait fait son effet : une poignée de ses collègues à l’esprit libéral furent conquis par sa conception d’une identité gay innée, et un responsable bavarois lui confia en privé éprouver de semblables désirs. Dans un pamphlet intitulé Gladius furens, (Le Glaive furieux), Ulrichs écrivit la chose suivante : « Je suis fier d’avoir trouvé la force de plonger la première lance dans le flanc de l’hydre du mépris public. » Le premier chapitre du livre Gay Berlin : Birthplace of a Modern Identity (« Le Berlin gay : berceau d’une identité moderne »), de Robert Beachy, débute par le récit de l’acte audacieux d’Ulrichs. Le titre du chapitre, « L’invention allemande de l’homosexualité », met en exergue le propos au cœur du livre : bien que l’amour entre personnes de mêmes sexes soit aussi vieux que l’amour lui-même, les discours qui l’entourent ainsi que le mouvement politique qui vise à faire valoir ses droits est né en Allemagne entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Ce message pourrait bien surprendre ceux qui pensent que l’identité homosexuelle s’est concrétisée à Londres et à New York, à une période située entre le procès d’Oscar Wilde et les émeutes de Stonewall. La violente répression dont furent victimes les homosexuels durant la période nazie a en grande partie effacé l’histoire homosexuelle de l’Allemagne de la conscience collective internationale, voire même de la mémoire collective allemande. Beachy, par ailleurs historien enseignant à l’université de Yonsei à Séoul, termine son livre en soulignant que les Allemands célèbrent la « gay pride chaque mois de juin », un jour connu sous le nom de « Christopher Street Day », en référence à la rue dans laquelle les émeutes de Stonewall ont éclaté. L’homosexualité est perçue comme une importation américaine. Ulrichs, considéré comme le premier activiste homosexuel, fit face à la censure et dut finalement s’exiler, mais ses idées s’imposèrent petit à petit. En 1869, un littéraire autrichien du nom de Karl Maria Kertbeny, qui s’était également opposé aux lois anti-sodomie, inventa le terme « homosexualité ». Dans les années 1880, un commissaire de police de Berlin cessa de poursuivre les bars gays en justice et instaura à la place une politique de tolérance étonnante, allant jusqu’à donner des visites guidées de ce monde en pleine émergence. En 1896, Der Eigene (« L’Unique », au sens de : « autonomie individuelle »), le premier magazine homosexuel, commença à paraître.