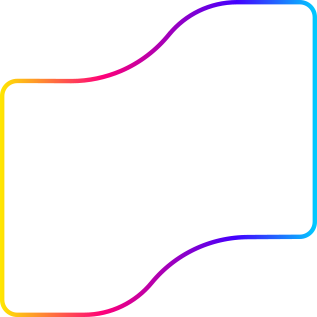« Les films avancent comme des trains, tu comprends ? Comme des trains dans la nuit. » Cette réplique de La Nuit américaine (1973), film de François Truffaut sur le cinéma, constitue pour beaucoup la définition du processus de fabrication d’un film. Ferrand, le metteur en scène, est alors face à l’acteur, Alphonse (Jean-Pierre Léaud), et tente de faire comprendre à ce dernier qu’on ne peut sacrifier un film à ses ennuis personnels durant un tournage. L’image est donc installée : un film est un train, autrement dit une grande machine qui avance, envers et contre tout. Il y a de la beauté, de l’inéluctable là-dedans. Dans La Nuit américaine, c’est bien sûr Truffaut lui-même qui incarne le personnage du metteur en scène, et ces mots, il les a déjà prononcés dans la vie, quelques années plus tôt. Il y a des trains qui arrivent plus tard que d’autres. Le voyage de Fahrenheit 451 (1966) aura duré six années au total – du moment où l’étincelle s’embrase, où l’idée jaillit, jusqu’à la libération du film, sa sortie en salles.
Prendre un billet
C’est lors d’un dîner chez Jean-Pierre Melville, en août 1960, que Truffaut entend parler pour la première fois du roman de Ray Bradbury. Le réalisateur est alors accompagné par Liliane David, une jeune actrice, l’une de ses maîtresses, qui inspira d’ailleurs en partie le personnage joué par Françoise Dorléac dans La Peau douce (1964). Dans une interview, Truffaut se rappelle que la conversation chez Melville avait porté sur la science-fiction : Truffaut l’avait attaquée, prétendant que ce genre était réservé aux « gens qui n’avaient pas d’imagination ». Il avait d’ailleurs écrit un article intitulé « À bas la science-fiction ! » dans la revue Arts des années auparavant, lorsqu’il était critique de cinéma. Défenseur de la SF, le producteur Raoul Lévy avait alors raconté en quelques mots l’intrigue de Fahrenheit 451, devant un Truffaut captivé. Écrit en 1953 au beau milieu du maccarthysme, le roman de Bradbury raconte un monde totalitaire où les livres seraient interdits et brûlés régulièrement par des pompiers dans des autodafés publics – critique de la société américaine de l’époque, qui selon l’auteur privilégiait le progrès matériel aux évolutions intellectuelles et culturelles. Fahrenheit 451 est la température à laquelle brûle le papier. L’histoire, comme le soulignera Truffaut plus tard dans le dossier de presse du film, « ne se déroule pas forcément dans le futur, mais “quand vous voulez” et “où vous voulez” ». Un jour, l’un des pompiers, Montag, rencontre une jeune femme qui éveille chez lui la curiosité de lire un livre. Il change de camp. Traqué, il se réfugie auprès des « hommes-livres », une communauté qui vit aux marges de la société et qui apprend les livres par cœur, afin d’éviter que les chefs d’œuvres de la littérature ne tombent dans l’oubli. La seule mémoire des hommes assure ainsi à la littérature une postérité – bien que cette postérité, du fait de l’apprentissage par cœur, ait quelque chose de mécanique.

Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966
Crédits : Anglo Enterprises et Vineyard Film
« À présent je suis las de ces images maritimes et je voudrais que mon quatrième film ne fût plus un navire en perdition, mais un train qui traverse la campagne. » — François Truffaut
En parallèle, François Truffaut prépare un livre sur l’un de ses maîtres de cinéma : Alfred Hitchcock, dont il a écrit les éloges dans les pages des Cahiers du Cinéma lorsqu’il était critique. Pour le convaincre, le réalisateur des Quatre cents coups n’avait pas été avare de compliments en lui adressant une longue lettre le 2 juin 1962 : « Si, du jour au lendemain, le cinéma devait à nouveau se priver de toute bande sonore et redevenir un art muet, bien des metteurs en scène seraient condamnés au chômage, mais parmi les rescapés il y aurait Alfred Hitchcock dont tout le monde comprendrait enfin qu’il est le meilleur metteur en scène au monde. » Grâce à l’aide d’une de ses complices, l’Américaine Helen Scott, qu’il avait rencontrée quelques années auparavant, Truffaut se met donc au travail et prépare le Hitchbook, un livre d’entretiens sur toute la carrière de Hitchcock, où le maître du suspens décortiquera sa filmographie. En août 1962, Truffaut et Helen Scott s’entretiennent ainsi avec Hitchcock à Los Angeles, durant six journées entières. Truffaut réalise l’un de ses rêves : discuter de cinéma avec l’un de ses cinéastes préférés. Ce même été, Les Films du Carrosse acquièrent les droits du roman de Bradbury pour la somme de 40 000 dollars, somme plutôt conséquente pour l’époque et pour une société de production française de cette taille. François Truffaut a changé d’avis et songe désormais à tourner le film en langue française. Le premier acteur qui lui vient à l’esprit pour incarner Montag est alors Jean-Paul Belmondo, grande vedette depuis 1960 et d’À bout de souffle de Godard, et qui brille déjà dans de nombreux films de la Nouvelle Vague. Truffaut l’a rencontré à la fin juin au festival de Berlin et avait évoqué le projet. Cependant, Belmondo tourne Le Doulos avec Jean-Pierre Melville et n’est pas disponible avant le printemps 1963. Cette indisponibilité sur le moyen terme et les exigences de salaire extravagantes du comédien exaspèrent Truffaut, qui renonce vite à Belmondo.
Regarder le paysage
En mai 1963, le projet Fahrenheit est au point mort. Truffaut revoit son scénario, faute de pouvoir avancer sur les aspects plus concrets du film. Après avoir visionné un court-métrage qui l’a impressionné, Janine, il propose une collaboration au jeune réalisateur Maurice Pialat, qui accepte instantanément, des étoiles dans les yeux. Au dernier moment, peut-être par crainte et pour se rassurer face à un projet qui s’avère difficile à monter, Truffaut se tourne vers Claude de Givray, son ancien assistant réalisateur sur son premier court-métrage, Les Mistons, et avec qui il écrira par la suite deux films du cycle Doinel, Baisers volés (1968) et Domicile conjugal (1970). Frustré par ce projet qui patine, Truffaut veut réaliser autre chose, un projet plus modeste et rapide à tourner. Ce sera La Peau douce, film « indécent, complètement impudique, assez triste mais très simple », inspiré par des faits divers et par quelques visions qui hantent depuis toujours le réalisateur, comme par exemple l’image de jambes de femmes habillées de bas, qui se croisent et se décroisent à l’arrière d’un taxi. Il écrit le scénario en un mois, en juillet 1963, avec Jean-Louis Richard, dans le même décor que celui où ils ont écrit Fahrenheit – au Martinez, à Cannes.
On fait alors une proposition inespérée à Truffaut : celle de réaliser un scénario américain, Bonnie and Clyde.
La Peau douce, histoire d’adultère écrite et filmée sous haute influence hitchcockienne, s’inspire de faits divers lus dans les journaux, mais aussi et surtout de la propre vie de Truffaut, qui partage un appartement avec sa femme, Madeleine Morgenstern. Sous couvert de fiction, le réalisateur s’attaque à la vie de couple et à son propre mal-être face à celle-ci, et tourne dans son propre appartement. La Peau douce est un film à suspens – on suit Pierre Lachenay (Jean Desailly), homme marié qui tombe amoureux d’une hôtesse de l’air (Françoise Dorléac). La peur constante de se faire surprendre pèse sur le personnage principal et sur l’ensemble du film, qui est abordé comme un thriller. Le financement du film est rapidement trouvé et le tournage commence en octobre 1963. Comme à son habitude, François Truffaut est tombé éperdument amoureux de son actrice principale, la ravissante Françoise Dorléac, surnommée affectueusement Framboise par Truffaut en clin d’œil à la chanson de Bobby Lapointe Avanie et Framboise. Dans le dossier de presse de La Peau douce, Truffaut écrit en 1964 : « Jusqu’ici j’ai toujours eu le sentiment, à chaque premier jour de tournage, de lancer un bateau sur la mer et ensuite le travail consistait à redresser la barre jour après jour (…) À présent je suis las de ces images maritimes et je voudrais que mon quatrième film ne fût plus un navire en perdition, mais un train qui traverse la campagne. » Neuf ans plus tard, dans La Nuit américaine, il réutilise cette métaphore en la prononçant lui-même devant la caméra face à Jean-Pierre Léaud. Alors que Truffaut est en plein tournage, la quatrième version du scénario de Fahrenheit est achevée. Les finances des Films du Carrosse sont au plus bas. Le succès de Jules et Jim est déjà loin, et les différents intervenants sur le projet coûtent cher. On fait alors une proposition inespérée à Truffaut : celle de réaliser un scénario américain, Bonnie and Clyde. Le réalisateur, emballé par le projet, envisage même un certain temps d’abandonner Fahrenheit pour s’y consacrer entièrement. Cependant, après beaucoup de tergiversations et de rendez-vous, Truffaut renonce au projet, dont Warren Beatty a racheté les droits. Le réalisateur se refuse à diriger cet acteur qu’il n’admire aucunement. Il écrira à la productrice Elinor Jones : « [Warren Beatty] fait partie pour moi, avec Marlon Brando et quelques autres, d’une petite liste que je classe dans ma tête sous la rubrique “mieux vaut ne pas tourner du tout que de tourner avec ces gens-là”. » Il recommande cependant aux producteurs son ami Jean-Luc Godard, également intéressé par Bonnie and Clyde, mais les rencontres entre Godard et les Américains n’aboutiront à rien à cause d’un problème de calendrier. Arthur Penn signera finalement la réalisation du film, énorme succès au box-office, qui fera plus tard la joie des universités de cinéma – notamment des cours de montage. L’état d’esprit dans lequel Truffaut se trouve lorsqu’il aborde de nouveau Fahrenheit 451 est d’autant plus aggravé que le projet ne décolle pas. On ne trouve d’argent nulle part : Fahrenheit impressionne, intimide, à cause des nombreux incendies et trucages nécessaires au film. Les Films du Carrosse ne connaissent aucun répit : la production est attaquée en justice pour plagiat sur le film Mata Hari (1965), que l’on accuse d’avoir été copié sur un scénario déjà existant. On prélève 250 000 francs sur les recettes du film, ce qui parachève de fragiliser les finances du Carrosse.

Oskar Werner et Julie Christie dans Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966
Crédits : Anglo Enterprises et Vineyard Film
S’arrêter en province
Le budget de Fahrenheit est à présent estimé à 900 000 dollars. Lewis Allen négocie un investissement de la MCA (Music Corporation of America), une filiale d’Universal, basée à Londres. Encore sous le bon souvenir de leur collaboration sur Jules et Jim, Truffaut propose à Oskar Werner (« Jules ») le rôle secondaire du capitaine des pompiers. Deux jours plus tard, l’acteur autrichien accepte avec joie par télégramme. Les rôles féminins sont revus : Jean Seberg s’étant désistée, Julie Christie la remplace. Bernard Herrmann quant à lui accepte de composer la musique – le choix du compositeur de Vertigo (1958), La Mort aux trousses (1959) ou encore Psychose (1960) réaffirme l’influence hitchcockienne de Truffaut. Le tournage est à présent prévu au printemps 1965, à Toronto ou à Londres. Cependant, alors que les éléments du puzzle semblent enfin prendre place, et que le projet a repris le nom de Fahrenheit 451, un élément perturbateur arrive de nouveau. Le producteur Sam Spiegel, grand manitou hollywoodien, comptant entre autres dans sa filmographie Sur les quais (1954), Lawrence d’Arabie (1962) et Le Pont de la rivière Kwai (1957), s’intéresse au projet. Des négociations sur le casting s’entament alors entre Spiegel et Lewis Allen. Truffaut est mis à l’écart et, inquiet, sent son film lui glisser entre les doigts. Avec l’aplomb des empereurs, Spiegel réclame un changement radical de casting, sans doute pour monter le film à son image. Il réclame Robert Redford, Richard Burton et Liz Taylor dans les rôles principaux, faisant ainsi grimper le budget du film à trois millions de dollars. Le désaccord sur le casting est trop grand : Spiegel ne veut pas entendre parler de Terence Stamp dans le premier rôle et abandonne donc le projet, aussi promptement qu’il est arrivé.
La langue anglaise fait l’effet d’un cœur artificiel qui irriguerait les énergies du long-métrage.
C’est la mi-juin 1965. Lewis signe enfin avec MCA, confiant la distribution internationale du film à Universal. Encore une fois, on fait des prévisions de tournage : ce sera janvier 1966, aux studios de Pinewood, à Londres. En été 1965, Truffaut commence à travailler avec Terence Stamp. Le producteur Lewis Allen a alors l’idée insolite de faire jouer les deux rôles féminins du film (la femme de Montag, Linda, et la jeune fille qu’il rencontre, Clarisse) par la même actrice : Julie Christie. Charmé par cette idée, Truffaut accepte. Bien que Clarisse ne devienne pas la maîtresse de Montag dans Fahrenheit 451, on retrouvera cette même idée de l’interchangeabilité de la femme et de la maîtresse dans Domicile conjugal, où Antoine Doinel retrouve une routine de vie redoutée avec sa maîtresse Kyoko, pour laquelle il avait pourtant quitté sa femme Christine. Truffaut donne à son producteur la plaisante tâche d’annoncer la nouvelle à Jane Fonda, qui devait incarner Linda Montag, et de son côté s’envole pour Madrid où il rejoint Julie Christie sur le tournage de Docteur Jivago, afin de lui porter la bonne nouvelle. Julie Christie refuse néanmoins de se couper les cheveux pour le rôle de Clarisse et s’arrange pour commander une perruque sur mesure à Londres. Bien entendu, Truffaut éprouve instantanément un coup de foudre pour la jeune Anglaise, et ses sentiments sont réciproques. C’est alors que tout semble s’effondrer de nouveau : apprenant que la même actrice incarnera les deux rôles féminins principaux, Terence Stamp quitte le projet, persuadé qu’on cherche à lui voler la vedette. Truffaut et son producteur insisteront en vain : l’acteur orgueilleux ne reviendra pas sur sa décision. L’épuisement de Truffaut, le manque de temps ou bien les deux à la fois le poussent à proposer le rôle principal à Oskar Werner. Ce dernier accepte mais n’est pas à l’aise avec ce changement de programme soudain, sentant probablement qu’on l’a choisi en dernier recours. Il fait grimper ses exigences salariales. En automne 1965, Truffaut se lance sur cinq projets de front pour sortir de l’impasse et renflouer ses finances : L’Enfant sauvage, La Petite voleuse (finalement réalisé en 1988 par Claude Miller, quatre ans après la mort de Truffaut), un film pour Jean Pierre Léaud, une comédie dramatique pour un jeune couple, et le futur Argent de poche. En janvier 1966, six années après le dîner chez Melville où Truffaut avait entendu parler du roman de Bradbury pour la première fois, et quatre années après la première acquisition des droits du livre, le tournage peut commencer. Deux jours avant le début du tournage, on a engagé Cyril Cusack pour incarner le capitaine des pompiers. Profitant de son isolement à Londres, Truffaut commence un journal de tournage, qui commence par une première phrase dont on peut pleinement apprécier l’amertume tant elle synthétise l’ensemble de ses difficultés sur le projet : « Lundi 10 janvier 1966, à Londres. Le tournage de Fahrenheit 451 devait commencer aujourd’hui, mais il est reporté. » La veille du premier jour de tournage, le 12 janvier 1966, Godard rend visite à Truffaut sur le plateau. Ils vont voir ensemble L’Impératrice rouge (1934) de Joseph von Sternberg, l’une des seules parenthèses agréables d’un tournage difficile, épuisant, celui d’un film « pas tourné mais arraché, plan par plan », que le réalisateur n’a presque plus envie de faire, dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Ironie du sort : malgré les longues années nécessaires pour monter le projet, Truffaut n’est pas à l’aise : « Je suis débordé par ce film insuffisamment préparé », écrit-il à un ami. Le tournage dure trois mois et demi, période durant laquelle rien n’est improvisé excepté les dernières séquences du film. En tournant en studio, dans une langue étrangère, en s’interdisant de moduler le scénario au gré de ses envies et de ses inspirations, Truffaut ne se sent pas libre. Il s’agit de son premier film en couleurs et de son unique film de science-fiction, en anglais de surcroît.

Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966
Crédits : Anglo Enterprises et Vineyard Film
Arriver à destination
Le 20 juillet 1966, après environ trois mois de post-production, Fahrenheit 451 est achevé. S’il en aime certains détails, Truffaut n’est pas content du résultat. « Je pense beaucoup de mal de ce film, scène par scène et plan par plan » écrit-il dans son journal lors du montage. Le film est néanmoins sélectionné à la Mostra de Venise par Luigi Chiarini. Ray Bradbury aime beaucoup le film et trouve qu’il respecte son livre, ce qui console un peu le réalisateur. L’accueil critique en France est froid, et le film totalise 185 000 spectateurs en 18 semaines d’exploitation. Truffaut admet lui-même que l’un des problèmes majeurs sur ce tournage fut sa pénible maîtrise de la langue anglaise. Si l’on connaît la place centrale de la littérature, des mots et de leur musique dans les films de Truffaut, on ne peut guère s’étonner de cette déception. Fahrenheit 451 se détache du reste de la filmographie de François Truffaut car la musicalité du français, si chère au cinéaste, est absente. C’est un film différent des autres, comme réalisé dans un état second, bien que l’on y retrouve des thématiques truffaldiennes et que ce film reste malgré tout un film personnel. Ses livres préférés sont là, et les filmer en train de brûler est un moyen pour le cinéaste de leur rendre hommage. Truffaut avait dit lui-même qu’il avait filmé les livres comme des personnages à part entière, afin que l’on s’alarme de leur destruction. Mais la langue française, qui occupe une place si centrale dans tous les films du réalisateur, manque terriblement. Son remplacement par la langue anglaise fait l’effet d’un cœur artificiel qui irriguerait les énergies du long-métrage. « Avec l’image d’un film on arrive à une satisfaction partielle, peut-être à 70 % ou 80 % de ce qu’on a rêvé, dans les meilleurs des cas. Avec le dialogue on peut arriver à 100 %. Pour La Peau douce, par exemple, je suis content des images à 60 % mais des mots prononcés à 100 %. Même si on n’aime pas le film, je sais qu’il chante juste et je n’en dirais pas autant de Fahrenheit, où ma frustration résidait là. »

Julie Christie dans Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966
Crédits : Anglo Enterprises et Vineyard Film
Couverture : Fahrenheit 451, de François Truffaut, 1966.