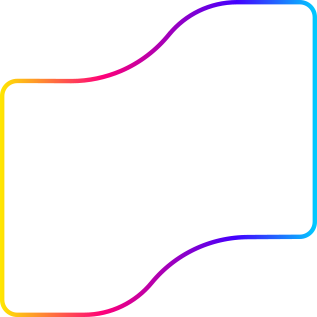Pablo Escobar est à terre. Alors qu’il s’enfuyait sur les toits de Medellín, ce 2 décembre 1993, le trafiquant de drogues le plus célèbre au monde a pris une balle de la police colombienne. Les derniers moments du boss du cartel de Medellín introduisent la nouvelle saison de la série Narcos. À travers ses yeux, on peut apercevoir, dans le flou de l’image, deux paires de jambes s’approcher pour lui porter le coup fatal. Désormais, la voie est ouverte pour ses héritiers. « Le jour où Pablo est tombé, le cartel de Cali est devenu l’ennemi numéro un », annonce la voix off de la bande-annonce publiée samedi 5 août.

Crédits : Netflix
Pour ce troisième volet, le réalisateur et producteur José Padilha s’est intéressé aux anciens rivaux et successeurs d’El Patrón. Car Narcos, précise-t-il, n’est pas simplement une série « sur Pablo Escobar, mais sur le trafic de cocaïne en général. Quand la cocaïne est passée d’une petite production au Chili à un commerce en Colombie, qu’elle a franchi les frontières et est devenue un problème pour les États-Unis, il se trouve qu’Escobar a eu un rôle prépondérant. » Si ce dernier reste le plus connu, « les autorités américaines disent que ce sont les frères Rodríguez Orejuela, autrement dit les chefs du cartel de Cali, qui étaient les vrais rois de la cocaïne », indique le journaliste Ron Chepesiuk, auteur du livre Escobar vs. Cali: The War of the Cartels. En vérité, le marché de la drogue colombienne a plus été marqué de leur sceau que de celui d’Escobar.
Ajedrecista
Au début du mois de juin 1995, le cartel de Cali possède plus de mille propriétés, dont une centaine de bureaux, plusieurs dizaines de locaux commerciaux, deux bars, autant de parkings et même une clinique. Assis sur une fortune estimée à trois milliards de dollars, son chef, Gilberto Rodríguez Orejuela, occupe un luxueux appartement de Santa Monica, un quartier huppé de Cali. Tout génie des affaires qu’il est, l’homme a besoin de personnel pour l’aider à gérer ce patrimoine. « Contrairement à ce qui est communément admis, la personne la plus importante dans la vie d’un narco-trafiquant n’est ni sa mère ni sa femme, mais son comptable », observe le général Rosso José Serrano Cadena, qui dirigeait l’opération de démantèlement de l’organisation des frères mafieux. « Ces gars manipulent tant d’argent qu’ils ne savent pas comment le contrôler. » C’est justement en suivant la trace de ce comptable que Serrano parvient à débusquer le patron du cartel de Cali, le 9 juin, alors qu’il était caché dans une pièce derrière une porte en bois déguisée en armoire, au sein de sa résidence de Santa Monica.
Quelques mois plus tard, emprisonné à Bogotá, Gilberto Rodríguez Orejuela nuance le propos du général. « J’ai été initié au trafic de stupéfiants en 1975 par l’entremise d’amis proches que je ne souhaite pas citer », déclare-t-il à un procureur. « Ce n’est pas pour m’opposer à la justice mais simplement parce que j’ai une famille qui compte plus d’une centaine de personnes, entre mes fils, mes neveux, mes petits-enfants, mes frères… Ils seraient menacés de mort dès le moment où je citerais l’une de ces personnes par son nom. »
En vingt ans, le truand a transformé une petite affaire familiale en véritable multinationale du crime. Fils d’un peintre publicitaire et d’une blanchisseuse colombiens, Gilberto Rodríguez Orejuela est né le 30 janvier 1939 à Mariquita, dans la province de Tolima. À 13 ans, il gagnait de l’argent de poche en portant des messages pour la petite pharmacie La Perla. Amateur de voyage et de rumba, son père se rendait régulièrement à Cali, où il finit par installer la famille. C’est là que naquit l’un des sept frères et sœurs de Gilberto, Miguel, et que l’aîné étudia au collège San Luis Gonzaga. Là aussi que, continuant de jouer le messager pour les pharmacies, il put monter sa propre officine, la bien-nommée Droguería Monserrate.
Aussi doué pour le commerce que dur à la tâche, le jeune homme parvint à bâtir un petit empire en cinq ans. Son sens des affaires et son entregent auprès des décideurs locaux lui valurent le surnom d’ « Ajedrecista » (un automate redoutable au jeu d’échecs). Mais cela ne suffisait pas à cet homme, qui fut assez fou pour prendre la diagonale criminelle. Accusé de la séquestration de deux étrangers en 1969, Gilberto fut vite épaulé de son frère. Leur noms se retrouvèrent, à la fin des années 1970, sur une liste des douanes américaines, aux côtés de ceux de 111 des trafiquants les plus dangereux au monde. Des chargements de bois aux poteaux en béton en passant par les fruits frais, tout était bon pour dissimuler la poudre blanche sur des navires qui accostaient à New York, Los Angeles, la Nouvelle Orléans, Houston et même Chicago. Afin de satisfaire la demande américaine en drogues de synthèse, les narcotrafiquants colombiens délaissèrent les petits champs de cannabis pour organiser ceux de coca, plus rentables. Peu à peu, « sous l’effet de l’augmentation de la pression policière dans les deux gros pays exportateurs de l’époque, le Pérou et la Bolivie, la production se déplaça en Colombie », indique Jacobo Grajales, chercheur à l’université Lille 2 et auteur d’un ouvrage sur le paramilitarisme en Colombie. Une crise de surproduction éclata même au début des années 1980.
Dans un article de la revue américaine Foreign Affairs de 1988 sur la « Colombie et la guerre contre la drogue », Bruce Bagley estime que les revenus issus de la vente de drogue en Colombie passèrent d’1,5 milliard de dollars en 1980 à 2,5 milliards cinq ans plus tard. À cette période, « il n’y avait pas de distinction claire entre les cartels de Medellín et de Cali », juge le journaliste américain William Rempel, auteur de l’ouvrage At the Devil’s Table: The Untold Story of the Insider Who Brought Down the Cali Cartel. « Les opportunités du trafic étaient assez grandes pour tout le monde. Les responsables de Cali étaient amis et partenaires avec ceux du nord. Ils partageaient même les routes de la contrebande. » Une paix qui ne dura pas.
Le KGB de Cali
Pour un vendeur de drogue, Gilberto Rodríguez Orejuela était tout sauf discret. À la manière d’un entrepreneur rapace, il n’hésitait pas à investir dans les secteurs les plus exposés de la société colombienne, devenant actionnaire de la filiale colombienne de Chrysler et prenant la majorité des parts du très populaire Deportivo Cali, le club de foot local. Son empire commercial comprenait les laboratoires Kressford, la chaîne pharmaceutique La Rebaja, la banque des Travailleurs, la Première banque inter-américaine de Panama, et le groupe Radial. Quant à sa mainmise sur le circuit de la drogue, elle allait croissante. S’agissant de la cocaïne, cette voracité comportait quelques risques. Lors d’un séjour en Espagne au cours duquel il voulait s’ouvrir le marché européen, en 1984, le Joueur d’échecs faillit être extradé vers les États-Unis. Mais Madrid refusa la requête américaine. Et, à son retour en Colombie, il bénéficia de l’influence qu’il avait acquise dans les secteurs économique et politique pour échapper à la prison. « La concentration de richesses permit au cartel d’acheter la Colombie tout entière : la police, les politiciens, quelques généraux, des hommes d’affaires et des juges », s’exclame William Rempel. De leur côté, les hommes de Medellín se lancèrent dans une guérilla contre l’État la même année en assassinant le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla. « Escobar était violent, sans pitié et vengeur », détaille Ron Chepesiuk. « Il essayait de tuer tous ceux qu’il pensait se dresser en travers de son chemin. » 
Dans cette rivalité comme dans son opposition à l’État, Pablo Escobar mettait tout en œuvre pour prendre le dessus, quitte à séquestrer ou à tuer les intermédiaires indociles. Aussi réclama-t-il aux frères Rodríguez Orejuela, en vain, qu’on lui remît Pacho Herrera. « Ce conflit n’était qu’une question de pouvoir », remarque William Rempel. « Pablo l’a demandé, mais les chefs de Cali ont refusé d’être ses laquais. » Ils tentèrent même de l’assassiner le 13 janvier 1988, en plaçant 80 kilos de dynamite dans une voiture garée devant l’immeuble Monaco, propriété d’un de ses proches. S’ensuivit une série d’attentats. Le 27 novembre, Escobar fit tuer les 106 passagers du vol 203 Avianca sans parvenir à atteindre sa cible, le candidat à l’élection présidentielle César Gaviria – qui n’était pas à bord. Dix jours plus tard, une charge explosive entraînait la mort de 70 personnes au quartier général des services de sécurité colombiens (ex-DAS).
Entre août et décembre 1989, le cartel de Medellín tua 107 officiels et civils, organisa 205 attaques à la bombe et causa 501 millions de dollars de dommages. À cet empilement de violences vinrent s’agréger une myriade de petits groupes criminels, de paramilitaires et de rébellions armées telles que celle des FARC. Certains entretenaient « des liens forts avec les milieux de la politique et de l’économie, légale comme illégale », selon Jacobo Grajales ; d’autres vivaient du kidnapping de personnalité et de barons de la drogue. En butte à la corruption des hautes sphères de l’État, quelques dignitaires de l’armée menaient des opérations dans leur coin pour combattre tel ou tel groupe. Ils envoyèrent le fils d’un général de l’armée, Jorge Salcedo, à Londres pour chercher des mercenaires à même d’abattre Escobar. L’opération échoua, mais produisit quelques échos. « Des gens à Cali veulent vous parler », entendit Salcedo au téléphone en janvier 1989. Prompt à s’opposer à Pablo Escobar, le jeune militaire devint le chef de la sécurité de Miguel Rodríguez Orejuela. « Il se voyait comme le protecteur des femmes, des enfants et des maîtresses du boss », explique William Rempel. « Il dirigeait un groupe de gardes du corps et de spécialistes de la surveillance, mais maniait rarement une arme. Il évitait aussi d’être impliqué dans le transport ou le trafic de drogue. » Si le cartel de Cali adoptait une approche moins violente que celui de Medellín, préférant user de son pouvoir d’influence dès que nécessaire, son service de renseignement était particulièrement bien organisé. Au point que les agents de la DEA l’appelaient le KGB de Cali.
Le comptable
Au bout d’une route cahoteuse grimpant sur les hauteurs d’Envigado, dans la banlieue sud de Medellín, un grillage blanc entoure quelques blocs surplombés d’un mirador. De l’intérieur, le complexe ressemble à un hôtel doté de téléviseurs derniers cris, d’un bar, d’un billard et d’un jacuzzi. Mais on ne paye pas pour venir à La Catedral, du moins pas directement. À sa reddition le 19 juin 1991, Pablo Escobar a été transféré dans cette prison tranquille, cage dorée pour délinquant milliardaire. Après avoir échappé à plusieurs tentatives d’assassinat fomentées par Cali, El Patrón a négocié son arrestation contre l’assurance de ne pas être extradé et de pouvoir gérer ses affaires ici, dans le luxe. Craignant son transfèrement vers les États-Unis, il s’évada à l’été 1992. Escobar était alors « devenu un homme parano qui tuait ses propres hommes », observe William Rempel. Lesquels, pour certains, se sont mis à ses trousses au sein de Los Pepes (« Les Persécutés par Pablo Escobar »), un groupe rejoint par les frères Rodríguez Orejuela. Le cartel de Cali mit ses énormes moyens financiers, ses armes et sa grosse machine de renseignement au service de cette alliance de circonstance. Escobar « avait énervé à peu près tout le monde en Colombie », constate Ron Chepesiuk. Bien que les agents américains l’aient toujours nié, le journaliste assure qu’une coopération existait entre Los Pepes, la DEA et la CIA. Toujours est-il que leur objectif commun de faire tomber Escobar fut atteint le 2 décembre 1993.
Le président colombien dut se résoudre à agir pour faire taire les accusations.
Dès lors, les frères Rodríguez Orejuela se savaient menacés. Pour se mettre à l’abri, ils offrirent de financer la campagne du candidat à la présidentielle, Ernesto Samper, finalement élu en août 1994. Cela suffirait-il ? De son côté, Washington restait déterminé à faire tomber les cartels l’un après l’autre. « Dans sa guerre contre la drogue, le gouvernement américain employa la stratégie du pivot », analyse Ron Chepesiuk. « Il cibla des profils connus pour faire du bruit dans les médias et donner l’illusion que cette guerre était en train d’être gagnée. Ça aidait surtout à obtenir du budget… » Après le démantèlement de canaux de distribution en Floride, l’administration Clinton pressait Samper. Quand le financement de sa campagne avec l’argent de la pègre fut attesté, le président colombien dut se résoudre à agir pour faire taire les accusations.
En 1995, le gouvernement mobilisa 500 soldats et policiers dans une unité appelée le « Groupe de recherche » afin de pourchasser les deux frères. Une récompense d’1,6 million de dollars était aussi promise. Mis sur la trace de l’aîné en suivant son comptable, les forces de l’ordre finirent par le débusquer le 9 juin. « Ne tirez pas, je suis un homme de paix », s’exclama Gilberto avant d’enfiler les menottes. Restait Miguel, devenu à son tour « parano », d’après Joge Salcedo. Forcé à regarder la pendaison de cinq traîtres supposés, le responsable de la sécurité ne supportait plus la situation. Quand on lui demanda de trouver l’un de ses amis, le comptable Guillermo Pallomari, pour le faire tuer, il appela la police. À son arrivée à l’endroit indiqué par Salcedo, elle ne trouva personne. Sur la radio du cartel, le déserteur entendit alors Miguel dire à son fils qu’il venait d’être exfiltré par un capitaine de la police locale. « Quel cauchemar, je suis mort », pensa Salcedo. Pendant plusieurs semaines, il put cependant continuer à jouer un double-rôle pour permettre, le 6 août, l’arrestation du deuxième chef du cartel de Cali. Pacho Herrera tomba quant à lui le 1er septembre. Comme Escobar en son temps, les frères Rodríguez Orejuela « pouvaient faire à peu près ce qu’ils voulaient depuis leur cellule, car le système judiciaire colombien était corrompu », raconte Ron Chepesiuk. Mais leurs affaires n’échappèrent pas à Washington. Sur la foi des preuves rassemblées par les autorités américaines, Gilberto fut extradé en décembre 2004 et Miguel en mars 2005. Avec leur arrestation, l’ère des grands cartels colombiens déclinait. La chaîne du trafic de drogues se retrouve aujourd’hui disséminée entre plusieurs petits acteurs qui veillent davantage sur leurs familles que sur leurs comptables.
Couverture : Les puissants du cartel de Cali.